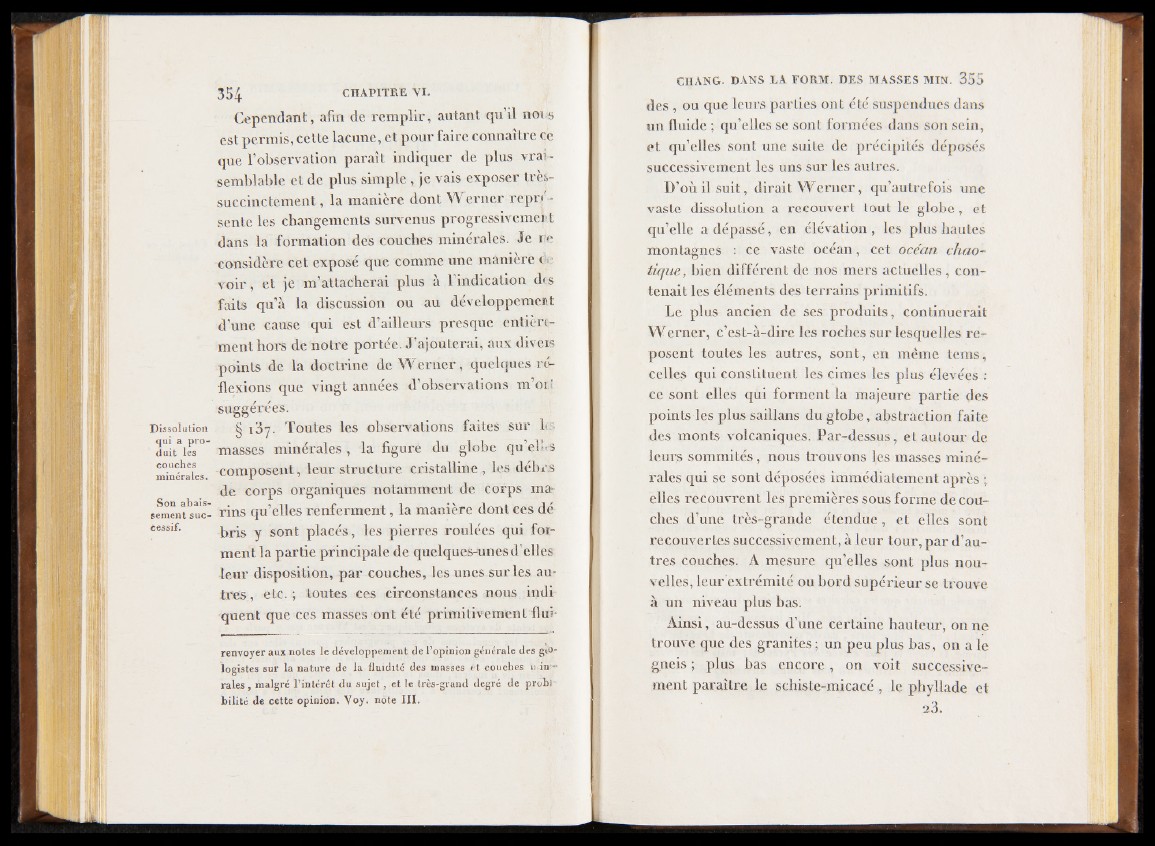
Dissolution
qui a produit
les
couches
minérales.
Son abaissement
successif.
Cependant, afin de remplir, autant qu’il 11015
est permis, cette lacune, et pour faire connaître ce
que l’observation paraît indiquer de plus vraisemblable
et de plus simple , je vais exposer très-
succinctement , la manière dont Werner repr< -
sente les changements survenus progressivement
dans la formation des couches minérales. Je rie
considère cet exposé que comme une manière de
voir, et je m’attacherai plus à l’indication dis
faits qu’à la discussion ou au développement
d’une cause qui est d’ailleurs presque entièrement
hors de notre portée. J’ajouterai, aux divers
points de la doctrine de Werner, quelques réflexions
que vingt années d’observations m’orî
suggérées.
§ 137. Toutes les observations faites sur lis
masses minérales , la figure du globe qu’elbs
composent, leur structure cristalline, les débris
de corps organiques notamment de corps marins
qu’elles renferment, la manière dont ces dé
bris y sont placés, les pierres roulées qui forment
la partie principale de quelques-unes d’elles
leur disposition, par couches, les unes sur les autres
, etc. ; toutes ces circonstances nous indi
quent que ces masses ont été primitivement flui
renvoyer aux notes le développement de l’opinion générale des gt»*
logistes sur la nature de la fluidité des niasses et couches ii.in-
raies, malgré l’intérêt du sujet, .et le très-grand degré de probi
bilité de cette opinion. Voy. note III.
des , ou que leurs parties ont été suspendues dans
un fluide ; qu’elles se sont formées dans son sein,
et qu’elles sont une suite de précipités déposés
successivement les uns sur les auLres.
D’où il suit, dirait Werner, qu’au trefois une
vaste dissolution a recouvert tout le globe, et
qu’elle a dépassé, en élévation, les plus hautes
montagnes : ce vaste océan, cet océan chaotique,
bien différent de nos mers actuelles , contenait
les éléments des terrains primitifs.
Le plus ancien de ses produits, continuerait
Werner, c’est-à-dire les roches sur lesquelles reposent
toutes les autres, sont, en même tems,
celles qui constituent les cimes les plus élevées :
ce sont elles qui forment la majeure partie des
points les plus saillans du globe, abstraction faite
des monts volcaniques. Par-dessus, et autour de
leurs sommités, nous trouvons les masses minérales
qui se sont déposées immédiatement après ;
elles recouvrent les premières sous forme de couches
d’une très-grande étendue , et elles sont
recouvertes successivement, à leur tour, par d’autres
couches. A mesure qu’elles sont plus nouvelles,
leur extrémité ou bord supérieur se trouve
à un niveau plus bas.
xAinsi, au-dessus d’une certaine hauteur, on ne
trouve que des granités ; un peu plus bas , on a le
gneis ; plus bas encore, on voit successivement
paraître le schiste-micacé , le phyllade et