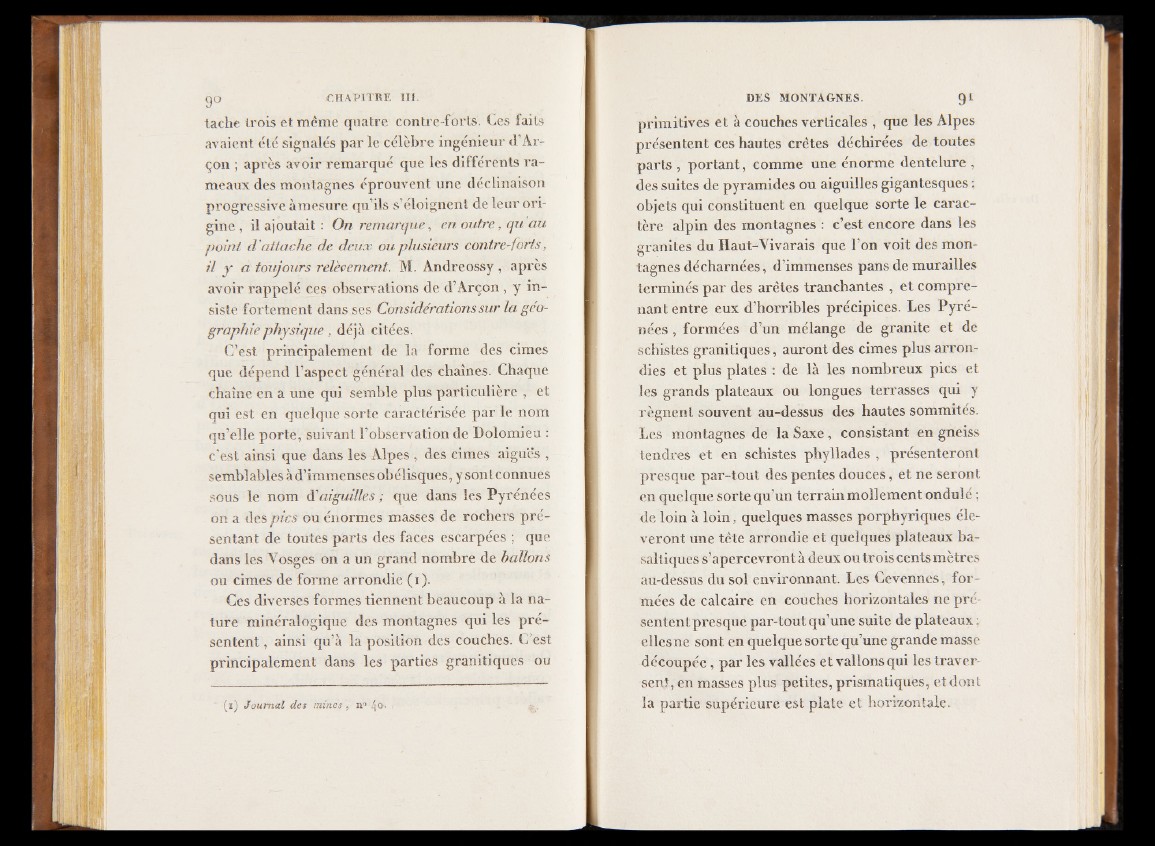
tache trois et même quatre contre-forts. Ces faits
avaient été signalés par le célèbre ingénieur (l’Arçon
; après avoir remarqué que les différents rameaux
des montagnes éprouvent une déclinaison
progressive àmesure qu’ils s’éloignent de leur origine
, il ajoutait : O n r em a r q u e , e n o u t r e , q u a u
p o in t d 'a t ta c h e d e d e u x o u p lu s ie u r s c o n tr e -fo r ts ,
i l y a to u jo u r s r e lèv em en t. M. Andreossy , après
avoir rappelé ces observations de d’Arçon, y insiste
fortement dans ses C o n s id é r a tio n s s u r la g é o g
r a p h ie p h y s iq u e , déjà citées.
C’est principalement de la forme des cimes
que dépend l ’aspect général des chaînes. Chaque
chaîne en a une qui semble plus particulière , et
qui est en quelque sorte caractérisée par le nom
qu’elle porte, suivant l’observation de Dolomieu :
c’est ainsi que dans les Alpes , des cimes aiguës ,
semblables à d’immenses obélisques, y sonlconnues
sous le nom à1 a ig u ille s ; que dans les Pyrénées
on a des p ic s ou énormes masses de rochers présentant
de toutes parts des faces escarpées ; que
dans les Vosges on a un grand nombre de b a llo n s
ou cimes de forme arrondie (i).
Ces diverses formes tiennent beaucoup à la nature
minéralogique des montagnes qui les présentent
, ainsi qu’à la position des couches. C’est
principalement dans les parties granitiques ou
(ï) Journal des mines, n° 4ci.
primitives et à couches verticales , que les Alpes
présentent ces hautes crêtes déchirées de toutes
parts , portant, comme une énorme dentelure ,
des suites de pyramides ou aiguilles gigantesques :
objets qui constituent en quelque sorte le caractère
alpin des montagnes : c’est encore dans les
granités du Haut-Vivarais que l ’on voit des montagnes
décharnées, d’immenses pans de murailles
terminés par des arêtes tranchantes , et comprenant
entre eux d’horribles précipices. Les Pyrénées
, formées d’un mélange de granité et de
schistes granitiques, auront des cimes plus arrondies
et plus piales : de là les nombreux pics et
les grands plateaux ou longues terrasses qui y
règnenl souvent au-dessus des hautes sommités.
Les montagnes de la Saxe, consistant en gneiss
tendres et en schistes phyllades , présenteront
presque par-tout des pentes douces, et ne seront
en quelque sor te qu’un terrain mollement ondulé ;
de loin à loin ) quelques masses porphyriques élèveront
une tête arrondie et quelques plateaux basaltiques
s’apercevront à deux ou trois cents mètres
au-dessus du sol environnant. Les Cevennes, formées
de calcaire en couches horizontales ne présentent
presque par-tout qu’une suite de plateaux ;
elles ne sont en quelque sorte qu’une grande masse
découpée, par les vallées et vallons qui les traversent,
en masses plus petites, prismatiques, et dont
la partie supérieure est plate et horizontale.