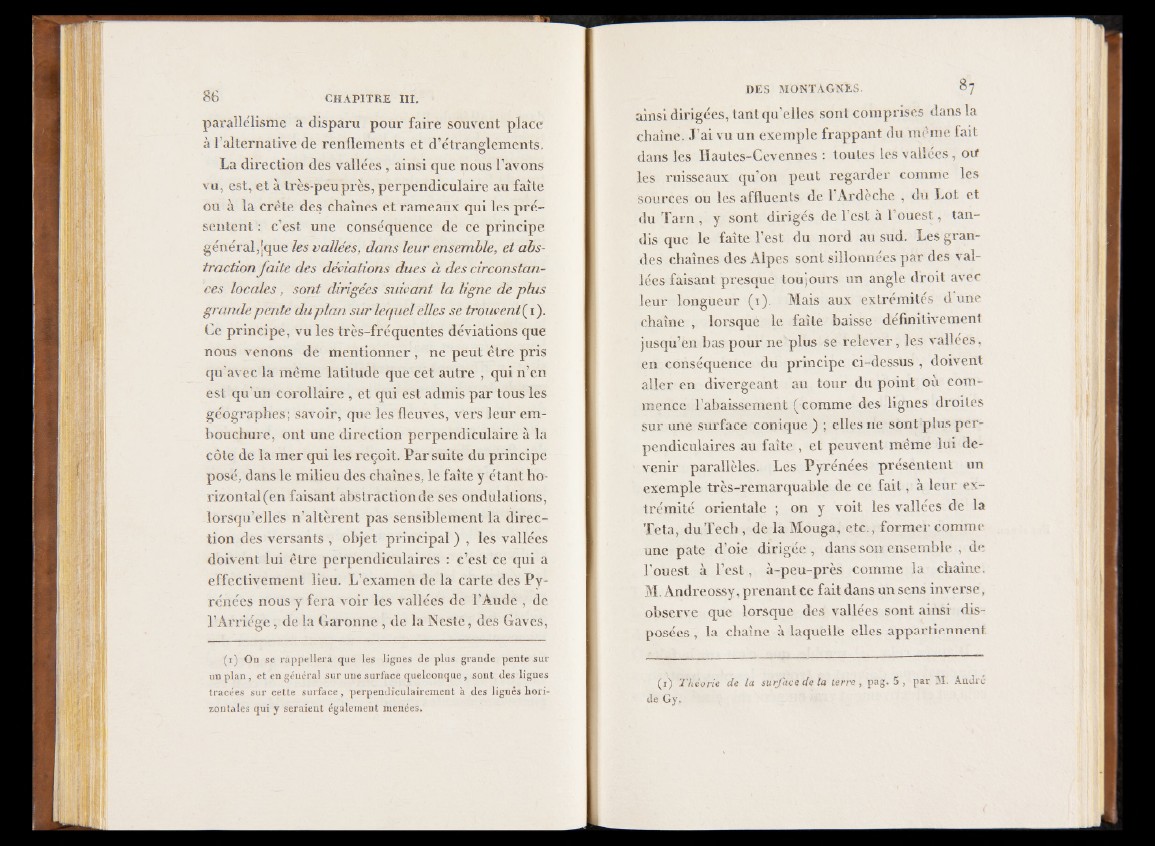
parallélisme a disparu pour faire souvent place
à l’alternative de renflements et d’étranglements.
La direction des vallées , ainsi que nous l’avons
vu, est, et à très-peu près, perpendiculaire au faîte
ou à la crête des chaînes et rameaux qui les présentent
: c’est une conséquence de ce principe
général,[que le s v a llé e s , d a n s le u r en s em b le , e t a b s tr
a c tio n f a i t e d e s d é v ia tio n s d u e s à d e s c ir c o n s ta n c
e s lo c a le s , s o n t d ir ig é e s su iv a n t la lig n e d e p lu s
g r a n d e p e n te d u p la n s u r le q u e l e lle s s e tro u v en t (i).
Ce principe, vu les très-fréquentes déviations que
nous venons de mentionner , ne peut être pris
qu’avec la même latitude que cet autre , qui n’en
est qu’un corollaire , et qui est admis par tous les
géographes; savoir, que les fleuves, vers leur embouchure,
ont une direction perpendiculaire à la
côte de la mer qui les reçoit. Par suite du principe
posé, dans le milieu des chaînes, le faîte y étant horizontal
(en faisant abstraction de ses ondulations,
lorsqu’elles n’altèrent pas sensiblement la direction
des versants , objet principal ) , les vallées
doivent lui être perpendiculaires : c’est ce qui a
effectivement lieu. L’examen de la carte des Pyrénées
nous y fera voir les vallées de l’Aude , de
l ’Arriége, de la Garonne , de la Neste, des Gaves,
(iV On se rappellera que les lignes de plus grande pente sur
un plan , et en général sur une surface quelconque , sont des lignes
tracées sur cette surface, perpendiculairement à des lignés horizontales
qui y seraient également menées.
ainsi dirigées, tant qu’elles sont comprises dans la
chaîne. J’ai vu un exemple frappant du même fait
dans les Hautes-Cevennes : toutes les vallées , otf
les ruisseaux qu’on peut regarder comme les
sources ou les affluents de l’Ardèche , du Lot et
du Tarn , y sont dirigés de l’est à l ’ouest, tandis
que le faîte l’est du nord au sud. Les grandes
chaînes des Alpes sont sillonnées par des vallées
faisant presque toujours un angle droit avec
leur longueur (1). Mais aux extrémités d une
chaîne , lorsque le faîte baisse définitivement
jusqu’en bas pour ne plus se relever, les vallées,
en conséquence du principe ci-dessus , doivent
aller en divergeant au tour du point où commence
l ’abaissement ( comme des lignes droites
sur une surface conique ) ; elles ne sont plus perpendiculaires
au faîte , et peuvent même lui devenir
parallèles. Les Pyrénées présentent un
exemple très-remarquable de ce fa it , à leur extrémité
orientale ; on y voit les vallées de la
Teta, du Tech , de la Mouga, etc., former comme
une pâte d’oie dirigée , dans son ensemble , de
l ’ouest à l’est, à-peu-près comme la chaîne.
M. Andreossy, prenant ce fait dans un sens inverse,
observe que lorsque des vallées sont ainsi disposées
, la chaîne à laquelle elles appartiennent
(1) Théorie de la surface de la terre, pag. 5 , par M. Audré
de Gy.