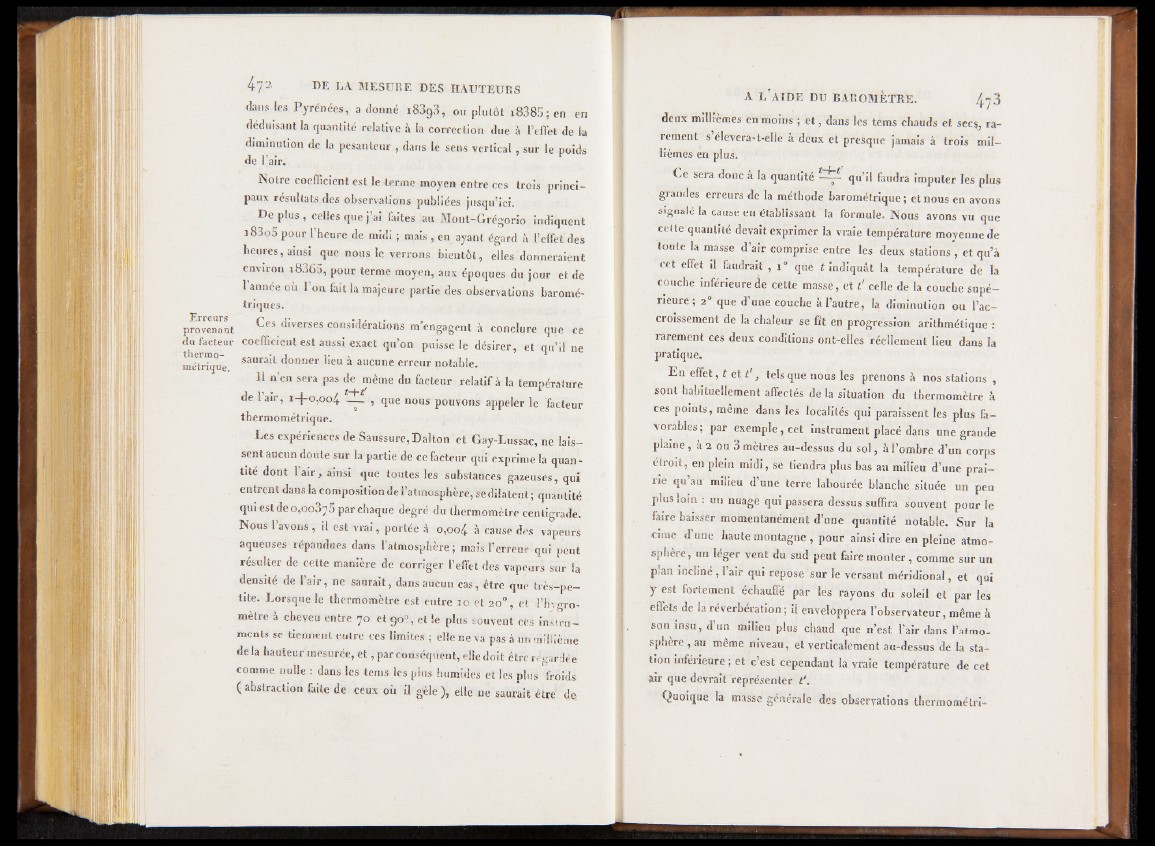
Erreurs
provenant
du facteur
thermométrique.
4 7 2 DE EA MESURE DES HAUTEURS
dans les Pyrénées, a donné i8393, ou plutôt i 8385; en en
déduisant la quantité relative à la correction due à l’effet de la
diminution de la pesanteur , dans le sens vertical , sur le poids
de l ’air.
Notre coefficient est le terme moyen entre ces trois principaux
résultats des observations publiées jusqu’ici.
De plus , celles que j ai faites au Mont-Grégorio indiquent
i 83o5 pour l’heure de midi ; mais , en ayant égard à l’effet des
heures, ainsi que nous le verrons bientôt, elles donneraient
environ i 8365, pour terme moyen, aux époques du jour et de
l’année où l ’on fait la majeure partie des observations barométriques.
Ces diverses considérations m’engagent à conclure que ce
coefficient est aussi exact qu’on puisse le désirer, et qu’il ne
saurait donner lieu à aucune erreur notable.
Il n’en sera pas de même du facteur relatif à la température
i 11 • 1 t
ae la ir , i-f-0,004 _ _ , que nous pouvons appeler le facteur
thermométrique.
Les expériences de Saussure, Dalton et Gay-Lussac, ne laissent
aucun doute sur la partie de ce facteur qui exprime la quantité
dont 1 air ^ ainsi que toutes les substances gazeuses, qui
entrent dans la composition de l’atmosphère, se dilatent; quantité
qui est de 0,00875 par chaque degré du thermomètre centigrade.
Nous l’avons, il est vrai, portée à 0,004 à cause des vapeurs
aqueuses répandues dans l’atmosphère; mais l’erreur qui peut
résulter de cette manière de corriger l’effet des vapeurs sur la
densité de 1 a ir, ne saurait, dans aucun cas, être que très-petite.
Lorsque le thermomètre est entre 10 et 20% et l’hygromètre
à cheveu entre 70 et 90% et le plus souvent cès instruments
se tiennent entre ces limites ; elle ne va pas à un millième
delà hauteur mesurée, e t , par conséquent, elle doit être régardée
comme nulle : dans les tems les plus humides et les plus froids
( abstraction faite de ceux où il gèle ), elle ne saurait être de
deux millièmes en moins ; e t , dans les tems chauds et sec$, rarement
s élevera-t-elle à deux et presque jamais à trois millièmes
en plus.
Ce sera donc a la quantité qu’il faudra imputer les plus
grandes erreurs de la méthode barométrique ; et nous en avons
signalé la cause en établissant la formule. Nous avons vu que
cette quantité devait exprimer la vraie température moyenne de
toute la masse d’air comprise entre les deux stations , et qu’à
cet effet il faudrait , i° que t indiquât la température de la
couche inférieure (ie cette masse, et t' celle de la couche supérieure
; 20 que d’une couche à l’autre, la diminution ou l’accroissement
de la chaleur se fît en progression arithmétique :
rarement ces deux conditions ont-elles réellement lieu dans la
pratique.
En effet, t et t ' , tels que nous les prenons à nos stations ,
sont habituellement affectés de la situation du thermomètre à
ces points, même dans les localités qui paraissent les plus favorables
; par exemple, cet instrument placé dans une grande
plaine , a 2 ou 3 mètres au-dessus du so l, à l’ombre d’un corps
étroit, en plein midi, se tiendra plus bas au milieu d’une prairie
qu’au milieu d’une terre labourée blanche située un peu
plus loin : un nuage qui passera dessus suffira souvent pour le
faire baisser momentanément d’une quantité notable. Sur la
cime d’une haute montagne , pour ainsi dire en pleine atmosphère,
un léger vent du sud peut faire monter, comme sur un
pian incliné , 1 air qui repose sur le versant méridional, et qui
y est fortement échauffé par les rayons du soleil et par les
effets de la réverbération ; il enveloppera l’observateur, même à
son insu, d un milieu plus chaud que n’est l’air dans l’atmosphère
, au meme niveau, et verticalement au-dessus de la station
intérieure ; et c’est cependant la vraie température de cet
air que devrait représenter t'.
Quoique la masse générale des observations thermométri