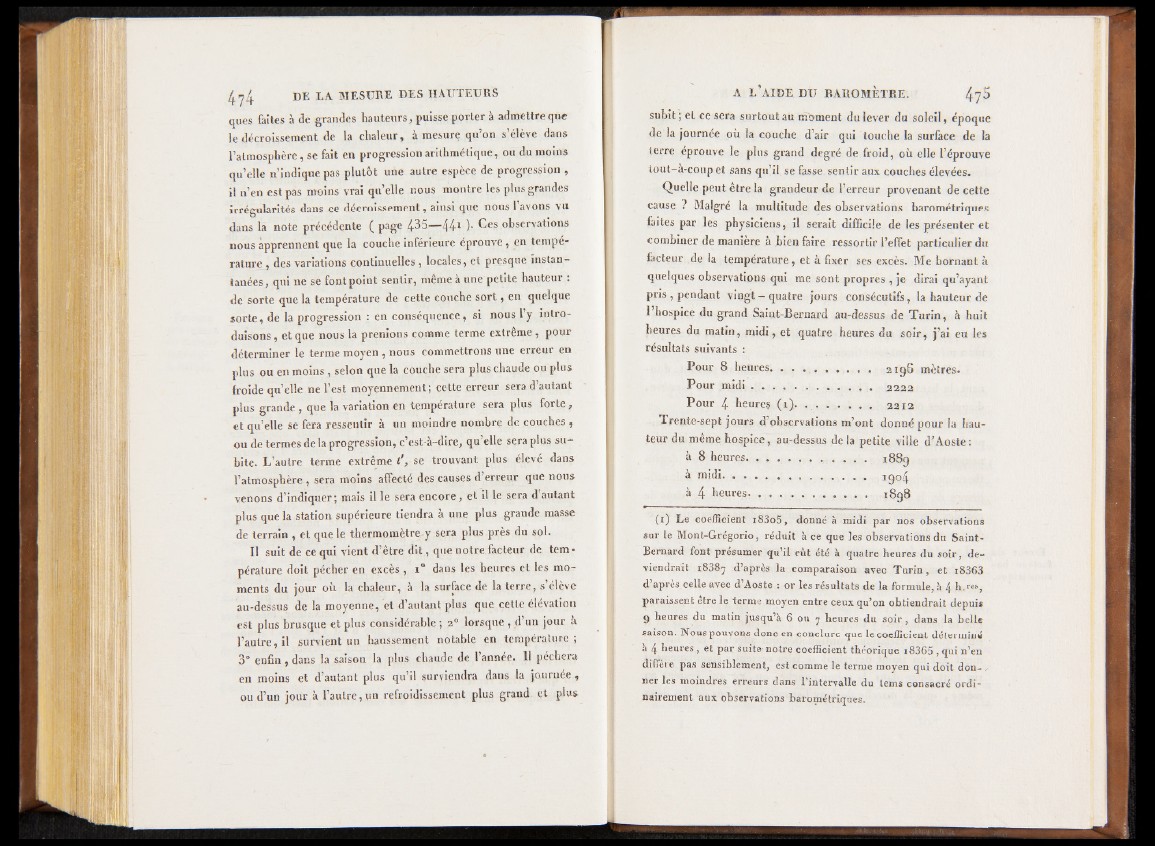
k lk
ques faites à de grandes hauteurs, puisse porter à admettre que
le décroissement de la chaleur, à mesure qu’on s’élève dans
l ’atmosphère, se fait en progression arithmétique, ou du moins
qu’ elle n’indique pas plutôt une autre espèce de progression ,
il n’en est pas moins vrai qu’elle nous montre les plus grandes
irrégularités dans ce décroissement, ainsi que nous l’avons vu
dans la note précédente ( page 4-35— 44-1 )■ Ces observations
nous apprennent que la couche inférieure éprouve, en température
, des variations continuelles , locales, et presque instantanées,
qui ne se font point sentir, meme a une petite hauteur .
de sorte que la température de cette couche so r t, en quelque
sorte, de la progression : en conséquence, si nous l’y introduisons
, et que nous la prenions comme terme extrême , pour
déterminer le terme moyen , nous commettrons une erreur en
plus ou en moins, selon que la couche sera plus chaude ou plus
froide qu’elle ne l’est moyennement; cette erreur sera d’autant
plus grande , que la variation en température sera plus forte,
et qu’elle se fera ressentir à un moindre nombre de couches ,
ou de termes de la progression, c’est-à-dire, qu’elle sera plus subite.
L ’autre terme extrême t', se trouvant plus élevé dans
l’atmosphère , sera moins affecté des causes d’erreur que nous
venons d’indiquer; mais il le sera encore, et il le sera d autant
plus que la station supérieure tiendra à une plus grande masse
de terrain , et que le thermomètre-y sera plus près du sol.
Il suit de ce qui vient d’être d it, que notre facteur de température
doit pécher en excès , i° dans les heures et les moments
du jour où la chaleur, à la surface de la terre, s’élève
au-dessus de la moyenne, et d’autant plus que cette élévation
est plus brusque et plus considérable ; i° lorsque , d’un jour à
l’autre, il survient un haussement notable en température;
3° enfin, dans la saison la plus chaude de l’année. 11 péchera
en moins et d’autant plus qu’il surviendra dans la journée ,
ou d’un jour à l’autre,un refroidissement plus grand et plus
subît; et ce sera surtout au nitvment du lever du soleil, époque
de la journée où la couche d’air qui touche la surface de la
terre éprouve le plus grand degré de froid, où elle l’éprouve
tout-à-coup et sans qu’il se fasse sentir aux couches élevées.
Quelle peut être la grandeur de l’erreur provenant de cette
cause ? Malgré la multitude des observations barométriques
faites par les physiciens, il serait difficile de les présenter et
combiner de manière à bien faire ressortir l’effet particulier du
facteur de la température, et à fixer ses excès. Me bornant à
quelques observations qui me sont propres , je dirai qu’ayant
pris , pendant vingt-quatre jours consécutifs, la hauteur de
1 hospice du grand Saint-Bernard au-dessus de Turin, à huit
heures du matin, midi, et quatre heures du soir, j ’ai eu les
résultats suivants :
Pour 8 heures. . . . . . . . . . 2196 mètres.
Pour m id i..............................................
Pour 4- heures (1). . . . . . . . 2212
Trente-sept jours d’observations m’ont donné pour la hauteur
du même hospice, au-dessus de la petite ville d’Aoste :
à 8 heures........................................ 1889
à midi............................................... igo4
à 4 heures..................... 1898
(1) Le coefficient i 83o5 , donné à midi par nos observations
sur le Mont-Grégorio, réduit à ce que les observations du Saint-
Bernard font présumer qu’il eût été à quatre heures du soir, deviendrait
18387 d’après la comparaison avec Turin, et i 8363
d’après celle avec d’Aoste : or les résultats de la formule, à 4 h.™»,
paraissent être le terme moyen entre ceux qu’on obtiendrait depuis
9 heures du matin jusqu’à 6 ou 7 heures du soir , dans la belle
saison. Nous pouvons donc en conclure que le coefficient déterminé
à 4 heures, et par suite notre coefficient théorique i 8365,qui n’en
difïère. pas sensiblement, est comme le terme moyen qui doit don- ,
ner les moindres erreurs dans l’intervalle du tems consacré ordinairement
aux observations barométriques.