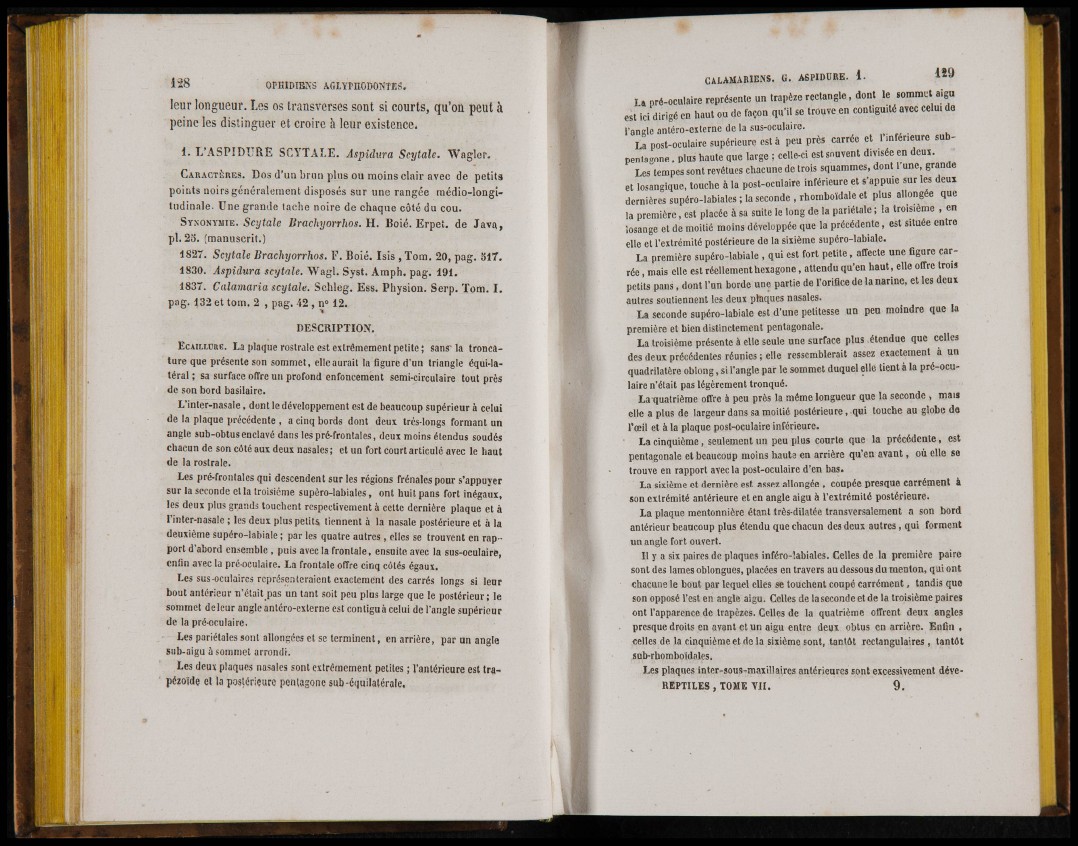
¡i; lil! I h I ;
128 OriîIDIKKS AOLYPnODONTES,
leur longueur. Les os transverses sont si courts, qu'on peut à
peine les distinguer et croire à leur existence.
1. L'ASPIDURE SCYTALE. Aspidnra Scytale. Wagler.
CARACTÈRES. DOS d'un brun plus OU moins clair avec de petits
points noirs généralement disposés sur une rangée médio-longitudinale.
Une grande tache noire de chaque côté du cou.
SYNONYMIE. Scytale Brachyorrhos. U. Boié. Erpet. de Java,
pl. 2o. [manuscrit.)
1827. Scytale Brachyorrhos. F. Boié. Isis ,Tom. 20, pag. 317.
1S30. Aspidura scytale. Wagl. Syst. Amph. pag. 191.
1837. Calamaria scytale. Schleg. Ess. Physion. Serp. Tom. I.
pag. 132 et torn. 2 , pag. h i , n" 12.
DESCRIPTION.
EcAiLr,cne. La plaque rostrale est extrêmement petite ; sans- la troncature
que présente son sommet, elle aurait la figure d'un triangle équi-latéral
; sa surface offre un profond enfoncement semi-circulaire tout près
de son bord basilaire.
L'inter-nasale, dont le développement est de beaucoup supérieur à celui
de la plaque précédente , a cinq bord« dont deux trés-longs formant un
angle sub-obtus enclavé dans les pré-frontales, deux moins étendus soudés
chacun de son côté aux deux nasales ; et un fort court articulé avec le haut
de la rostrale.
Les pré-frontales qui descendent sur les régions frênaies pour s'appuyer
sur la seconde et la troisième supèro-labiales, ont huit pans fort inégaux,
les deux plus grands touchent respectivement à cette dernière plaque et à
l'inter-nasale ; les deux plus petits, tiennent à la nasale postérieure et à la
deuxième supéro-labiale ; par les quatre autres , elles se trouvent en rap -
port d'abord ensemble , puis avec la frontale, ensuite avec la sus-oculairè,
enfin avec la pré-oculaire. La frontale offre cinq côtés égaux.
Les sus-oculaircs représenteraient exactement des carrés longs si leur
bout antérieur n'étalt pas un tant soit peu plus large que le postérieur; le
sommet delcur angle antéro-externe est contigua celui de l'angle supérieur
de la pré-oculaire.
Les pariétales sont allongées et se terminent, en arrière, par un angle
sub-aigu à sommet arrondi.
Les deux plaques nasales sont extrêmement petites ; l'antérieure est trapézoïde
et la postérieure pen(agone sub-équilatéraie.
CALAMARIENS. G. ASPIDURE. 1.
La pré-oculaire représente un trapèze rectangle, dont le somm^ aigu
est ici dirigé en haut ou de façon qu'il se trouve en contiguïté avec celui da
l'anele antéro-externe de la sus-oculaire.
La post-oculaire supérieure est à peu près carrée et hnféneure subpenta
one, plus haute que large ; celle-ci est souvent divisée en deux.
Les tempes sont revêtues chacune de trois squammes, dont l'une, grande
et losangique, touche à la post-oculaire inférieure et s'appuie sur les deux
dernières supéro-labiales; la seconde, rhomboïdale et plus allongée que
la première, est placée à sa suite le long de la pariétale ; la troisième , en
losange et de moitié moins développée que la précédente, est située entre
elle et l'extrémité postérieure de la sixième supéro-labiale.
La première supéro-labiale , qui est fort petite, affecte une figure carrée
, mais elle est réellement hexagone, attendu qu'en haut , elle offre trois
petits pans, dont l'un borde une partie de l'orifice de la narine, et les deux
autres soutiennent les deux plaques nasales.
La seconde supéro-labiale est d'une petitesse un peu moindre que la
première et bien distinctement pentagonale.
La troisième présente à elle seule une surface plus étendue que celles
des deux précédentes réunies ; elle ressemblerait assez exactement à un
quadrilatère oblong, si l'angle par le sommet duquel elle tient à la pré-oculaire
n'était pas légèrement tronqué.
La quatrième offre à peu près la même longueur que la seconde , mais
elle a plus de largeur dans sa moitié postérieure, qui touche au globe da
l'oeil et à la plaque post-oculaire inférieure.
La cinquième, seulement un peu plus courte que la précédente, est
pentagonale et beaucoup moins haute en arrière qu'en avant, où elle se
trouve en rapport avec la post-oculaire d'en bas.
La sixième et dernière est assez allongée , coupée presque carrément à
son extrémité antérieure et en angle aigu à l'extrémité postérieure.
La plaque mentonnière étant très-dilatée transversalement a son bord
antérieur beaucoup plus étendu que chacun des deux autres, qui forment
un angle fort ouvert.
Il y a six paires de plaques inféro-labiales. Celles de la première paire
sont des lames oblongues, placées en travers au dessous du menton, qui ont
chacune le bout par lequel elles se touchent coupé carrément, tandis que
son opposé l'est en angle aigu. Celles de la seconde et de la troisième paires
ont l'apparence de trapèzes. CeUes de la quatrième otrrent deux angles
presque droits en avant et un aigu entre deux obtus en arrière. Enfin ,
celles de la cinquième et de la sixième sont, tantôt rectangulaires , tantôt
sub-rhomboïdales.
Les plaques inter-sous-maxillaires antérieures sont excessivement déve-
HEPTILES , TOME VJI. 9,