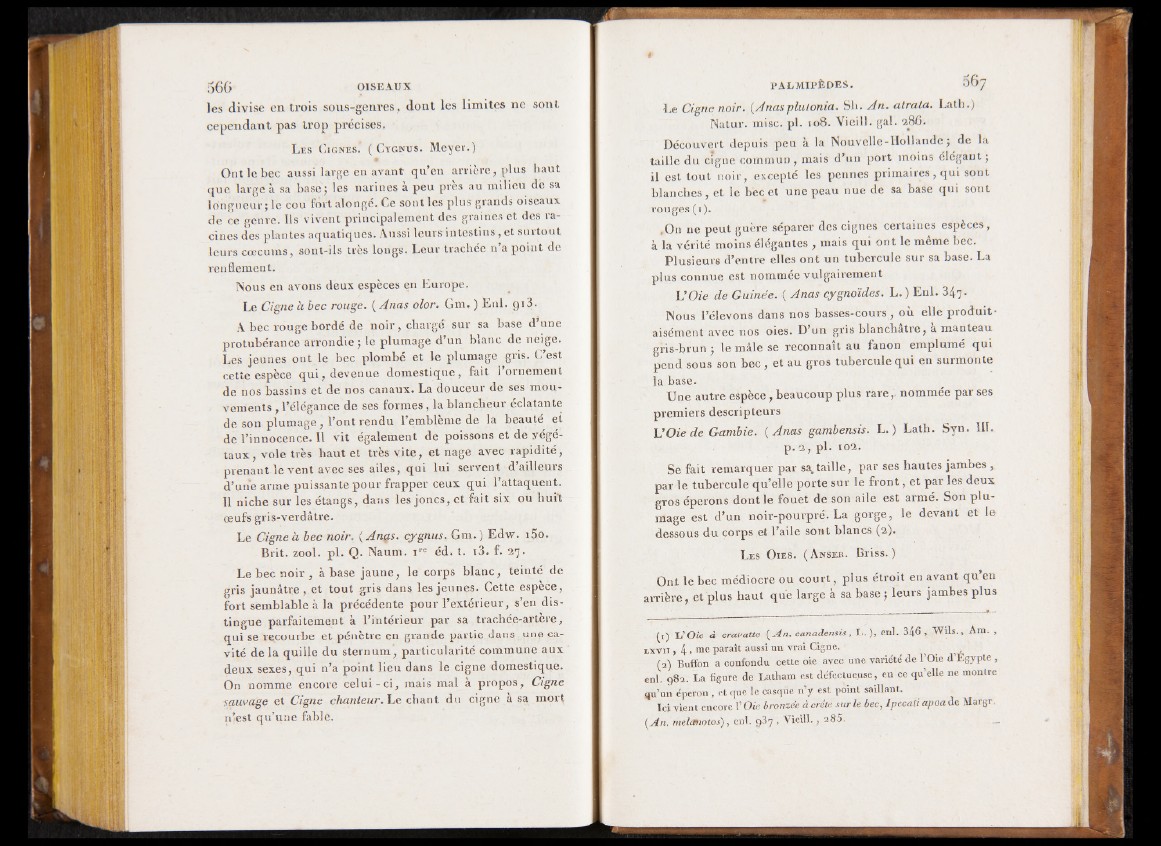
5 6 6 o is e a u x
les divise en trois sous-genres, d o n t les limites ne sont
cep en d an t pas tro p précises.
L es Oignes.' ( C ygnus. Meyer.)
Ont le bec aussi large en avant qu’en arrière, plus haut
que large à sa base ; les narines à peu près au milieu de sa
longueur; le cou fort alongé. Ce sont les plus grands oiseaux
de ce genre. Ils vivent principalement des graines et des racines
des plantes aquatiques. Aussi leurs intestins, et surtout
leurs cæcums, sont-ils très longs. Leur trachée n a point de
renflement.
Nous en avons deux espèces en Europe.
Le Cigne à bec rouge. ( Anas olor. Gm. ) Enl. g i3.
A bec rouge bordé de n o ir, chargé sur sa base d une
protubérance arrondie; le plumage d’un blanc de neige.
Les jeunes ont le bec plombé et le plumage gris. C’est
cette espèce q u i, devenue domestique, fait 1 ornement
de nos bassins et de nos canaux. La douceur de ses mouvements
, l’élégance de ses formes, la blancheur éclatante
de son plumage, l’ont rendu l’emblème de la beauté et
de l’innocence. Il vit également de poissons et de végéta
u x , vole très haut et très v ite , et nage avec rapidité,
prenant le vent avec ses ailes, qui lui servent d’ailleurs
d’une arme puissante pour frapper ceux qui l’attaquent.
Il niche sur les étangs, dans les joncs, et fait six ou huit
oeufs gris-verdâtre.
Le Cigne a bec noir. (Ançts. cygnus. Gm.) Edw. i 5o.
Brit. zool. pl. Q. Naum. i re éd. t. t 3. f. 27.
Le bec noir , à base jau n e , le corps blanc, teinté de
gris jau n â tre , et tout gris dans les jeunes. Cette espèce,
fort semblable à la précédente pour l’extérieur, s’en distingue
parfaitement à l’intérieur par sa trachée-artère,
qui se rqcourbe et pénètre en grande partie dans une cavité
de la quille du sternum, particularité commune aux
deux sexes, qui n’a point lieu dans le cigne domestique.
On nomme encore c e lu i-c i, mais mal à propos, Cigne
sauvage et Cigne chanteur. "Le, chant du cigne à sa mort
n’est qu’une fable.
PALMIPÈDES.
Le Cigne noir. (Anas plut onia. Sli. An. atrata. Lath.)
Natur. mise. pl. 108. Vieill. gai. 286.
Découvert depuis peu à la Nouvelle-Hollande; de la
taille du cigne commun , mais d’un port moins élégant ;
il est tout noir, excepté les pennes primaires, qui sont
blanches, et le bec et une peau nue de sa base qui sont
rouges (1).
,On ne peut guère séparer des cignes certaines espèces,
à la vérité moins élégantes , mais qui ont le même bec.
Plusieurs d’entre elles ont un tubercule sur sa base. La
plus connue est nommée vulgairement
L’Oie de Guinée. | Anas cygnoïdes. L. ) Enl. 347.
Nous l’élevons dans nos basses-cours, où elle produit-
aisément avec nos oies. D’un gris blanchâtre, a manteau
gris-brun ; le mâle se reconnaît au fanon emplumé qui
pend sous son b e c , et au gros tubercule qui en surmonte
la base.
Une autre espèce, beaucoup plus rare,, nommée par ses
premiers descripteurs
L’Oie de Gambie. (Anas gambensis. L. ) Lath. Syn. IIL.
p. 2 , pl. 102.
Se fait remarquer par sa^ taille, par ses hautes jambes ,
par le tubercule qu’elle porte sur le fro n t, et par les deux
gros éperons dont le fouet de son aile est armé. Son plu mage
est d’un noir-pourpré. La gorge, le devant et le
dessous du corps et l’aile sont blancs (2).
L es O ies. (A nser. Briss. )
Ont le bec médiocre ou co u rt, plus étroit en avant qu’en
arrière, et plus haut que large à sa base ; leurs jambes plus
(1) VOie à cravatas (A n . canadensis, L. ), enl. 3 4 6 , Wils., Am. ,
lxvii , 4 > me P81-3*1 aussi Ul1 vrai Cigne. _
(a) Buffon a confondu cette oie avec une variété de l’Oie d’Egypte ,
enl. 982. La figure de Latham est défectueuse, en ce qu’elle ne montre
qu’un éperon , et que le casque n’y est point saillant.
Ici vient encore l’Oie bronzée ci crête sur le bec, lpecati apoa de Margr.
(An. meldnotos'), enl. 937 , Vieill., 285.