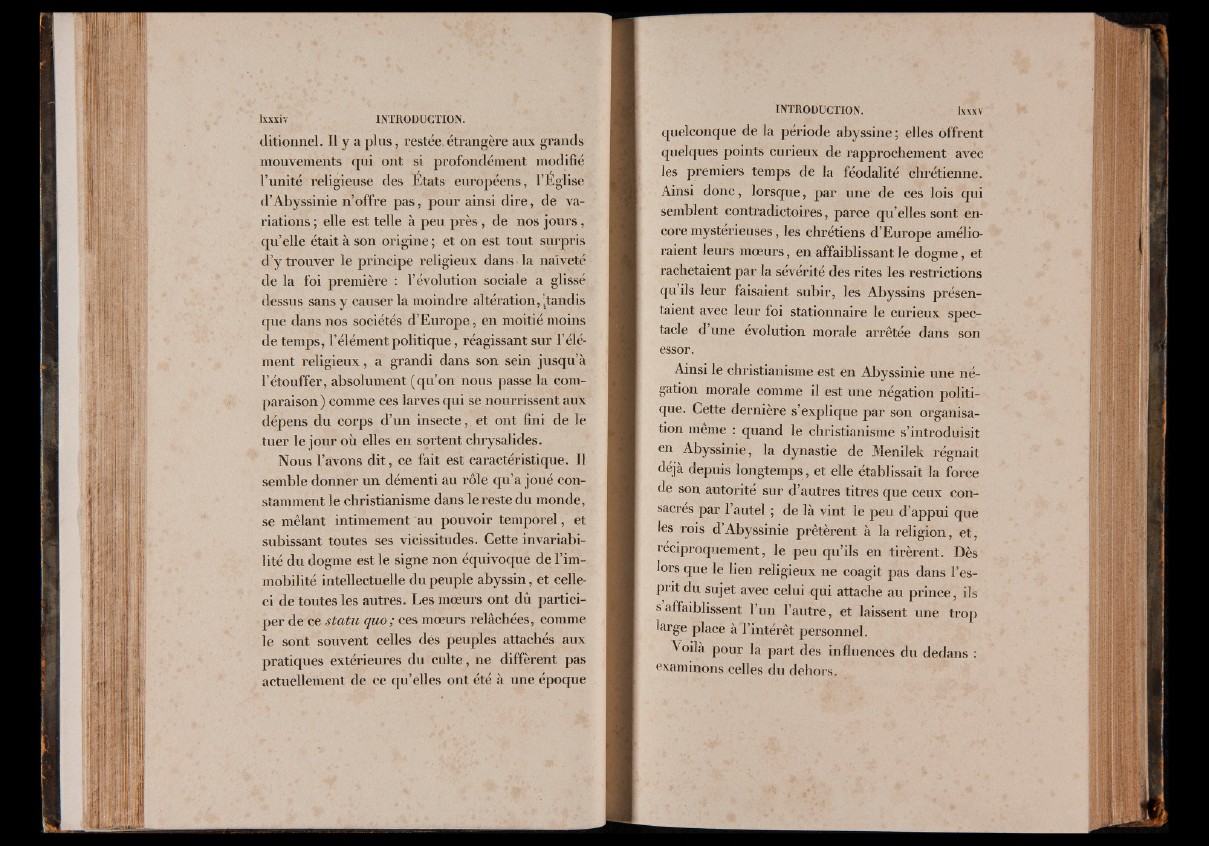
ditionnel. Il y a plus, restée, étrangère aux grands
mouvements qui ont si profondément modifié
l’unité religieuse des Etats européens, l’Eglise
d’Abyssinie n’offre pas, pour ainsi dire, de variations
; elle est telle à peu près , de nos jours,
qu’elle était à son origine; et on est tout surpris
d’y trouver le principe religieux dans ■ la naïveté
de la foi première : l’évolution sociale a glissé
dessus sans y causer la moindre altération, ^tandis
que dans nos sociétés d’Europe, en moitié moins
de temps, l’élément politique, réagissant sur l’élément
religieux, a grandi dans son sein jusqu’à
l’étouffer, absolument (qu’on nous passe la comparaison
) comme ces larves qui së nourrissent aux
dépens du corps d’un insecte,, et ont fini de le
tuer le jour où elles en sortent chrysalides.
Nous l’avons d it, ce fait est caractéristique. Il
semble donner un démenti au rôle qu’a joué constamment
le christianisme dans le reste du monde,
se mêlant intimement au pouvoir temporel, et
subissant toutes ses vicissitudes. Cette invariabilité
du dogme est le signe non équivoque de l’immobilité
intellectuelle du peuple abyssin, et celle-
ci de toutes les autres. Les moeurs ont dû participer
de ce statu quo; ces moeurs relâchées, comme
le sont souvent celles dés peuples attachés aux
pratiques extérieures du cülte, ne diffèrent pas
actuellement de ce qu’elles ont été à une époque
quelconque de la période abyssine; elles offrent
quelques points curieux de rapprochement avec
les premiers temps de la féodalité chrétienne.
Ainsi donc, lorsque, par une de ces lois qui
semblent contradictoires, parce qu’elles sont encore
mystérieuses, les chrétiens d’Europe amélioraient
leurs moeurs, en affaiblissant le dogme, et
rachetaient par la sévérité des rites les restrictions
qu’ils leur faisaient subir, les Abyssins présentaient
avec leur foi stationnaire le curieux spectacle
d une évolution morale arrêtée dans son
essor.
Ainsi le christianisme est en Abyssinie une négation
morale comme il est une négation politique.
Cette dernière s’explique par son organisation
même : quand le christianisme s’introduisit
en Abyssinie, la dynastie de Menilek régnait
déjà depuis longtemps , et elle établissait la force
de son autorité sur d’autres titres que ceux consacres
par l’autel ; de là vint le peu d’appui que
les rois d Abyssinie prêtèrent à la religion, e t,
réciproquement, le peu qu’ils en tirèrent. Dès
lors que le lien religieux ne coagit pas dans l’esprit
du sujet avec celui qui attache au prince, ils
s affaiblissent l’un l’autre, et laissent une trop
large place à l’intérêt personnel.
Voilà pour la part dés influences du dedans :
examinons celles du dehors.