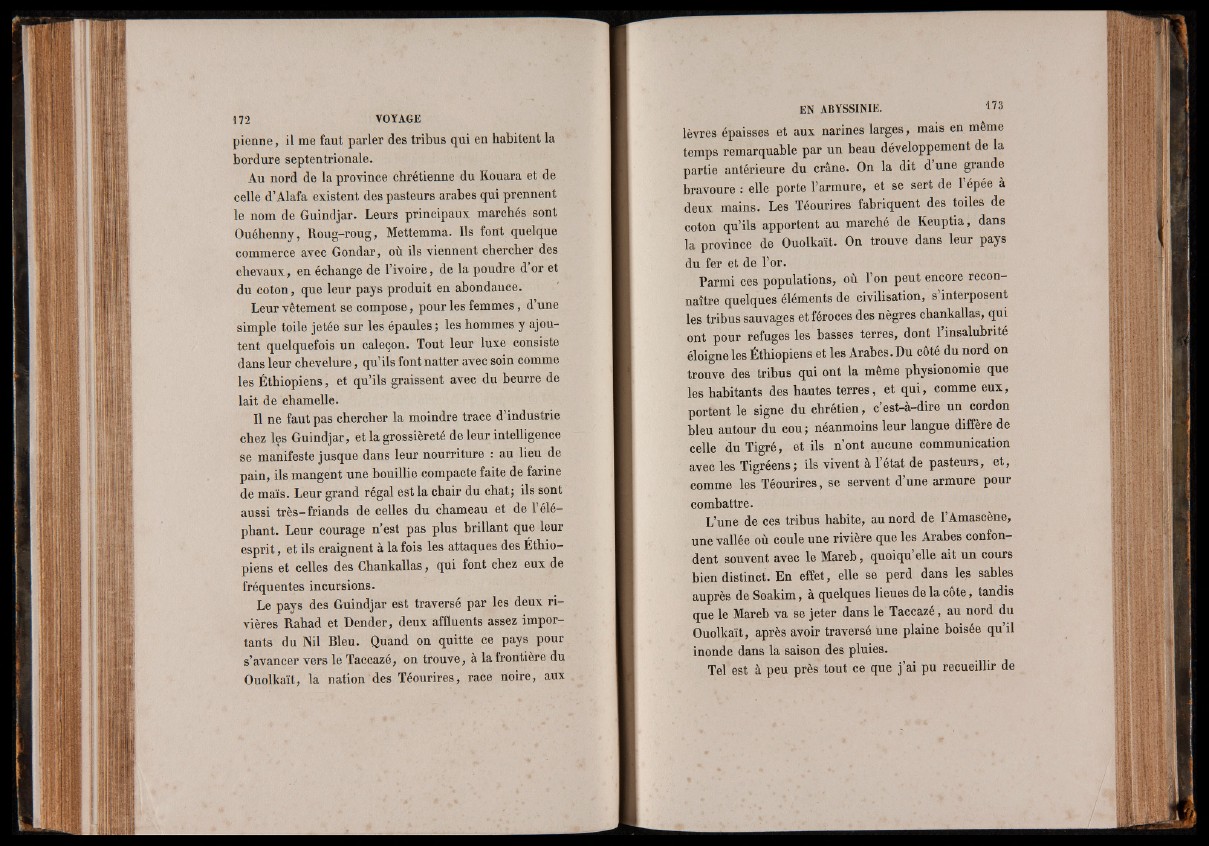
pienne, il me faut parler des tribus qui eu habitent la
bordure septentrionale.
Au nord de la province chrétienne du Kouara et de
celle d’Alafa existent des pasteurs arabes qui prennent
le nom de Guindjar. Leurs principaux marchés sont
Ouéhenny, Roug-roug, Mettemma. Ils font quelque
commerce avec Gondar, où ils viennent chercher des
chevaux, en échange de l’ivoire, de la poudre d or et
du coton, que leur pays produit en abondance.
Leur vêtement se compose, pour les femmes, d une
simple toile jetée sur les épaules ; les hommes y ajoutent
quelquefois un caleçon. Tout leur luxe consiste
dans leur chevelure, qu’ils font natter avec soin comme
les Éthiopiens, et qu’ils graissent avec du beurre de
lait de chamelle.
Il ne faut pas chercher la moindre trace d’industrie
chez les Guindjar, et la grossièreté de leur intelligence
se manifeste jusque dans leur nourriture : au lieu de
pain, ils mangent une bouillie compacte faite de farine
de maïs. Leur grand régal est la chair du chat; ils sont
aussi très-friands de celles du chameau et de l’éléphant.
Leur courage n’est pas plus brillant que leur
esprit, et ils craignent à la fois les attaques des Éthiopiens
et celles des Chankallas, qui font chez eux de
fréquentes incursions.
Le pays des Guindjar est traversé par les deux rivières
Rahad et Dender, deux affluents assez importants
du Nil Bleu. Quand on quitte ce pays pour
s’avancer vers le Taccazé, on trouve, à la frontière du
Ouolkaït, la nation des Téourires, race noire, aux
lèvres épaisses et aux narines larges, mais en même
temps remarquable par un beau développement de la
partie antérieure du crâne. On la dit d’une grande
bravoure : elle porte l’armure, et se sert de l’épée à
deux mains. Les Téourires fabriquent des toiles de
coton qu’ils apportent au marché de Keuptia, dans
la province de Ouolkaït. On trouve dans leur pays
du fer et de l’or.
Parmi ces populations, où l’on peut encore reconnaître
quelques éléments de civilisation, s’interposent
les tribus sauvages et féroces des nègres chankallas, qui
ont pour refuges les basses terres, dont 1 insalubrité
éloigne les Éthiopiens et les Arabes. Du côté du nord on
trouve des tribus qui ont la même physionomie que
les habitants des hautes terres, et qui, comme eux,
portent le signe du chrétien, c’est-à-dire un cordon
bleu autour du cou ; néanmoins leur langue diffère de
celle du Tigré, et ils n’ont aucune communication
avec les Tigréens; ils vivent a 1 état de pasteurs, et,
comme les Téourires, se servent d’une armure pour
combattre.
L’une de ces tribus habite, au nord de l’Amascène,
une vallée où coule une rivière que les Arabes confondent
souvent avec le Mareb, quoiqu’elle ait un cours
bien distinct. En effet, elle se perd dans les sables
auprès de Soakim, à quelques lieues de la cote, tandis
que le Mareb va se jeter dans le Taccazé, au nord du
Ouolkaït, après avoir traversé une plaine boisée qu’il
inonde dans la saison des pluies.
Tel est à peu près tout ce que j’ai pu recueillir de