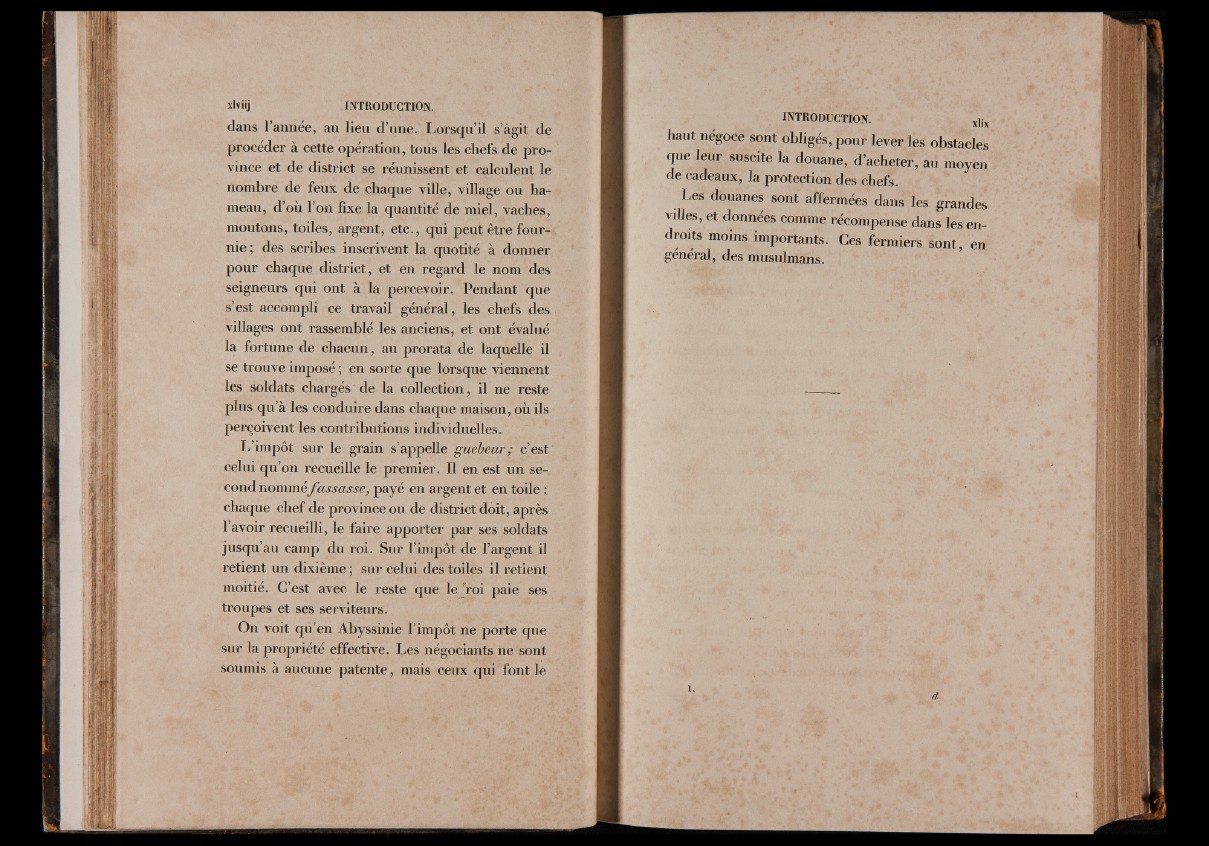
dans l’année, au lieu d’une. Lorsqu’il s’àgit de
procéder à cette opération, tous les chefs de province
et de district se réunissent et calculent le
nombre de feux de chaque ville, village ou hameau,
d’ou l’on fixe la quantité de miel, vaches,
moutons, toiles, argent, etc., qui peut être fournie;
des scribes inscrivent la quotité à donner
pour chaque district, et en regard le nom des
seigneurs qui ont à la percevoir. Pendant que
s’est accompli ce travail général, les chefs des
villages ont rassemblé les anciens, et ont évalué
la fortune de chacun, au prorata de laquelle il
se trouve imposé ; en sorte que lorsque viennent
les soldats chargés de la collection, il ne reste
plus qu’à les conduire dans chaque maison, où ils
perçoivent les contributions individuelles.
L’impôt sur le grain s’appelle guebeur; c’est
celui qu’on recueille le premier. Il en est un second
nommé fassasse, payé en argent et en toile :
chaque chef de province ou de district doit, après
l’avoir recueilli, le faire apporter par ses soldats
jusqu’au camp du roi. Sur l’impôt de l’argent il
retient un dixième ; sur celui des toiles il retient
moitié. C’est avec le reste que le roi paie ses
troupes et ses serviteurs.
On voit qu’en Abyssinie l’impôt ne porte que
sur la propriété effective. Les négociants ne sont
soumis à aucune patente, mais ceux qui font le
haut négoce sont obligés, pour lever les obstacles
que leur suscite la douane, d’acheter, au moyen
de cadeaux, la protection des chefs.
Les douanes sont affermées dans les grandes
villes, et données comme récompense dans les endroits
moins importants. Ces fermiers sont, en
général, des musulmans.