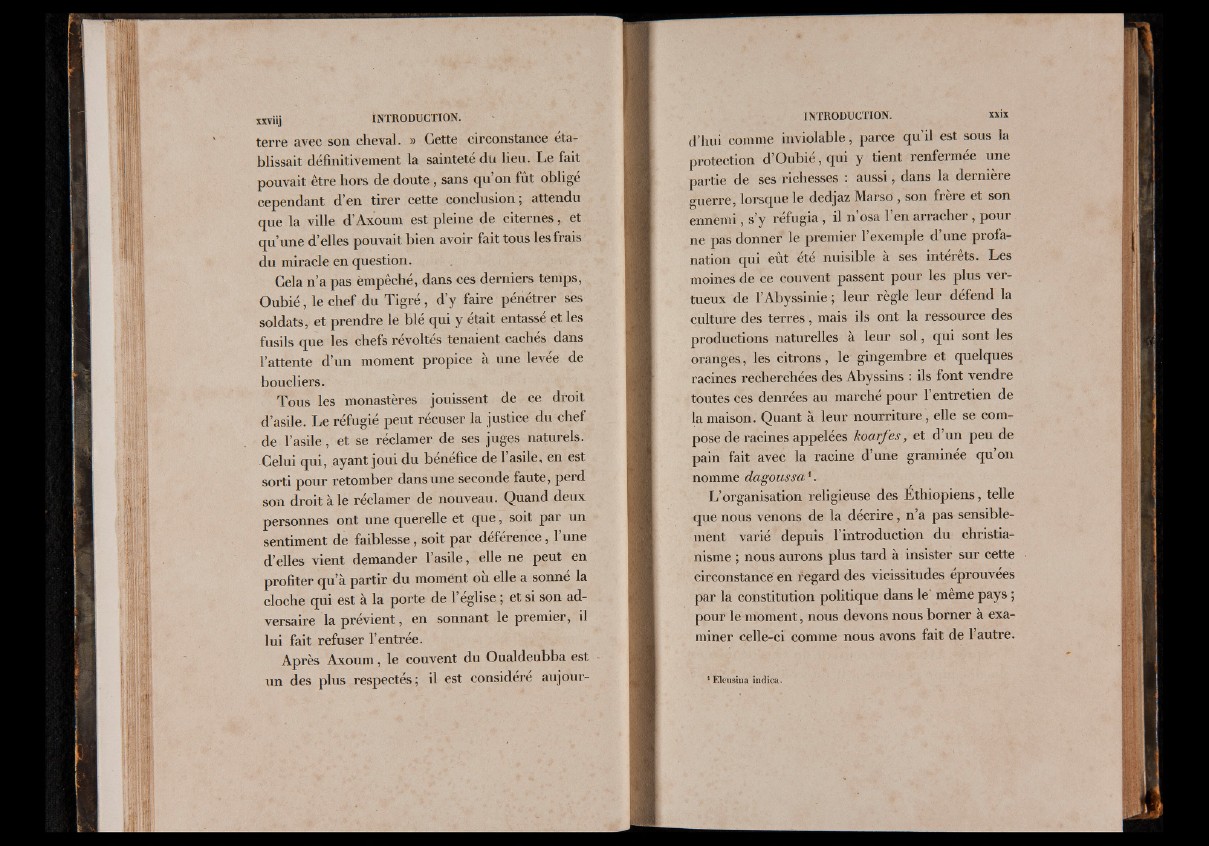
terre avec son cheval. » Cette circonstance établissait
définitivement la sainteté dù lieu. Le fait
pouvait être hors de doute, sans qu’on fût obligé
cependant d’en tirer cette conclusion; attendu
que la ville d’Axoum est pleine de citernes, et
qu’une d’elles pouvait bien avoir fait tous les frais
du miracle en question.
Cela n’a pas empêché, dans ces derniers temps,
Oubié, le chef du Tigré , d’y faire pénétrer ses
soldats, et prendre le blé qui y était entassé et les
fusils que les chefs révoltés tenaient cachés dans
l’attente d’un moment propice à une levée de
boucliers.
Tous les monastères jouissent de ce droit
d’asile. Le réfugié peut récuser la justice du chef
de l’asile, et se réclamer de ses juges naturels.
Celui qui, ayant joui du bénéfice de l’asile, en est
sorti pour retomber dans une seconde faute, perd
son droit à le réclamer de nouveau. Quand deux
personnes ont une querelle et q ue, soit par un
sentiment de faiblesse, soit par deference, 1 une
d’elles vient demander l’asile, elle ne peut en
profiter qu’à partir du moment où elle a sonné la
cloche qui est à la porte de l’église ; et si son adversaire
la prévient, en sonnant le premier, il
lui fait refuser l’entrée.
Après Axoum, le couvent du Oualdeubba est
un des plus respectés ; il est considéré aujourd’hui
comme inviolable, parce qu’il est sous la
protection d’Oubié, qui y tient renfermée une
partie de ses richesses : aussi, dans la dernière
guerre, lorsque le dedjaz Marso , son frère et son
ennemi, s’y réfugia , il n osa 1 en arracher , pour
ne pas donner le premier l’exemple d’une profanation
qui eût été nuisible à ses intérêts. Les
moines de ce couvent passent pour les plus vertueux
de l’Abyssinie ; leur règle leur défend la
culture des terres, mais ils ont la ressource des
productions naturelles à leur sol, qui sont les
oranges, les citrons, le gingembre et quelques
racines recherchées des Abyssins : ils font vendre
toutes ces denrées au marché pour l’entretien de
la maison. Quant à leur nourriture, elle se compose
de racines appelées koarfes, et d’un peu de
pain fait avec la racine d’une graminée qu’on
nomme dagoussa1.
L’organisation religieuse des Ethiopiens, telle
que nous venons de la décrire, n’a pas sensiblement
varié depuis l’introduction du christianisme
; nous aurons plus tard à insister sur cette
circonstance en regard des vicissitudes éprouvées
par la constitution politique dans le meme pays ;
pour le moment, nous devons nous borner à examiner
celle-ci comme nous avons fait de l’autre.
1 Eleusina indica.