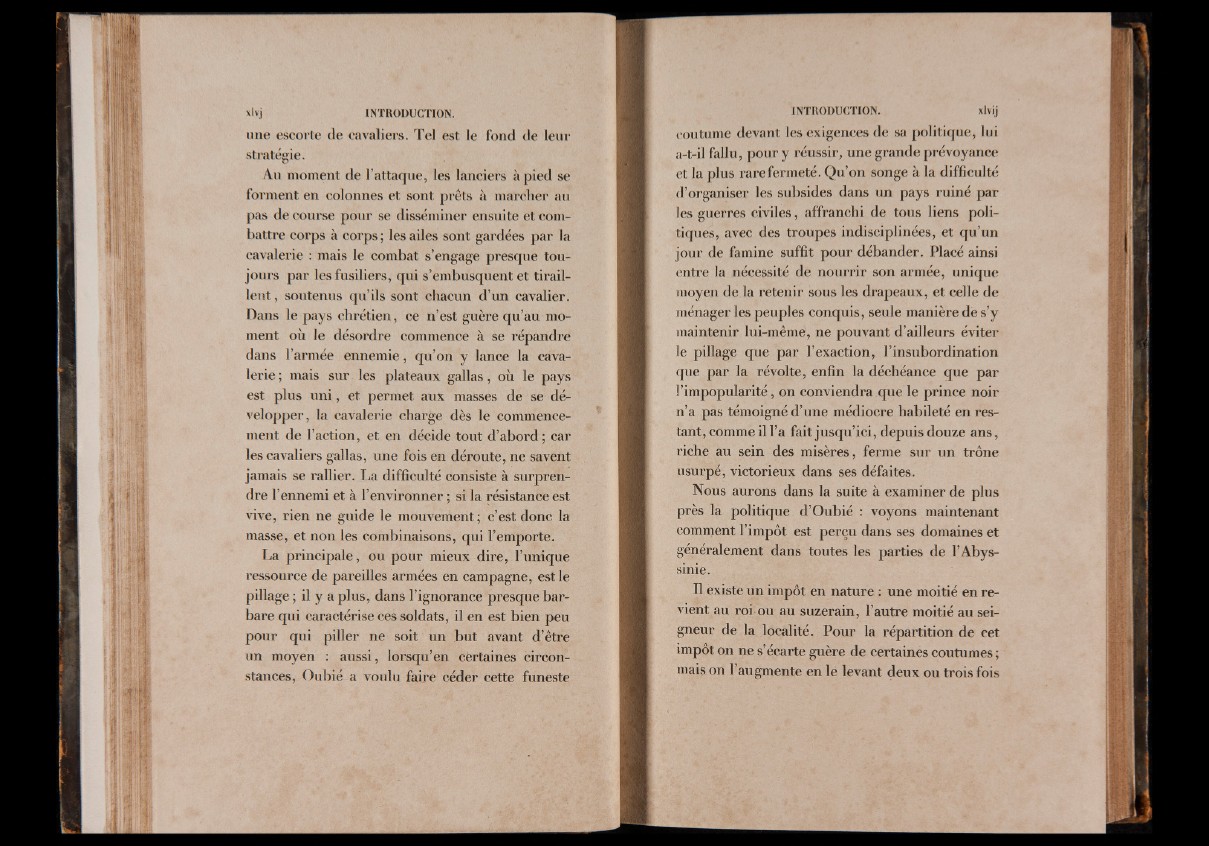
une escorte de cavaliers. Tel est le fond de leur
stratégie.
Au moment de l’attaque, les lanciers à pied se
forment en colonnes et sont prêts à marcher au
pas de course pour se disséminer ensuite et combattre
corps à corps ; les ailes sont gardées par la
cavalerie : mais le combat s’engage presque toujours
par les fusiliers, qui s’embusquent et tiraillent
, soutenus qu’ils sont chacun d’un cavalier.
Dans le pays chrétien, ce n’est guère qu’au moment
où le désordre commence à se répandre
dans l’armée ennemie, qu’on y lance la cavalerie
; mais sur les plateaux gallas, où le pays
est plus u n i, et permet aux masses de se développer,
la cavalerie charge dès le commencement
de l’action, et en décide tout d’abord; car
les cavaliers gallas, une fois en déroute, ne savent
jamais se rallier. La difficulté consiste à surprendre
l’ennemi et à l’environner ; si la résistance est
vive, rien ne guide le mouvement ; c’est donc la
masse, et non les combinaisons, qui l’emporte.
La principale, ou pour mieux dire, l’unique
ressource de pareilles armées en campagne, est le
pillage ; il y a plus, dans l’ignorance presque barbare
qui caractérise ces soldats, il en est bien peu
pour qui piller ne soit un but avant d’être
un moyen : aussi, lorsqu’en certaines circonstances,
Oubié a voulu faire céder cette funeste
coutume devant les exigences de sa politique, lui
a-t-il fallu, pour y réussir, une grande prévoyance
et la plus rare fermeté. Qu’on songe à la difficulté
d’organiser les subsides dans un pays ruiné par
les guerres civiles, affranchi de tous liens politiques,
avec des troupes indisciplinées, et qu’un
jour de famine suffit pour débander. Placé ainsi
entre la nécessité de nourrir son armée, unique
moyen de la retenir sous les drapeaux, et celle de
ménager les peuples conquis, seule manière de s’y
maintenir lui-même, ne pouvant d’ailleurs éviter
le pillage que par l’exaction, l’insubordination
que par la révolte, enfin la déchéance que par
l’impopularité, on conviendra que le prince noir
n’a pas témoigné d’une médiocre habileté en restant,
comme il l’a fait jusqu’ici, depuis douze ans,
riche au sein des misères, ferme sur un trône
usurpé, victorieux dans ses défaites.
Nous aurons dans la suite à examiner de plus
près la politique d’Oubié : voyons maintenant
comment l’impôt est perçu dans ses domaines et
généralement dans toutes les parties de l’Abys-
sinie.
Il existe un impôt en nature : une moitié en revient
au roi ou au suzerain, l’autre moitié au seigneur
de la localité. Pour la répartition de cet
impôt on ne s’écarte guère de certaines coutumes ;
mais on l’augmente en le levant deux ou trois fois