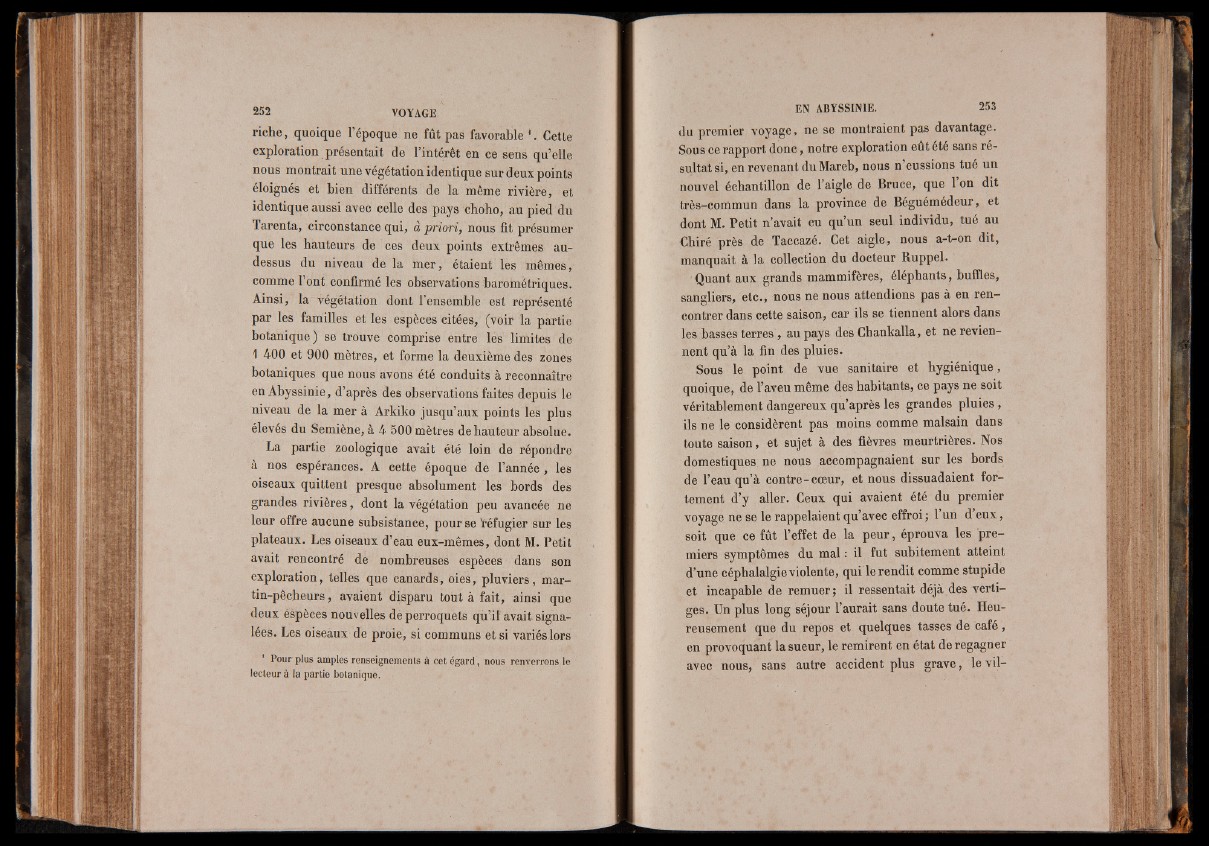
riche, quoique l’époque ne fût pas favorable 1. Cette
exploration présentait de l’intérêt en ce sens qu’elle
nous montrait une végétation identique sur deux points
éloignés et bien différents de la même rivière, et
identique aussi avec celle des pays choho, au pied du
Tarenta, circonstance qui, à p r io r i, nous fit présumer
que les hauteurs de ces deux points extrêmes au-
dessus du niveau de la mer, étaient les mêmes,
comme l’ont confirmé les observations barométriques.
Ainsi, la végétation dont l’ensemble est représenté
par les familles et les espèces citées, (voir la partie
botanique) se trouve comprise entre les limites de
1 400 et 900 mètres, et forme la deuxième des zones
botaniques que nous avons été conduits à reconnaître
en Abyssinie, d’après des observations faites depuis le
niveau de la mer à Arkiko jusqu’aux points les plus
élevés du Semiène, à 4 500 mètres de hauteur absolue.
La partie zoologique avait été loin de répondre
à nos espérances. A cette époque de l’année, les
oiseaux quittent presque absolument les bords des
grandes rivières, dont la végétation peu avancée ne
leur offre aucune subsistance, pour se Réfugier sur les
plateaux. Les oiseaux d’eau eux-mêmes, dont M. Petit
avait rencontré de nombreuses espèces dans son
exploration, telles que canards, oies, pluviers, mar-
tin-pêcheurs, avaient disparu tout à fait, ainsi que
deux éspèces nouvelles de perroquets qu’il avait signalées.
Les oiseaux de proie, si communs et si variés lors
1 Pour plus amples renseignements à cet égard, nous renverrons le
lecteur à la partie botanique.
du premier voyage, ne se montraient pas davantage.
Sous ce rapport donc, notre exploration eut été sans résultat
si, en revenant duMareb, nous n’eussions tué un
nouvel échantillon de l’aigle de Bruce, que 1 on dit
très-commun dans la province de Béguémédeur, et
dont M. Petit n’avait eu qu’un seul individu, tué au
Chiré près de Taccazé. Cet aigle, nous a-t-on dit,
manquait à la collection du docteur Ruppel.
Quant aux grands mammifères, éléphants, buffles,
sangliers, etc., nous ne nous attendions pas à en rencontrer
dans cette saison, car ils se tiennent alors dans
les bassés terres , au pays des Chankalla, et ne reviennent
qu’à la fin des pluies.
Sous le point de vue sanitaire et hygiénique,
quoique, de l’aveu même des habitants, ce pays ne soit
véritablement dangereux qu’après les grandes pluies,
ils ne le considèrent pas moins comme malsain dans
toute saison , et sujet à des fièvres meurtrières. Nos
domestiques ne nous accompagnaient sur les bords
de l’eau qu’à contre-coeur, et nous dissuadaient fortement
d’y aller. Ceux qui avaient été du premier
voyage ne se le rappelaient qu’avec effroi ; l’un d’eux,
soit que ce fût l’effet de la p eu r, éprouva les premiers
symptômes du mal : il fut subitement atteint
d’une céphalalgie violente, qui le rendit comme stupide
et incapable de remuer; il ressentait déjà des vertiges.
Un plus long séjour l’aurait sans doute tué. Heureusement
que du repos et quelques tasses de café,
en provoquant la sueur, le remirent en état de regagner
avec nous, sans autre accident plus grave, le vil