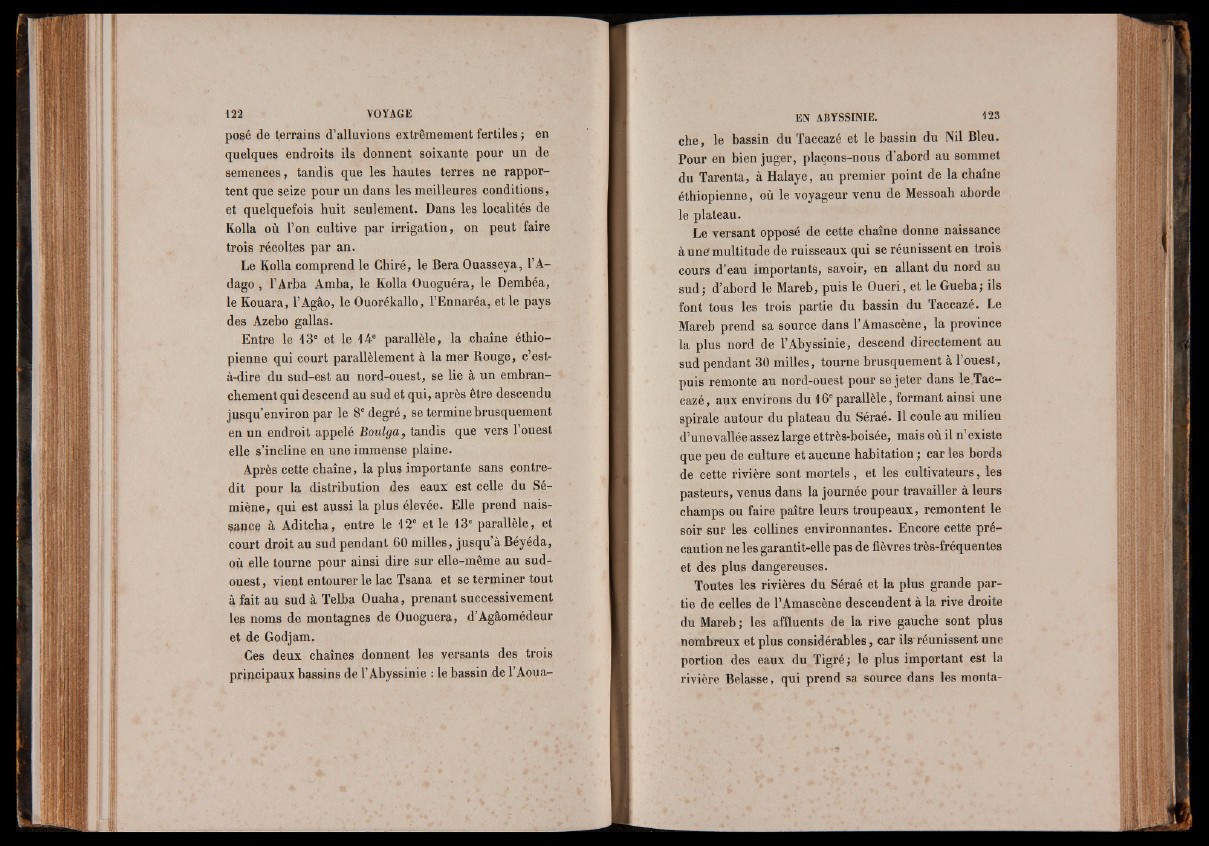
posé de terrains d’alluvions extrêmement fertiles ; en
quelques endroits ils donnent soixante pour un de
semences, tandis que les hautes terres ne rapportent
que seize pour un dans les meilleures conditions,
et quelquefois huit seulement. Dans les localités de
Kolla où l’on cultive par irrigation, on peut faire
trois récoltes par an.
Le Kolla comprend le Chiré, le Bera Ouasseya, l’A-
d ago, l’Arba Amba, le Kolla Ouoguéra, le Dembéa,
le Kouara, l’Agâo, le Ouorékallo, l’Ennaréa, et le pays
des Azebo gallas.
Entre le 13e et le 14e parallèle, la chaîne éthiopienne
qui court parallèlement à la mer Rouge, c’est-
à-dire du sud-est au nord-ouest, se lie à un embranchement
qui descend au sud et qui, après être descendu
jusqu’environ par le 8e degré, se termine brusquement
en un endroit appelé B o u lg a , tandis que vers l’oüest
elle s’incline en une immense plaine.
Après cette chaîne, la plus importante sans contredit
pour la distribution des eaux: est celle du Sémiène,
qui est aussi la plus élevée. Elle prend naissance
à Aditcha, entre le 12° et le 13e parallèle, et
court droit au sud pendant 60 milles, jusqu’à Béyéda,
où elle tourne pour ainsi dire sur elle-même au sud-
ouest , vient entourer le lac Tsana et se terminer tout
à fait au sud à Telba Ouaha, prenant successivement
les noms de montagnes de Ouoguéra, d’Agâomédeur
et de Godjam.
Ces deux chaînes donnent les versants des trois
principaux bassins de l’Abyssinie : le bassin de l’Aouache,
le bassin du Taccazé et le bassin du Nil Bleu.
Pour en bien juger, plaçons-nous d’abord au sommet
du Tarenta, à Halaye, au premier point de la chaîne
éthiopienne, où le voyageur venu de Messoah aborde
le plateau.
Le versant opposé de cette chaîne donne naissance
à unù multitude de ruisseaux qui se réunissent en trois
cours d’eau importants, savoir, en allant du nord au
sud; d’abord le Mareb, puis le Oueri, et le Gueba; ils
font tous les trois partie du bassin du Taccazé. Le
Mareb prend sa source dans l’Amascène, la province
la plus nord de l’Abyssinie, descend directement au
sud pendant 30 milles, tourne brusquement à l’ouest,
puis remonte au nord-ouest pour se jeter dans le .Taccazé
, aux environs du 16e parallèle, formant ainsi une
spirale autour du plateau du Séraé. 11 coule au milieu
d’une vallée assez large ettrès-boisée, mais où il n’ existe
que peu de culture et aucune habitation ; car les bords
de cette rivière sont mortels , et les cultivateurs, les
pasteurs, venus dans la journée pour travailler à leurs
champs ou faire paître leurs troupeaux, remontent le
soir sur les collines environnantes. Encore cette précaution
ne les garantit-elle pas de fièvres très-fréquentes
et des plus dangereuses.
Toutes les rivières du Séraé et la plus grande partie
de celles de l’Amascène descendent à la rive droite
du Mareb ; les affluents de la rive gauche sont plus
nombreux et plus considérables, car ils réunissent une
portion des eaux du Tigré; le plus important est la
rivière Belasse, qui prend sa source dans les monta