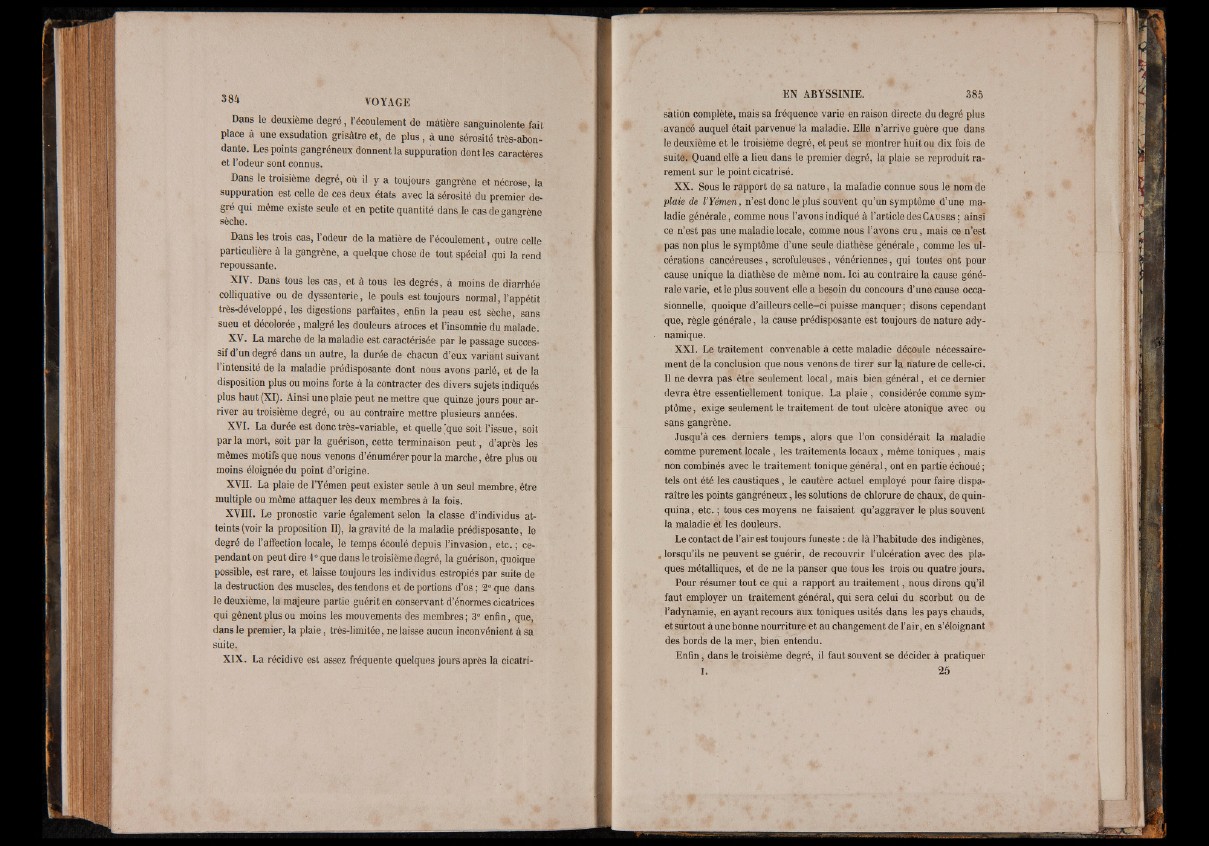
Dans le deuxième degré, l’écoulement de matière sanguinolente fait
place à une exsudation grisâtre et, de plus, à une sérosité très-abondante.
Les points gangréneux donnent la suppuration dont les caractères
et l’odeur sont connus.
Dans le troisième degré, où il y a toujours gangrène et nécrose, la
suppuration est celle de ces deux états avec la sérosité du premier degré
qui même existe seule et en petite quantité dans le cas de gangrène
sèche.
Dans les trois cas, l’odeur de la matière de l’écoulement, outre celle
particulière à la gangrène, a quelque chose de tout spécial qui la rend
repoussante.
XIV. Dans tous les cas, et à tous les degrés, à moins de diarrhée
colliquative ou de dyssenterie, le pouls est toujours normal, l’appétit
très-développé, les digestions parfaites, enfin la peau est sèche, sans
sueu et décolorée, malgré les douleurs atroces et l’insomnie du malade.
XV. La marche de la maladie est caractérisée par le passage successif
d’un degré dans un autre, la durée de chacun d’eux variant suivant
l’intensité de la maladie prédisposantè dont nous avons parlé, et de la
disposition plus ou moins forte à la contracter des divers sujets indiqués
plus haut (XI). Ainsi une plaie peut ne mettre que quinze jours pour arriver
au troisième degré, ou au contraire mettre plusieurs années.
XVI. La durée est donc très-variable, et quelle que soit l’issue, soit
par la mort, soit par la guérison, cette terminaison peut, d’après les
mêmes motifs que nous venons d’énumérer pour la marche, être plus ou
moins éloignée du point d’origine.
XVÜ. La plaie de l’Yémen peut exister seule à un seul membre, être
multiple ou même attaquer les deux membres à la fois.
XVIII. Le pronostic varie également selon la classe d’individus atteints
(voir la proposition II), la gravité de la maladie prédisposante, le
degré de l’affection locale, le temps écoulé depuis l’invasion, etc. ; cependant
on peut dire 1° que dans le troisième degré, la guérison, quoique
possible, est rare, et laisse toujours les individus estropiés par suite de
la destruction des muscles, des tendons et de portions d’os ; 2° que dans
le deuxième, la majeure partie guérit en conservant d’énormes cicatrices
qui gênent plus ou moins les mouvements des membres; 3° enfin, que,
dans le premier, la plaie, très-limitée, ne laisse aucun inconvénient à sa
suite.
XIX. La récidive est assez fréquente quelques jours après la cicatrisation
complète, mais sa fréquence varie en raison directe du degré plus
avancé auquel était parvenue la maladie. Elle n’arrive guère que dans
le deuxième et le troisième degré, et peut se montrer huit ou dix fois de
suite. Quand elle a lieu dans le premier degré, la plaie se reproduit rarement
sur le point cicatrisé.
XX. Sous le rapport de sa nature, la maladie connue sous le nom de
plaie de l’Yémen, n’est donc le plus souvent qu’un symptôme d’une maladie
générale, comme nous l’avons indiqué à l’article des Causes ; ainsi
ce n’est pas une maladie locale, comme nous l’avons cru, mais ce n’est
pas non plus le symptôme d’une seule diathèse générale, comme les ulcérations
cancéreuses, scrofuleuses, vénériennes, qui toutes ont pour
cause unique la diathèse de même nom. Ici au contraire la cause générale
varie, et le plus souvent elle a besoin du concours d’une cause occasionnelle,
quoique d’ailleurs celle-ci puisse manquer ; disons cependant
que, règle générale, la cause prédisposante est toujours de nature ady-
namique.
XXI. Le traitement convenable à cette maladie découle nécessairement
de la conclusion que nous venons de tirer sur la nature de celle-ci.
Il ne devra pas être seulement local, mais bien général, et ce dernier
devra être essentiellement tonique. La plaie, considérée comme symptôme,
exige seulement le traitement de tout ulcère atonique avec ou
sans gangrène.
Jusqu’à ces derniers temps, alors que l’on considérait la maladie
comme purement locale, les traitements locaux, même toniques, mais
non combinés avec le traitement tonique général, ont en partie échoué ;
tels ont été les caustiques, le cautère actuel employé pour faire disparaître
les points gangréneux, les solutions de chlorure de chaux, de quinquina
, etc. ; tous ces moyens ne faisaient qu’aggraver le plus souvent
la maladie et les douleurs.
Le contact de l’air est toujours funeste : de là l’habitude des indigènes,
lorsqu’ils ne peuvent se guérir, de recouvrir l’ulcération avee des plaques
métalliques, et de ne la panser que tous les trois ou quatre jours.
Pour résumer tout ce qui a rapport au traitement, nous dirons qq’il
faut employer un traitement général, qui sera celui du scorbut ou de
l’adynamie, en ayant recours aux toniques usités dans les pays chauds,
et surtout à une bonne nourriture et au changement de l’air, en s’éloignant
des bords de la mer, bien entendu.
Enfin, dans le troisième degré, il faut souvent se décider à pratiquer
I. * ' | » 25