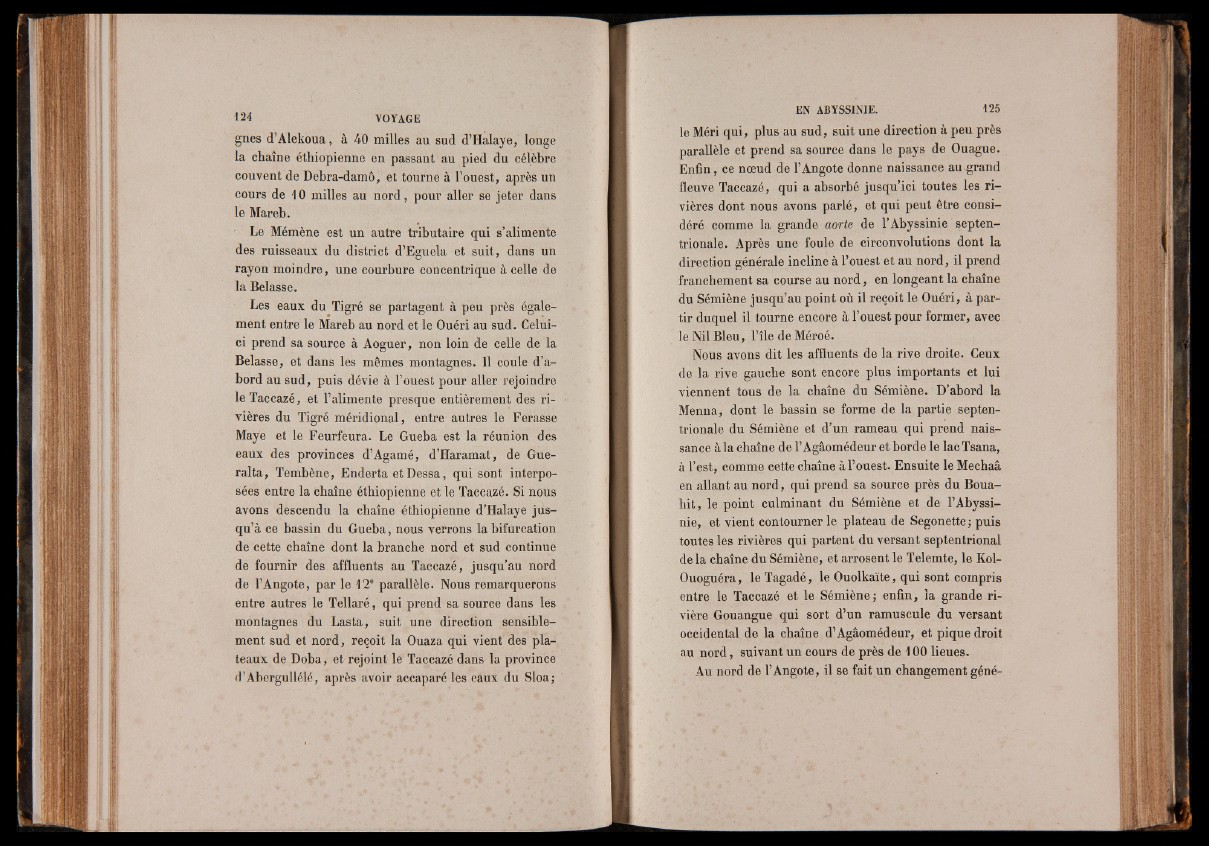
gnes d’Alekoua, à 40 milles au sud d’Halaye, longe
la chaîne éthiopienne en passant au pied du célèbre
couvent de Debra-damô, et tourne à l’ouest, après un
cours de 10 milles au n o rd , pour aller se jeter dans
le Mareb.
Le Mémène est un autre tributaire qui s’alimente
des ruisseaux du district d’Eguela et suit, dans un
rayon moindre, une courbure concentrique à celle de
la Belasse.
Les eaux du Tigré se partagent à peu près également
entre le Mareb au nord et le Ouéri au sud. Celui-
ci prend sa source à Aoguer, non loin de celle de la
Belasse, et dans les mêmes montagnes. Il coule d’abord
au sud, puis dévie à l’ouest pour aller rejoindre
leTaccazé, et l’alimente presque entièrement des rivières
du Tigré méridional, entre autres le Ferasse
Maye et le Feurfeura. Le Gueba est la réunion des
eaux des provinces d’Agamé, d’Haramat, de Gue-
ralta, Tembène, Enderta etDessa, qui sont interposées
entre la chaîne éthiopienne et le Taccazé. Si nous
avons descendu la chaîne éthiopienne d’Halaye jusqu’à
ce bassin du Gueba, nous verrons la bifurcation
de cette chaîne dont la branche nord et sud continue
de fournir des affluents au Taccazé, jusqu’au nord
de l’Angote, par le 12e parallèle. Nous remarquerons
entre autres le Tellaré, qui prend sa source dans les
montagnes du Lasta, suit une direction sensiblement
sud et nord, reçoit la Ouaza qui vient des plateaux
de Doba, et rejoint le Taccazé dans la province
d’Abergullélé, après avoir accaparé les eaux du Sloa;
le Méri qui, plus au sud, suit une direction à peu près
parallèle et prend sa source dans le pays de Ouague.
Enfin, ce noeud de l’Angote donne naissance au grand
fleuve Taccazé, qui a absorbé jusqu’ici toutes les rivières
dont nous avons parlé, et qui peut être considéré
comme la grande aorte de l’Abyssinie septentrionale.
Après une foule de circonvolutions dont la
direction générale incline à l’ouest et au nord, il prend
franchement sa course au nord, en longeant la chaîne
du Sémiène jusqu’au point où il reçoit le Ouéri, à partir
duquel il tourne encore à l’ouest pour former, avec
le Nil Bleu, l’île de Méroé.
Nous avons dit les affluents de la.rive droite. Ceux
de la rive gauche sont encore plus importants et lui
viennent tous de la chaîne du Sémiène. D’abord la
Menua, dont le bassin se forme de la partie septentrionale
du Sémiène et d’un rameau qui prend naissance
à la chaîne de l’Agâomédeur et borde le lac Tsana,
à l’est, comme cette chaîne à l’ouest. Ensuite le Mechaâ
en allant au nord, qui prend sa source près du Boua-
h it, le point culminant du Sémiène et de l’Abyssinie,
et vient contourner le plateau de Segonette ; puis
toutes les rivières qui partent du versant septentrional
de la chaîne du Sémiène, et arrosent le Telemte, le Kol-
Ouoguéra, le Tagadé, le Ouolkaïte, qui sont compris
entre le Taccazé et le Sémiène; enfin, la grande rivière
Gouangue qui sort d’un ramuscule du versant
occidental de la chaîne d’Agâomédeur, et pique droit
au nord, suivant un cours de près de \ 00 lieues.
Au nord de l’Angote, il se fait un changement géné