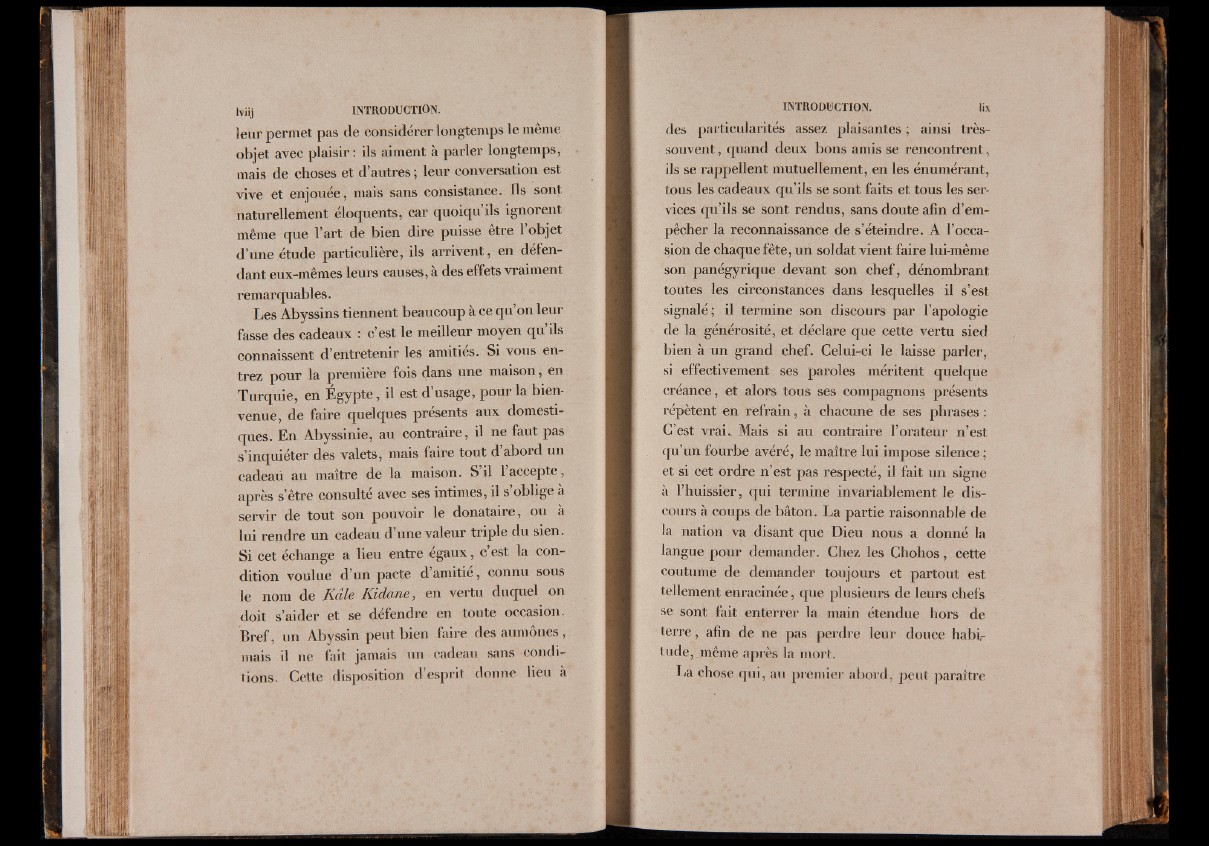
leur permet pas de considérer longtemps le même
objet avec plaisir: ils aiment à parler longtemps,
mais de choses et d’autres ; leur conversation est
vive et enjouée, mais sans consistance. Ils sont
naturellement éloquents, car quoiqu’ils ignorent
même que l’art de bien dire puisse être l’objet
d’une étude particulière, ils arrivent, en défendant
eux-mêmes leurs causes, à des effets vraiment
remarquables.
Les Abyssins tiennent beaucoup à ce qu’on leur
fasse des cadeaux : c’est le meilleur moyen qu’ils
connaissent d’entretenir les amitiés. Si vous entrez
pour la première fois dans une maison, en
Turquie, en Égypte, il est d’usage, pour la bienvenue,
de faire quelques présents aux domestiques.
En Abyssinie, au contraire, il ne faut pas
s’inquiéter dès valets, mais faire tout d abord un
cadeau au maître de la maison. S il 1 accepte,
après s’être consulté avec ses intimes, il s’oblige à
servir de tout son pouvoir le donataire, ou a
lui rendre un cadeau d’une valeur triple du sien.
Si cet échange a lieu entre égaux, c est la condition
voulue d’un pacte d amitié, connu sous
le nom de Kcile Kidctne, en vertu duquel on
doit s’aider et se défendre en toute occasion.
Bref, un Abyssin peut bien faire des aumônes,
mais il ne fait jamais un cadeau sans conditions.
Cette disposition d’esprit donne lieu à
des particularités assez plaisantes ; ainsi très-
souvent , quand deux bons amis se rencontrent,
ils se rappellent mutuellement, en les énumérant,
tous les cadeaux qu’ils se sont faits et tous les services
qu’ils se sont rendus, sans doute afin d’empêcher
la reconnaissance de s’éteindre. A l’occasion
de chaque fête, un soldat vient faire lui-même
son panégyrique devant son chef, dénombrant
toutes les circonstances dans lesquelles il s’est
signalé ; il termine son discours par l’apologie
de la générosité, et déclare que cette vertu sied
bien à un grand chef. Celui-ci le laisse parler,
si effectivement ses paroles méritent quelque
créance, et alors tous ses compagnons présents
répètent en refrain, à chacune de ses phrases :
C’est vrai. Mais si au contraire l’orateur n’est
qu’un fourbe avéré, le maître lui impose silence ;
et si cet ordre n’est pas respecté, il fait un signe
à l’huissier, qui termine invariablement le discours
à coups de bâton. La partie raisonnable de
la nation va disant que Dieu nous a donné la
langue pour demander. Chez les Chohos, cette
coutume de demander toujours et partout est
tellement enracinée, que plusieurs de leurs chefs
se sont fait enterrer la main étendue hors de
terre , afin de ne pas perdre leur douce habitude,.
même après la mort.
La chose qui, au premier abord, peut paraître