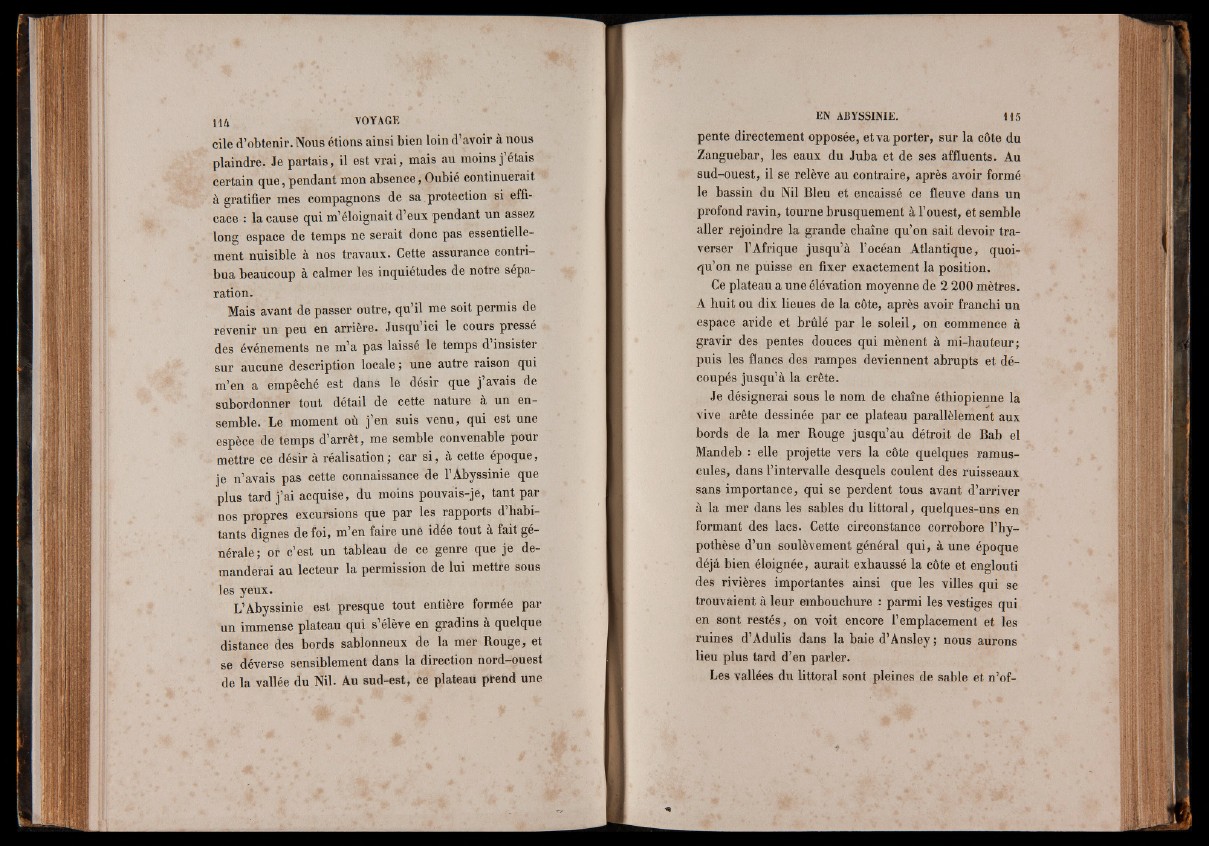
cile d’obtenir. Nous étions ainsi bien loin d’avoir à nous
plaindre. Je partais, il est vrai, mais au moins j étais
certain q ue, pendant mon absence, Oubié continuerait
à gratifier mes compagnons de sa . protection si efficace
: la cause qui m’éloignait d’eux pendant un assez
long espace de temps ne serait donc pas essentiellement
nuisible à nos travaux. Cette assurance contribua
beaucoup à calmer les inquiétudes de notre séparation.
Mais avant de passer outre, qu’il me soit permis de
revenir un peu en arrière. Jusqu’ici le cours pressé
des événements ne m’a pas laissé le temps d’insister
sur aucune description locale ; une autre raison qui
m’en a empêché est dans lé désir que j avais de
subordonner tout détail de cette nature à un ensemble.
Le moment où j’en suis venu, qui est une
espèce de temps d’arrêt, me semble convenable poür
mettre ce désir à réalisation ; car s i , à cette époque,
je n’avais pas cette connaissance de l’Abyssinie que
plus tard j’ai acquise, du moins pouvais-je, tant par
nos propres excursions que par les rapports d habitants
dignes de foi, m’en faire une idee tout a fait générale;
or c’est un tableau de ce genre que je demanderai
au lecteur la permission de lui mettre sous
les yeux.
L’Abyssinie est presque tout entière formée par
un immense plateau qui s’élève en gradins à quelque
distance des bords sablonneux de la mer Rouge, et
se déverse sensiblement dans la direction nord—ouest
de la vallée du Nil. Au sud-est, ce plateau pt-end une
pente directement opposée, et va porter, sur la côte du
Zanguebar, les eaux du Juba et de ses affluents. Au
sud-ouest, il se relève au contraire, après avoir formé
le bassin du Nil Bleu et encaissé ce fleuve dans un
profond ravin, tourne brusquement à l’ouest, et semble
aller rejoindre la grande chaîne qu’on sait devoir traverser
l’Afrique jusqu’à l’océan Atlantique, quoiqu’on
ne puisse en fixer exactement la position.
Ce plateau a une élévation moyenne de 2 200 mètres.
A huit ou dix lieues de la côte, après avoir franchi un
espace aride et brûlé par le soleil, on commence à
gravir des pentes douces qui mènent à mi-hauteur;
puis les flancs des rampes deviennent abrupts et découpés
jusqu’à la crête.
Je désignerai sous le nom de ehaîne éthiopienne la
vive arête dessinée par ce plateau parallèlement aux
bords de la mer Rouge jusqu’au détroit de Bab el
Mandeb : elle projette vers la côte quelques ramus-
cules, dans l’intervalle desquels coulent des ruisseaux
sans importance, qui se perdent tous avant d’arriver
à la mer dans les sables du littoral, quelques-uns en
formant des lacs. Cette circonstance corrobore l’hypothèse
d’un soulèvement général qui, à une époque
déjà bien éloignée, aurait exhaussé la côte et englouti
des rivières importantes ainsi que les villes qui se
trouvaient à leur embouchure : parmi les vestiges qui
en sont restés, on voit encore l’emplacement et les
ruines d’Adulis dans la baie d’Ansley ; nous aurons
lieu plus tard d’en parler.
Les vallées du littoral sont pleines de sable et n’of