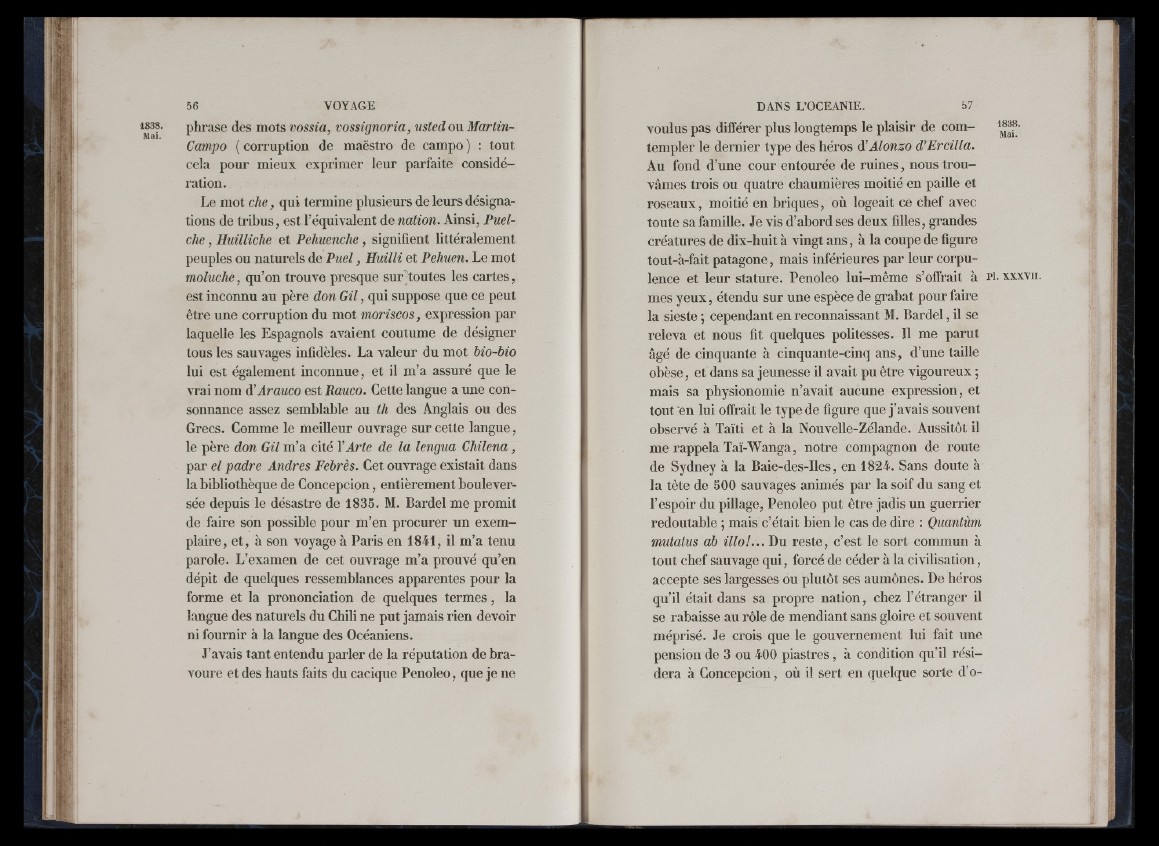
phrase des mots vossia, vossignoria, usted ou Martin-
Campo ( corruption de maëstro de campo) : tout
cela pour mieux exprimer leur parfaite considération.
Le mot che, qui termine plusieurs de leurs désignations
de tribus, est l’équivalent de nation. Ainsi, Puél-
che, Huilliche et Pehuenche, signifient littéralement
peuples ou naturels de Puel, Huilli et Pehuen. Le mot
moluche, qu’on trouve presque sur toutes les cartes,
est inconnu au père don Gil, qui suppose que ce peut
être une corruption du mot moriscos, expression par
laquelle les Espagnols avaient coutume de désigner
tous les sauvages infidèles. La valeur du mot bio-bio
lui est également inconnue, et il m’a assuré que le
vrai nom d’Arauco est Rauco. Cette langue a une con-
sonnance assez semblable au th des Anglais ou des
Grecs. Comme le meilleur ouvrage sur cette langue,
le père don Gil m’a cité YArte de la lengua Chilena,
par el padre Andres Febrès. Cet ouvrage existait dans
la bibliothèque de Concepcion, entièrement bouleversée
depuis le désastre de 1835. M. Bardel me promit
de faire son possible pour m’en procurer un exemplaire,
et, à son voyage à Paris en 1841, il m’a tenu
parole. L’examen de cet ouvrage m’a prouvé qu’en
dépit de quelques ressemblances apparentes pour la
forme et la prononciation de quelques termes, la
langue des naturels du Chili ne put jamais rien devoir
ni fournir à la langue des Océaniens.
J’avais tant entendu parler de la réputation de bravoure
et des hauts faits du cacique Penoleo, que je ne
voulus pas différer plus longtemps le plaisir de com-
templer le dernier type des héros d’Alonzo d’Ercilla.
Au fond d’une cour entourée de ruines, nous trouvâmes
trois ou quatre chaumières moitié en paille et
roseaux, moitié en briques, où logeait ce chef avec
toute sa famille. Je vis d’abord ses deux filles, grandes
créatures de dix-huit à vingt ans, à la coupe de figure
tout-à-fait patagone, mais inférieures par leur corpulence
et leur stature. Penoleo lui-même s’offrait à
mes yeux, étendu sur une espèce de grabat pour faire
la sieste ; cependant en reconnaissant M. Bardel, il se
releva et nous fit quelques politesses. Il me parut
âgé de cinquante à cinquante-cinq ans, d’une taille
obèse, et dans sa jeunesse il avait pu être vigoureux ;
mais sa physionomie n’avait aucune expression, et
tout‘en lui offrait le type de figure que j’avais souvent
observé à Taïti et à la Nouvelle-Zélande. Aussitôt il
me rappela Taï-Wanga, notre compagnon de route
de Sydney à la Baie-des-Iles, en 1824. Sans doute à
la tète de 500 sauvages animés par la soif du sang et
l’espoir du pillage, Penoleo put être jadis un guerrier
redoutable ; mais c’était bien le cas de dire : Quantum
mutatus ah illo!... Du reste, c’est le sort commun à
tout chef sauvage qui, forcé de céder à la civilisation,
accepte ses largesses ou plutôt ses aumônes. De héros
qu’il était dans sa propre nation, chez l’étranger il
se rabaisse au rôle de mendiant sans gloire et souvent
méprisé. Je crois que le gouvernement lui fait une
pension de 3 ou 400 piastres, à condition qu’il résidera
à Concepcion, où il sert en quelque sorte d’o.
XXXVII.