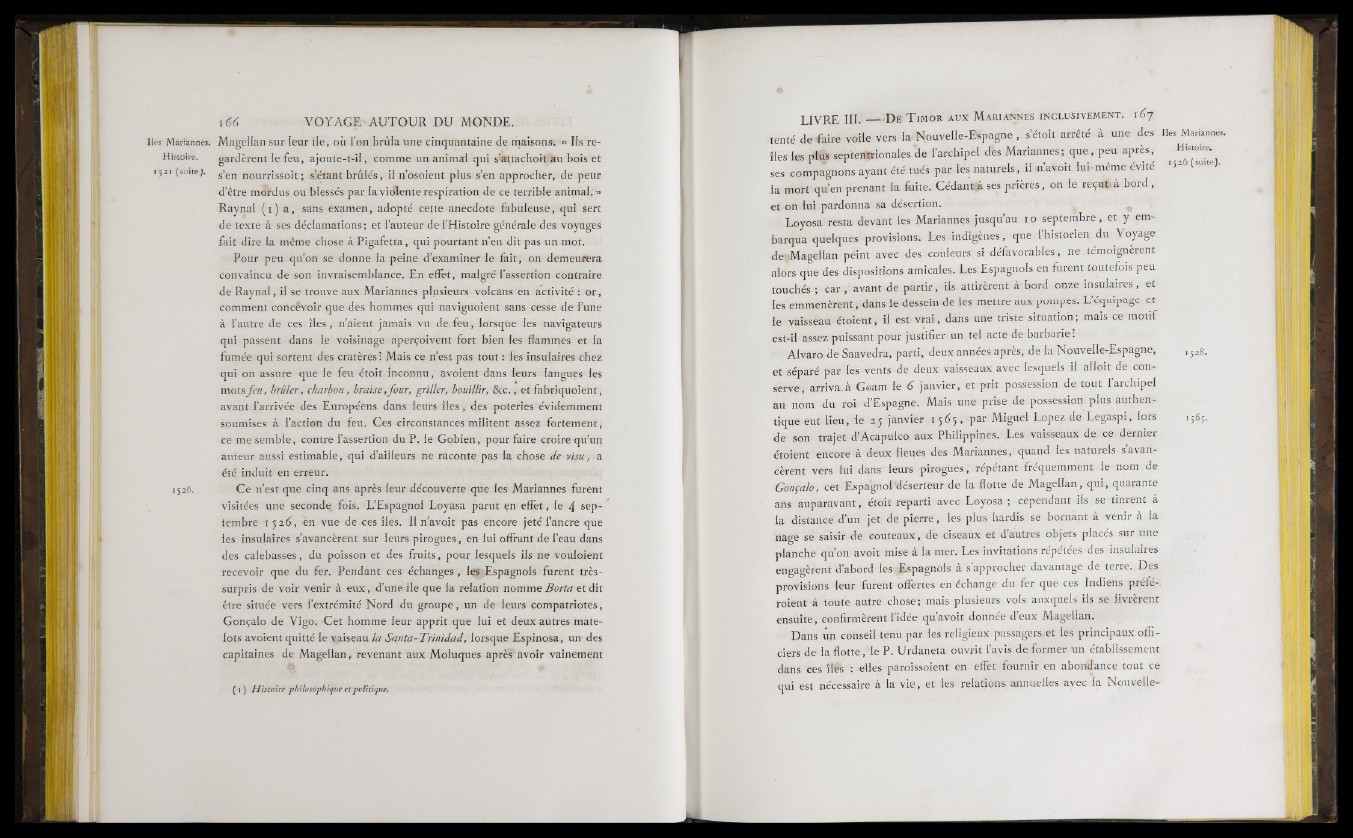
Iles Mariannes. Magellan sur leur île, où l’on brûla une cinquantaine de maisons. « Iis re-
Hisiolre. gardèrent le fen, ajoute-t-il, comme un animal qui s’attacboit au bois et
‘ 5-1 s’en nourrissoit ; s’étant brûlés , il n’osoient pius s’en approcher, de peur
d’être mordus ou blessés par ia violente respiration de ce terrible animal.»
Raynal ( i ) a , sans examen, adopté cette anecdote fabuleuse, qui sert
de texte à ses déclamations; et l’auteur de l’Histoire générale des voyages
fait dire la même chose à Pigafetta, qui pourtant n’en dit pas un mot.
Pour peu qu’on se donne la peine d’examiner le fait, on demeurera
convaincu de son invraisembiance. En effet, malgré l’assertion contraire
de Raynal, il se trouve aux Mariannes plusieurs volcans en activité : or,
comment concevoir que des hommes qui naviguoient sans cesse de l’une
à l’autre de ces îles, n’aient jamais vu de feu, iorsque les navigateurs
qui passent dans le voisinage aperçoivent fort bien les flammes et ia
fumée qui sortent des cratères! Mais ce n’est pas tout : ies insulaires chez
qui on assure que le feu étoit inconnu, avoient dans leurs langues les
motsJvi/, brûler, charbon, braise, four, griller, bouillir, & c ., et fabriquoient,
avant l’arrivée des Européens dans leurs îles , des poteries évidemment
soumises à l’action du feu. Ces circonstances militent assez fortement,
ce me semble, contre l’assertion du P. le Gobien, pour faire croire qu’un
auteur aussi estimable, qui d’ailleurs ne raconte pas la chose de visu, a
été induit en erreur.
15 2 6 . Ce n’est que cinq ans après ieur découverte que les Mariannes furent
visitées une seconde fois. L’Espagnol Loyasa parut en effet, le 4 septembre
I 526, en vue de ces îles. II n’avoit pas encore jeté l’ancre que
les insulaires s’avancèrent sur leurs pirogues, en lui offrant de l’eau dans
des calebasses, du poisson et des fruits, pour lesquels iis ne vouloient
recevoir que du fer. Pendant ces échanges , ies Espagnols furent très-
SLirpris de voir venir à eux, d’une île que la relation nomme Borta et dit
être située vers l’extrémité Nord du groupe, un de leurs compatriotes,
Gonçalo de Vigo. Cet homme leur apprit que lui et deux autres matelots
avoient quitté ie vaiseau la Sunta-Trinidad, iorsque Espinosa, un des
capitaines de Magellan, revenant aux Moluques après avoir vainement
( 1 ) H is to ire philosophique et politique.
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 16 7
tenté de faire voile vers ia Nouvelle-Espagne , s’étoit arrêté à une des lies Marianne^,
îles les plus septentrionales de l’archipel des Mariannes ; que , peu après,
ses compagnons ayant été tués par les naturels, il n’avoit lui-même évité 'E-
la mort qu’en prenant la fuite. Cédant à ses prières, on le reçut à bord ,
et on lui pardonna sa désertion.
Loyosa resta devant les Mariannes jusqu’au 10 septembre, et y embarqua
quelques provisions. Les indigènes , que l’historien du Voyage
de Magellan peint avec des couleurs si défavorables, ne témoignèrent
alors que des dispositions amicales. Les Espagnols en furent toutefois peu
touchés ; car , avant de partir, ils attirèrent à bord onze insulaires , et
ies emmenèrent, dans le dessein de les mettre aux pompes. L’équipage et
le vaisseau étoient, il est v ra i, dans une triste situation ; mais ce motif
est-il assez puissant pour justifier un tel acte de barbarie!
Alvaro de Saavedra, parti, deux années après, de la Nouvelle-Espagne, , 5,g.
et séparé par les vents de deux vaisseaux avec iesquels il alloit de conserve,
arriva à Gaam le 6 janvier, et prit possession de tout l’archipel
au nom du roi d’Espagne. Mais une prise de possession plus authentique
eut lieu, ie 25 janvier 1565, par Miguel Lopez de Legaspi, lors ,563.
de son trajet d’Acapulco aux Philippines. Les vaisseaux de ce dernier
étoient encore à deux lieues des Mariannes, quand les naturels s’avancèrent
vers lui dans leurs pirogues, répétant fréquemment le nom de
Gonçalo, cet Espagnol déserteur de ia flotte de Magellan, qui, quarante
ans auparavant, étoit reparti avec Loyosa ; cependant ils se tinrent à
la distance d’un jet de pierre , les plus hardis se bornant à venir à la
nage se saisir de couteaux, de ciseaux et d’autres objets placés sur une
planche qu’on avoit mise à la mer. Les invitations répétées des insulaires
engagèrent d’abord les Espagnols à s'approcher davantage de terre. Des
provisions leur furent offertes en échange du fer que ces Indiens préféroient
à toute autre chose; mais plusieurs vols auxquels ils se livrèrent
ensuite, confirmèrent l’idée qu’avoit donnée d’eux Magellan.
Dans un conseil tenu par les religieux piissagers et les principaux officiers
de la flotte, le P. Urdaneta ouvrit l’avis de former un établissement
dans ces îles ; elies paroissoient en effet fournir en abondance tout ce
qui est nécessaire à la vie, et les relations annuelles avec ia Nouvelle