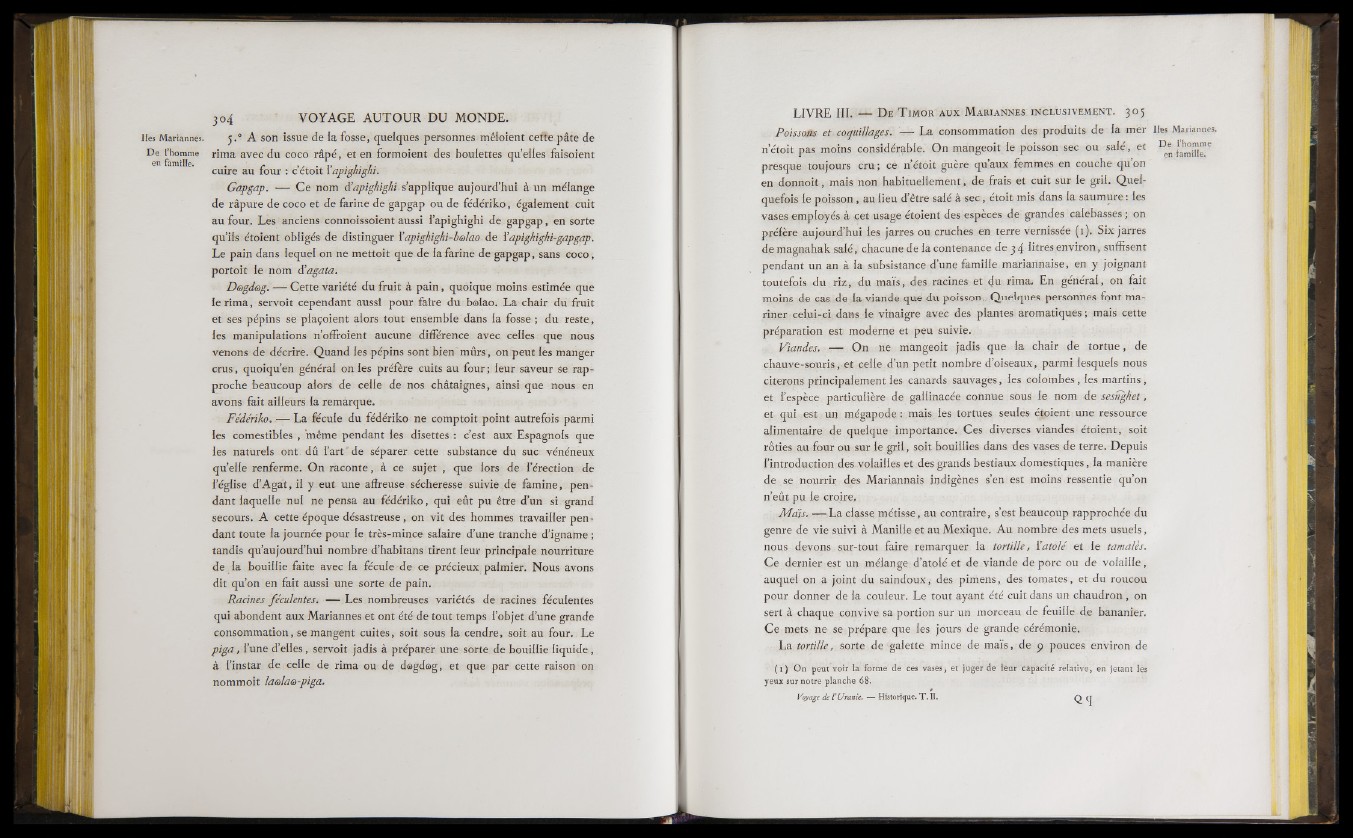
lies Mariannes.
De l’homme
en famille.
5.° A son issue de la fosse, quelques personnes mêloient cette pâte de
rima avec du coco râpé, et en formoient des boulettes qu’elles faisoient
cuire au four : c’étoit ïapighighi.
Gapgap. — Ce nom à’apiginghi s’applique aujourd’hui à un mélange
de râpure de coco et de farine de gapgap ou de fédériko, également cuit
au four. Les anciens connoissoient aussi l’apighighi de gapgap, en sorte
qu’ils étoient obligés de distinguer apighighi-lalao de t apighighi-gapgap.
Le pain dans iequel on ne mettoit que de la farine de gapgap, sans coco,
portoit le nom à’agata.
Dogdag. — Cette variété du fruit à pain, quoique moins estimée que
le rima, servoit cependant aussi pour faire du balao. La chair du fruit
et ses pépins se plaçoient alors tout ensemble dans la fosse ; du reste,
les manipulations n’offroient aucune différence avec celles que nous
venons de décrire. Quand les pépins sont bien mûrs, on peut les manger
crus, quoiqu’en générai on les préfère cuits au four; leur saveur se rapproche
beaucoup alors de celle de nos châtaignes, ainsi que nous en
avons fait ailleurs la remarque.
Fédériko. — La fécule du fédériko ne comptoit point autrefois parmi
ies comestibles , même pendant ies disettes ; c’est aux Espagnols que
les naturels ont dû l’art de séparer cette substance du suc vénéneux
qu’elle renferme. On raconte, à ce sujet , que lors de l’érection de
l’église d’Agat, il y eut une affreuse sécheresse suivie de famine, pendant
laquelle nui ne pensa au fédériko, qui eût pu être d’un si grand
secours. A cette époque désastreuse, on vit des hommes travailler pendant
toute la journée pour ie très-mince salaire d’une tranche d’igname ;
tandis qu’aujourd’hui nombre d’habitans tirent leur principale nourriture
de la bouillie faite avec la fécule de ce précieux palmier. Nous avons
dit qu’on en fait aussi une sorte de pain.
Racines féculentes. — Les nombreuses variétés de racines féculentes
qui abondent aux Mariannes et ont été de tout temps l’objet d’une grande
consommation, se mangent cuites, soit sous la cendre, soit au four. Le
p iga, l’une d’elles, servoit jadis à préparer une sorte de bouillie liquide,
à l’instar de celle de rima ou de dogdag, et que par cette raison on
nommoit laalaa-piga.
Poissons et coquillages. — La consommation des produits de la mer Ile s Mariannes,
n’étoit pas moins considérable. On mangeoit le poisson sec ou salé, et D« (’'[(('¡î"''
presque toujours cru ; ce n’étoit guère qu’aux femmes en couche qu on
en donnoit, mais non habituellement, de frais et cuit sur le gril. Quelquefois
ie poisson , au lieu d’être saié à sec, étoit mis dans la saumure : les
vases employés à cet usage étoient des espèces de grandes calebasses ; on
préfère aujourd’hui les jarres ou cruches en terre vernissée (i). Six jarres
de magnahak salé, chacune de ia contenance de 3 4 litres environ, suffisent
pendant un an à la subsistance d’une famille mariannaise, en y joignant
toutefois du riz, du maïs, des racines et du rima. En général, on fait
moins de cas de la viande que du poisson. Quelques personnes font mariner
celui-ci dans le vinaigre avec des plantes aromatiques ; mais cette
préparation est moderne et peu suivie.
Viandes. — On ne mangeoit jadis que la chair de tortue, de
chauve-souris, et celle d’un petit nombre d’oiseaux, parmi lesquels nous
citerons principalement les canards sauvages, les colombes , les martins ,
et i’espèce particuiière de gallinacée connue sous le nom de sesnghet,
et qui est un mégapode : mais les tortues seules étoient une ressource
alimentaire de quelque importance. Ces diverses viandes étoient, soit
rôties au four ou sur le gril, soit bouillies dans des vases de terre. Depuis
l’introduction des volailles et des grands bestiaux domestiques, la manière
de se nourrir des Mariannais indigènes s’en est moins ressentie qu’on
n’eût pu le croire.
Mais, — La classe métisse, au contraire, s’est beaucoup rapprochée du
genre de vie suivi à Manille et au Mexique. Au nombre des mets usuels,
nous devons sur-tout faire remarquer la tortille, ïatolé et le tamalès.
Ce dernier est un mélange d’atolé et de viande de porc ou de volaille ,
auquel on a joint du saindoux, des pimens, des tomates, et du roucou
pour donner de la couleur. Le tout ayant été cuit dans un chaudron , on
sert à chaque convive sa portion sur un morceau de feuille de bananier.
Ce mets ne se prépare que les jours de grande cérémonie.
La tortille, sorte de galette mince de maïs, de 9 pouces environ de
( i ) On peut voir la forme de ces v a se s, et juge r de ieur capacité re la tiv e , en jetant les
y eu x sur notre planche 68. /
Voyage de l'Uranie. — Historique. T . II. Q (j