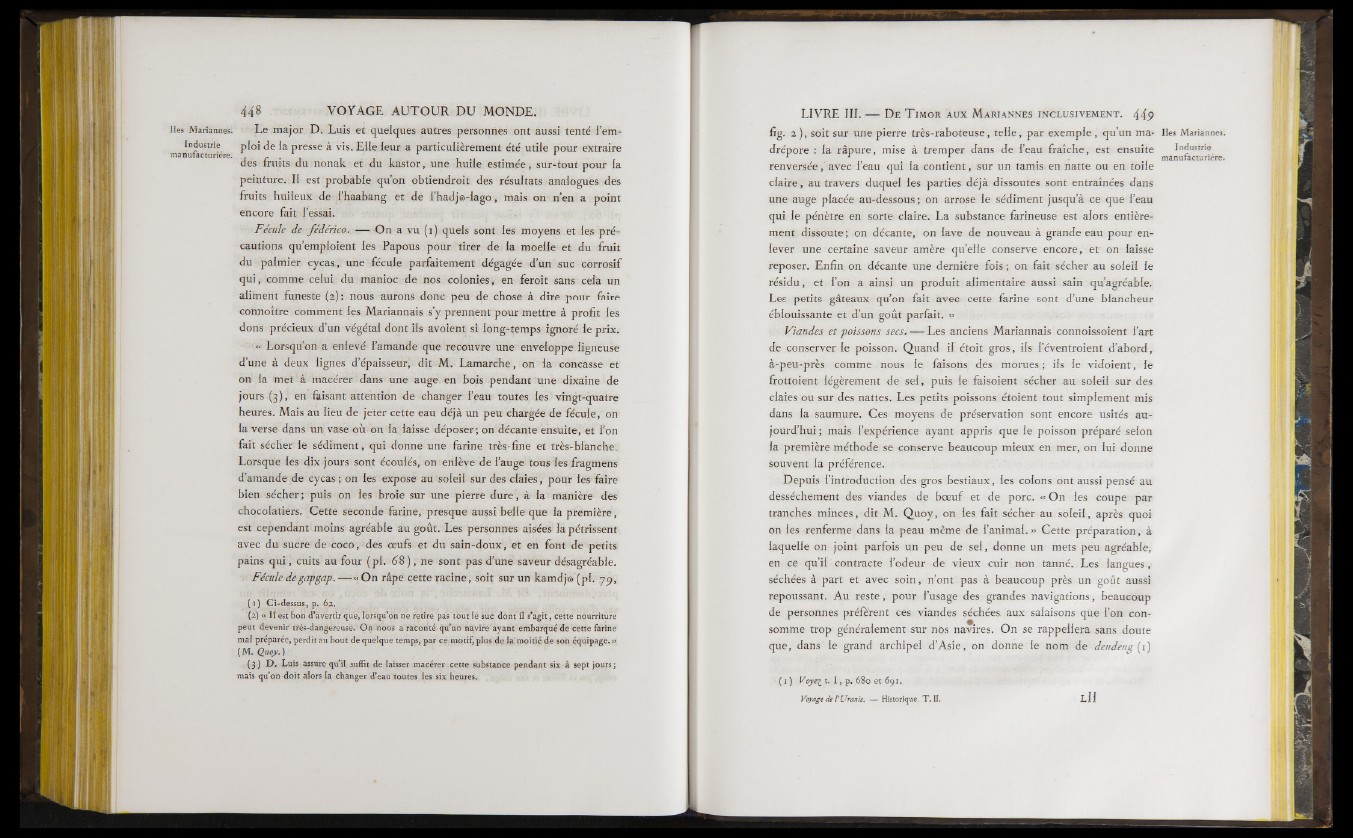
Industrie
manufacturière.
Le major D. Luis et quelques autres personnes ont aussi tenté l’emploi
de la presse à vis. Eile leur a particulièrement été utile pour extraire
des fruits du nonak et du kastor, une huile estimée, sur-tout pour la
peinture. Il est probable qu’on obtiendroit des résultats analogues des
fruits huileux de l’haabang et de l’hadjo-Iago, mais on n’en a point
encore fait l’essai.
Fécule de fédérico. — On a vu (i) quels sont les moyens .et les précautions
qu’emploient les Papous pour tirer de la moelle et du fruit
du palmier cycas, une fécule parfaitement dégagée d’un suc corrosif
qui, comme celui du manioc de nos colonies, en feroit sans cela un
aliment funeste (2); nous aurons donc peu de chose à dire pour faire
connoître comment les Mariannais s’y prennent pour mettre à profit les
dons précieux d’un végétal dont ils avoient si long-temps ignoré ie prix.
« Lorsqu’on a enlevé l’amande que recouvre une enveloppe ligneuse
d’une à deux lignes d’épaisseur, dit M. Lamarche, on la concasse et
on la met à macérer dans une auge en bois pendant une dixaine de
jours (3), en faisant attention de changer l’eau toutes les vingt-quatre
heures. Mais au lieu de jeter cette eau déjà un peu chargée de fécule, on
la verse dans un vase où on la laisse déposer; on décante ensuite, et l’on
fait sécher le sédiment, qui donne une farine très-fine et très-blanche.
Lorsque ies dix jours sont écoulés, on enlève de l’auge tous les fragmens
d’amande de cycas ; on les expose au soleil sur des claies, pour les faire
bien sécher ; puis on les broie sur une pierre dure, à la manière des
chocolatiers. Cette seconde farine, presque aussi belle que la première,
est cependant moins agréable au goût. Les personnes aisées la pétrissent
avec du sucre de coco, des oeufs et du sain-doux, et en font de petits
pains qui, cuits au four (pl. 68 ), ne sont pas d’une saveur désagréable.
Fécule de gapgap. — «On râpe cette racine, soit sur un kamdjo (pl. 79,
( I ) Ci-d e ssu s , p. 62.
(2) « I l est bon d’ avertir que, lorsqu’on ne retire pas tout le suc dont il s’a g it , cette nourriture
peut devenir très-dangereuse. On nous a raconté qu’un navire ayant embarqué de cette farine
mal préparée, perdit au bout de quelque temps, par ce motif, plus de la moitié de son équipage. »
(M . Quoy.)
( 3 ) D . Luis assure qu’ il suffit de laisser macérer cette substance pendant six à sept jou rs ;
mais qu’on doit alors la changer d’ eau toutes les six heures.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 4 9
fig. 2 ), soit sur une pierre très-raboteuse, teile, par exempie, qu’un ma- lie s Mariannes.
drépore : la râpure, mise à tremper dans de l’eau fraîche, est ensuite Industrie
^ . manufacturière.
renversée, avec l’eau qui la contient, sur un tamis en natte ou en toile
claire, au travers duquel les parties déjà dissoutes sont entraînées dans
une auge placée au-dessous ; on arrose le sédiment jusqu’à ce que i’eau
qui le pénètre en sorte claire. La substance farineuse est alors entièrement
dissoute; on décante, on lave de nouveau à grande eau pour enlever
une certaine saveur amère qu’elle conserve encore, et on laisse
reposer. Enfin on décante une dernière fois ; on fait sécher au soleil le
résidu, et l’on a ainsi un produit alimentaire aussi sain qu’agréable.
Les petits gâteaux qu’on fait avec cette farine sont d’une blancheur
éblouissante et d’un goût pariait. »
Viandes et poissons secs. — Les anciens Mariannais connoissoient l’art
de conserver le poisson. Quand il étoit gros, ils l’éventroient d’abord,
à-peii-près comme nous ie faisons des morues; ils le vidoient, le
frottoient légèrement de sei, puis le faisoient sécher au soleil sur des
claies ou sur des nattes. Les petits poissons étoient tout simplement mis
dans la saumure. Ces moyens de préservation sont encore usités aujourd’hui
; mais l’expérience ayant appris que le poisson préparé selon
la première méthode se conserve beaucoup mieux en mer, on lui donne
souvent la préférence.
Depuis i’introduction des gros bestiaux, ies colons ont aussi pensé au
dessèchement des viandes de boeuf et de porc. « On les coupe par
tranches minces, dit M. Quoy, on les fait sécher au soleil, après quoi
on les renferme dans la peau même de l’animai.» Cette préparation, à
laquelle on joint parfois un peu de sel, donne un mets peu agréabie,
en ce qu’il contracte l’odeur de vieux cuir non tanné. Les langues ,
séchées à part et avec soin, n’ont pas à beaucoup près un goût aussi
repoussant. Au reste , pour l’usage des grandes navigations, beaucoup
de personnes préfèrent ces viandes séchées aux salaisons que l’on consomme
trop généralement sur nos navires. On se rappellera sans doute
que, dans le grand archipel d’A sie, on donne le nom de dendeng [i]
( i ) KqvfJ t. I , p. 680 et 6 9 1.