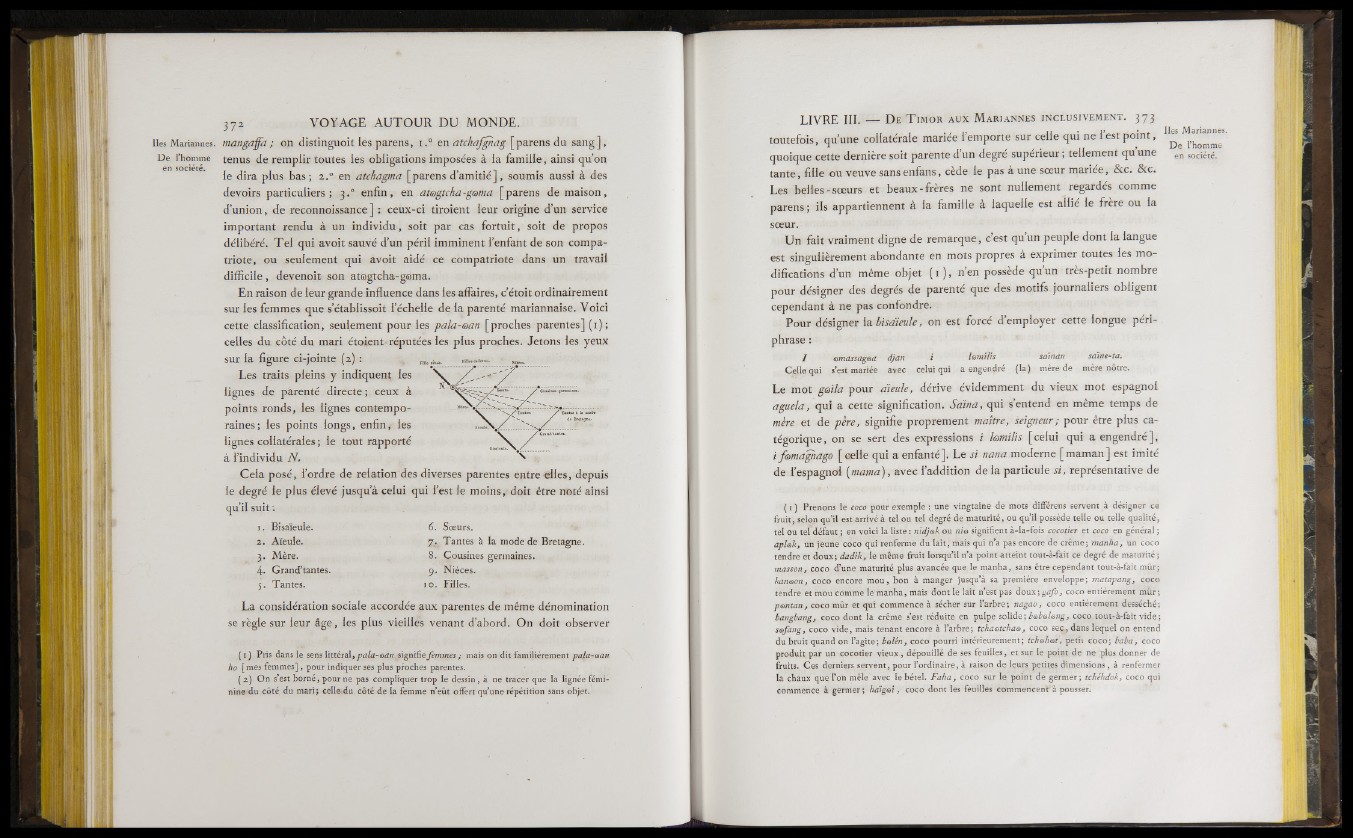
Iles Mariannes, mangaffa ; 011 distinguoit les parens, i.° en [parens du sang],
D e l’homme tenus de remplir toutes les obligations imposées à la famille, ainsi qu’on
en société.
le dira pius bas ; 2.“ en atchagma [parens d’amitié], soumis aussi à des
devoirs particuliers; 3.° enfin, en atogtcha-goma [parens de maison,
d’union, de reconnoissance] : ceux-ci tiroient leur origine d’un service
important rendu à un individu, soit par cas fortuit, soit de propos
délibéré. Tel qui avoit sauvé d’un péril imminent l’enfant de son compatriote,
ou seulement qui avoit aidé ce compatriote dans un travail
difficile, devenoit son atogtcha-goma.
En raison de leur grande influence dans les affaires, c’étoit ordinairement
sur ies femmes que s’établissoit l’échelle de la parenté mariannaise. Voici
cette classification, seulement pour les pala-aan [proches parentes] (i) ;
celles du côté du mari étoient réputées les plus proches. Jetons les yeux
sur la figure ci-jointe (2) :
Les traits pleins y indiquent les
lignes de parenté directe ; ceux à ®
points ronds, les lignes contemporaines
; les points longs, enfin, les
lignes collatérales ; le tout rapporté
à l’individu N.
Cela posé, i’ordre de relation des diverses parentes entre elles, depuis
le degré le plus élevé jusqu’à ceiui qui l’est le moins, doit être noté ainsi
qu’il suit '.
1. Bisaïeule. 6 . Soeurs.
2 . Aïeule. 7 . Tantes à la mode de Bretagne.
3. Mère. 8. Cousines germaines.
9, Nièces.
10 . Filles.
Mère.
4. Grand’tantes.
5. Tantes.
La considération sociale accordée aux parentes de même dénomination
se règle sur leur âge, les plus vieilles venant d’abord. On doit observer
( I ) Pris dans le sens \méxd\, p a la -a a n signiiie femmes ; mais on dit familièrement p a la -a a n
ho [me s femmes] , pour indiquer ses plus proches parentes.
( 2 ) On s’est borné, pour ne pas compliquer trop le d e ssin, à ne tracer que la lignée féminine
du côté du m a ri; celle du côté de la femme n’eût offert qu’une répétition sans objet.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i . a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 3 7 3
toutefois, qu’une collatérale mariée l’emporte sur celle qui ne l’est point,
quoique cette dernière soit parente d’un degré supérieur ; tellement qu’une
tante, fille ou veuve sans enfans, cède le pas à une soeur mariée, &c. &c.
Les belles-soeurs et beaux-frères ne sont nullement regardés comme
parens ; ils appartiennent à la famille a laquelle est allie le frère ou la
soeur.
Un fait vraiment digne de remarque, c’est qu’un peuple dont la langue
est singulièrement abondante en mots propres à exprimer toutes ies modifications
d’un même objet ( i ), n’en possède qu’un très-petit nombre
pour désigner des degrés de parenté que des motifs journaliers obligent
cependant à ne pas confondre.
Pour désigner ia bisaieule, on est forcé d’employer cette longue périphrase
:
/ Qmassagoa djan i le in ilis saínan sa'ine-ta.
C e lle qui s’est mariée a v e c celui qui a engendré ( la ) mère de mère nôtre.
Le mot gaila pour aieule, dérive évidemment du vieux mot espagnol
agüela, qui a cette signification. Sdina, qui s’entend en même temps de
mère et de père, signifie proprement maître, seigneur; pour être plus catégorique,
on se sert des expressions i lamilis [celui qui a engendré],
ifmiagiiago [celle qui a enfanté]. Le si nana moderne [maman] est imité
de l’espagnol [marna), avec l’addition de la particule si, représentative de
D e l’ homme
en société.
( I ) Prenons le coco pour exemple : une vingtaine de mots différens servent à désigner ce
fru it, selon qu’il est arrivé à tel ou tel degré de maturité, ou qu’il possède te lle ou telle qu alité ,
tel ou tel défaut ; en vo ic i la liste ; n id ja k ou nia signifient à -Ia -fo is cocotier et coco en général ;
a p la k , un jeune coco qui renferme du la it , mais qui n’a pas encore de crème; man h a, un coco
tendre et d o u x ; d a d ih , le même fruit lorsqu’ il n’a point atteint tout-<à-fait ce degré de maturité;
masson, coco d’une maturité plus a vancé e que le manha , sans être cependant tout-à-fait mûr;
k a n a on , coco encore m o u , bon à manger jusqu’à sa première enve lopp e; matapang, co co
tendre et mou comme le manha, mais dont le lait n’est pas d o u x ;g a / ô , coco entièrement m û r ;
p a n t a n , coco mûr et qui commence à sécher sur l’a rb re ; nagao, coco entièrement desséché;
banghang, coco dont la crème s’ est réduite en pulpe solide ; ¿ffliffl/ffitig-, coco tou t-à -fa it v id e ;
sa fa n g , coco v id e , mais tenant encore à l’a rbre ; tchaatch aa, coco s e c , dans iequel on entend
du bruit quand on l’a g ite ; b a lén , coco pourri intérieurement; tch a h a t, petit c o c o ; b a b a , coco
produit par un cocotier vieu x , dépouillé de ses feuille s, et sur le point de ne plus donner de
fruits. C e s derniers se rv en t, pour l’ord inaire , à raison de leurs petites dimensions, à renfermer
la chaux que l’on mêle avec le bétel. F a h a , coco sur le point de g e rm e r ; tchéhdok, coco qui
commence à g e rm e r; h à ig a i , coco dont les feuilles commencent à pousser.