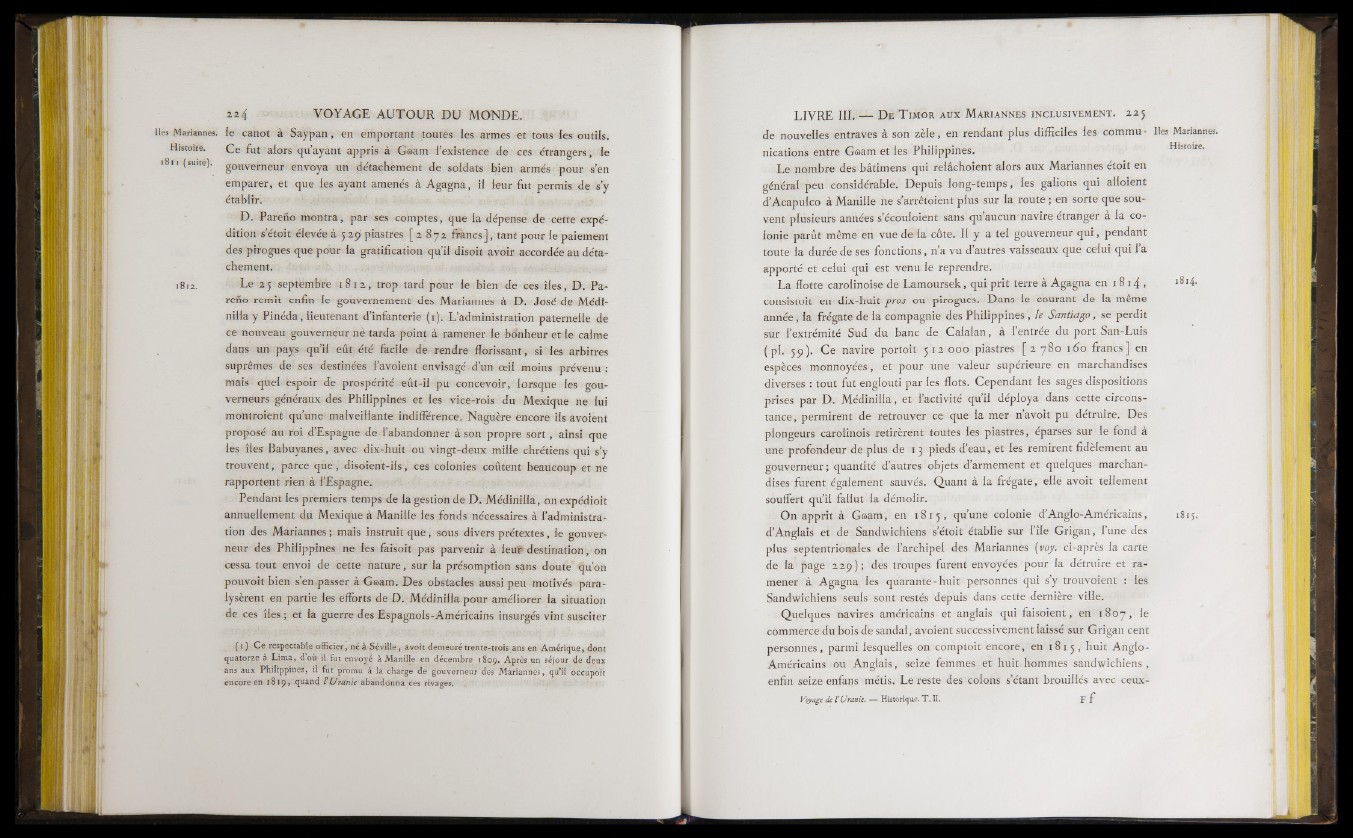
•IM
Am
: \ iiaik
" 1
J
' 1
4 ] Ï
il
Histoire.
i 8 i i (suite).
224 VO YAGE AUTOUR DU MONDE.
lie s Mariannes, le canot à Saypan, en emportant toutes les armes et tous les outils.
Ge fut alors qu’ayant appris à Goam l’existence de ces étrangers, ie
gouverneur envoya un détachement de soldats bien armés pour s’en
emparer, et que les ayant amenés à Agagna, il leur fut permis de s’y
établir.
D. Pareno montra, par ses comptes, que la dépense de cette expédition
s’étoit élevée à 529 piastres [2 872 francs], tant pour le paiement
des pirogues que pour la gratification qu’il disoit avoir accordée au détachement.
Le 2 5 septembre 1812, trop tard pour ie bien de ces îies, D. Pareno
remit enfin ie gouvernement des Mariannes à D. José de Médi-
nillay Pinéda, iieutenant d’infanterie (i). L’administration paternelle de
ce nouveau gouverneur në tarda point à ramener le bonheur et le calme
dans un pays qu’il eût été facile de rendre florissant, si ies arbitres
suprêmes de ses destinées l’avoient envisagé d’un oeil moins prévenu :
mais quel espoir de prospérité eût-il pu concevoir, lorsque les gouverneurs
généraux des Philippines et les vice-rois du Mexique ne iui
montroient qu’une malveillante indifférence. Naguère encore iis avoient
proposé au roi d’Espagne de l’abandonner à son propre sort, ainsi que
les îles Babuyanes, avec dix-huit ou vingt-deux mille chrétiens qui s’y
trouvent, parce que, disoient-iis, ces colonies coûtent beaucoup et ne
rapportent rien à ¡’Espagne.
Pendant les premiers temps de ia gestion de D. Médinilia, on expédioit
annuellement du Mexique à Maniiie ies fonds nécessaires à ¡’administration
des Mariannes ; mais instruit que , sous divers prétextes, ie gouverneur
des Philippines ne ies faisoit pas parvenir à leur destination, on
cessa tout envoi de cette nature, sur ia présomption sans doute qu’on
pouvoit bien s’en passer à Goam. Des obstacles aussi peu motivés paralysèrent
en partie ies efforts de D. Médinilia pour améliorer la situation
de ces îles ; et ia guerre des Espagnois-Américains insurgés vint susciter
( I ) C e respectable offic ie r, né à S e v ille , avoit demeuré trente-trois ans en Am é riq u e , dont
quatorze à L im a , d ’où il fut envoyé à M anille en décembre 18 0 9 . Après un séjour de deux
ans aux Philippines, il fut promu à la charge de gouverneur des M arian ne s , qu’ il occupoit
encore en 1 8 1 9 , quand tU r a n ie abandonna ces rivages.
Histoire.
1 8 1 4 ,
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 225
de nouvelles entraves à son zèle, en rendant plus difficiles les commu- Ile s Mariannes,
nications entre Goam et les Philippines.
Le nombre des bâtimens qui relâchoient alors aux Mariannes étoit en
général peu considérable. Depuis iong-temps, les gaiions qui ailoient
d’AcapuIco à Manille ne s’arrêtoient plus sur ia route ; en sorte que souvent
plusieurs années s’écouloient sans qu’aucun navire étranger à la coionie
parût même en vue de ia côte. Il y a tei gouverneur qui, pendant
toute ia durée de ses fonctions, n’a vu d’autres vaisseaux que celui qui l’a
apporté et celui qui est venu ie reprendre.
La flotte carolinoise de Lamoursek, qui prit terre à Agagna en i 8 i 4 ,
consistoit en dix-huit pros ou pirogues. Dans ie courant de ia même
année, la frégate de la compagnie des Philippines , le Santiago, se perdit
sur i’extrémité Sud du banc de Galalan, à 1 entrée du port San-Luis
(pl. 59). Ge navire portoit 5 12 000 piastres [ 2 780 160 francs] en
espèces monnoyées, et pour une valeur supérieure en marchandises
diverses : tout fut englouti par ies flots. Gependant les sages dispositions
prises par D. Médinilia, et l’activité qu’il déploya dans cette circonstance,
permirent de retrouver ce que la mer n’avoit pu détruire. Des
plongeurs carolinois retirèrent toutes les piastres, éparses sur le fond à
une profondeur de plus de 13 pieds d’eau, et les remirent fidèlement au
gouverneur; quantité d’autres objets d’armement et quelques marchandises
furent également sauvés. Quant à la frégate, eiie avoit teilement
souffert qu’il fallut ia démolir.
On apprit à Goam, en 181 5, qu’une colonie d’Anglo-Américains,
d’Anglais et de Sandwichiens s’étoit établie sur l’île Grigan, l’une des
plus septentrionales de l’archipel des Mariannes [voy. ci-après la carte
de la page 2 2 9 ) ; des troupes furent envoyées pour ia détruire et ramener
à Agagna ies quarante-huit personnes qui s’y trouvoient : les
Sandwichiens seuls sont restés depuis dans cette dernière ville.
Quelques navires américains et anglais qui faisoient, en 18 0 7 , ie
commerce du bois de sandal, avoient successivement laissé sur Grigan cent
personnes, parmi lesquelles on comptoit encore, en 181 5, huit Anglo-
Américains ou Anglais, seize femmes et huit hommes sandwichiens ,
enfin seize enfans métis. Le reste des colons s’étant brouillés avec ceux-
Voyage de VUranie. — Historique. T . II. f f
1 8 1 5 ,
•I
! ' i
i «" 'i
>ild