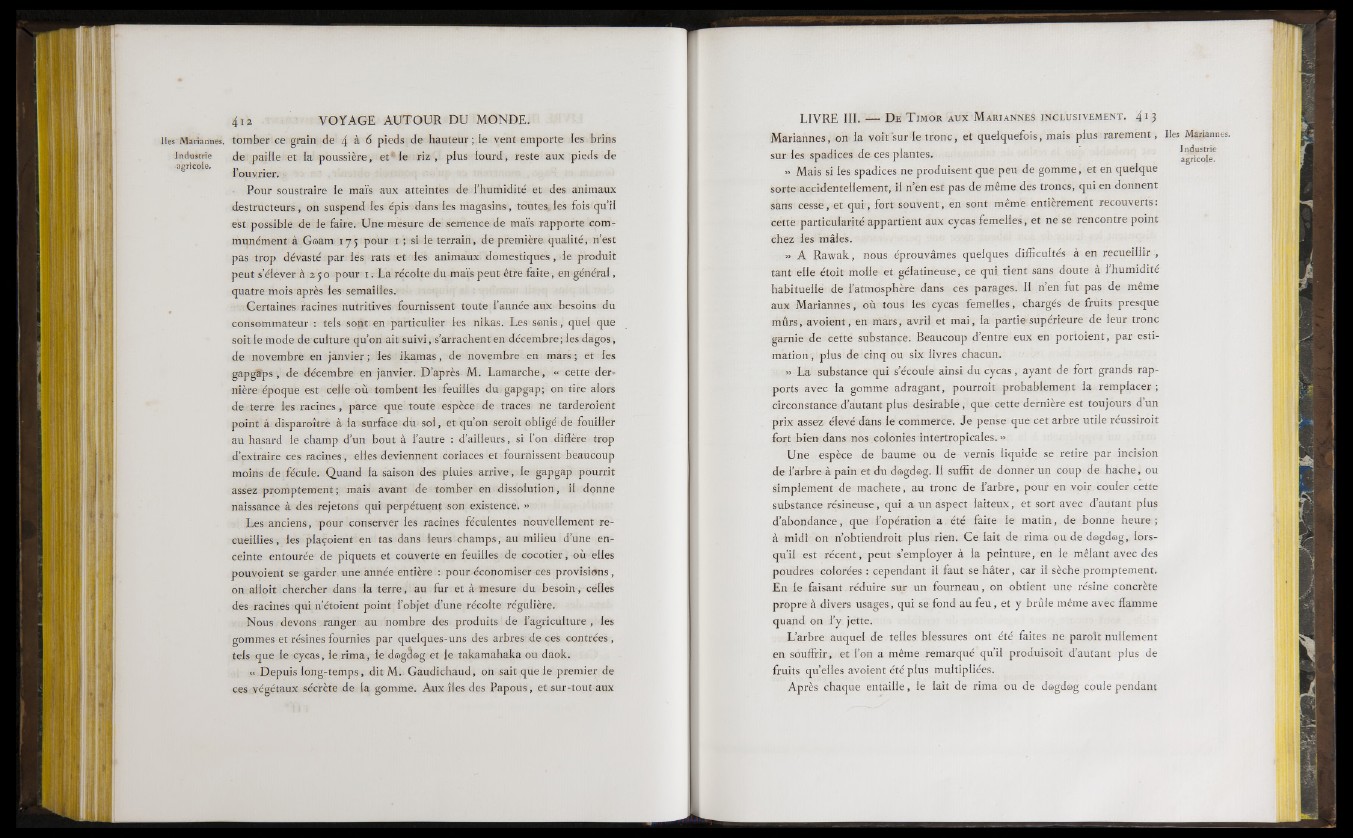
Industrie
agricole.
î! ItM'
iu i' 1
VA. jwS i
“i i
■I \Yii
i i i
•Gtì' '■*
Iles Mariannes. tomber ce grain de 4 à 6 pieds de hauteur ; ie vent emporte les brins
de paille et la poussière, et le riz , plus lourd, reste aux pieds de
l’ouvrier.
Pour soustraire le maïs aux atteintes de l’humidité et des animaux
destructeurs , on suspend les épis dans les magasins, toutes les fois qu’ii
est possible de ie faire. Une mesure de semence de maïs rapporte communément
à Goam 17 5 pour i ; si le terrain, de première qualité, n’est
pas trop dévasté par les rats et ies animaux domestiques , ie produit
peut s’élever à 2 5 o pour i . La récolte du maïs peut être faite, en général,
quatre mois après ies semailles.
Certaines racines nutritives fournissent toute l’année aux besoins du
consommateur : tels sont en particulier les nikas. Les samis, quel que
soit le mode de culture qu’on ait suivi, s’arrachent en décembre ; les dagos,
de novembre en janvier ; les ikamas, de novembre en mars ; et les
gapgaps , de décembre en janvier. D’après M. Lamarche, « cette dernière
époque est celle où tombent les feuilles du gapgap; on tire alors
de terre les racines , parce que toute espèce de traces ne tarderoient
point à disparoître à la surface du sol, et qu’on seroit obligé de fouiller
au hasard le champ d’un bout à l’autre : d’ailleurs, si i’on diffère trop
d’extraire ces racines, elles deviennent coriaces et fournissent beaucoup
moins de fécule. Quand la saison des pluies arrive, ie gapgap pourrit
assez promptement; mais avant de tomber en dissolution, ii donne
naissance à des rejetons qui perpétuent son existence. »
Les anciens, pour conserver les racines féculentes nouvellement recueillies,
ies plaçoient en tas dans leurs champs, au milieu d’une enceinte
entourée de piquets et couverte en feuilles de cocotier, où elles
pouvoient se garder une année entière ; pour économiser ces provisions,
on alloit chercher dans la terre, au fur et à mesure du besoin, celles
des racines qui n’étoient point l’objet d’une récolte régulière.
Nous devons ranger au nombre des produits de l’agriculture , les
gommes et résines fournies par quelques-uns des arbres de ces contrées ,
tels que le cycas, le rima, ie dagdag et Je takamahaka ou daok.
« Depuis long-temps, dit M. Gaudichaud, on sait que le premier de
ces végétaux sécrète de la gomme. Aux îles tles Papous, et sur-tout aux
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 1 3
Mariannes, on la voit sur le ironc, et quelquefois, mais plus rarement,
sur ies spadices de ces plantes.
» Mais si les spadices ne produisent que peu de gomme, et en quelque
sorte accidentellement, il n’en est pas de même des troncs, qui en donnent
sans cesse, et qui, fort souvent, en sont même entièrement recouverts:
cette particularité appartient aux cycas femelles, et ne se rencontre point
chez les mâles.
>> A Rawak, nous éprouvâmes quelques difficultés à en recueillir ,
tant elle étoit molle et gélatineuse, ce qui tient sans doute à l’humidité
habituelle de l’atmosphère dans ces parages. II n’en fut pas de même
aux Mariannes , où tous les cycas femelles, chargés de fruits presque
mûrs, avoient, en mars, avril et mai, ia partie supérieure de leur tronc
garnie de cette substance. Beaucoup d’entre eux en portoient, par estimation
, plus de cinq ou six livres chacun.
» La substance qui s’écoule ainsi du cycas , ayant de fort grands rapports
avec ia gomme adragant, pourroit probablement la remplacer;
circonstance d’autant plus désirable, que cette dernière est toujours dun
prix assez élevé dans ie commerce. Je pense que cet arbre utile réussiroit
fort bien dans nos colonies intertropicales. »
Une espèce de baume ou de vernis liquide se retire par incision
de l’arbre à pain et du dogdag. II suffit de donner un coup de hache, ou
simplement de machete, au tronc de l’arbre, pour en voir couler cette
substance résineuse, qui a un aspect laiteux, et sort avec d’autant plus
d’abondance, que l’opération a été faite ie matin, de bonne heure ;
à midi on n’obtiendroit plus rien. Ce lait de rima ou de dogdag, lorsqu’il
est récent, peut s’employer à la peinture, en le mêlant avec des
poudres colorées : cependant ii faut se hâter, car il sèche promptement.
En le faisant réduire sur un fourneau, on obtient une résine concrète
propre à divers usages, qui se fond au feu, et y brûle même avec flamme
quand on l’y jette.
L ’arbre auquel de telles blessures ont été faites ne paroît nullement
en souffrir, et l’on a même remarqué qu’ii produisoit d’autant plus de
fruits qu’elles avoient été plus multipliées.
Après chaque entaille, le lait de rima ou de dogdag coule pendant
Industrie
agricole.