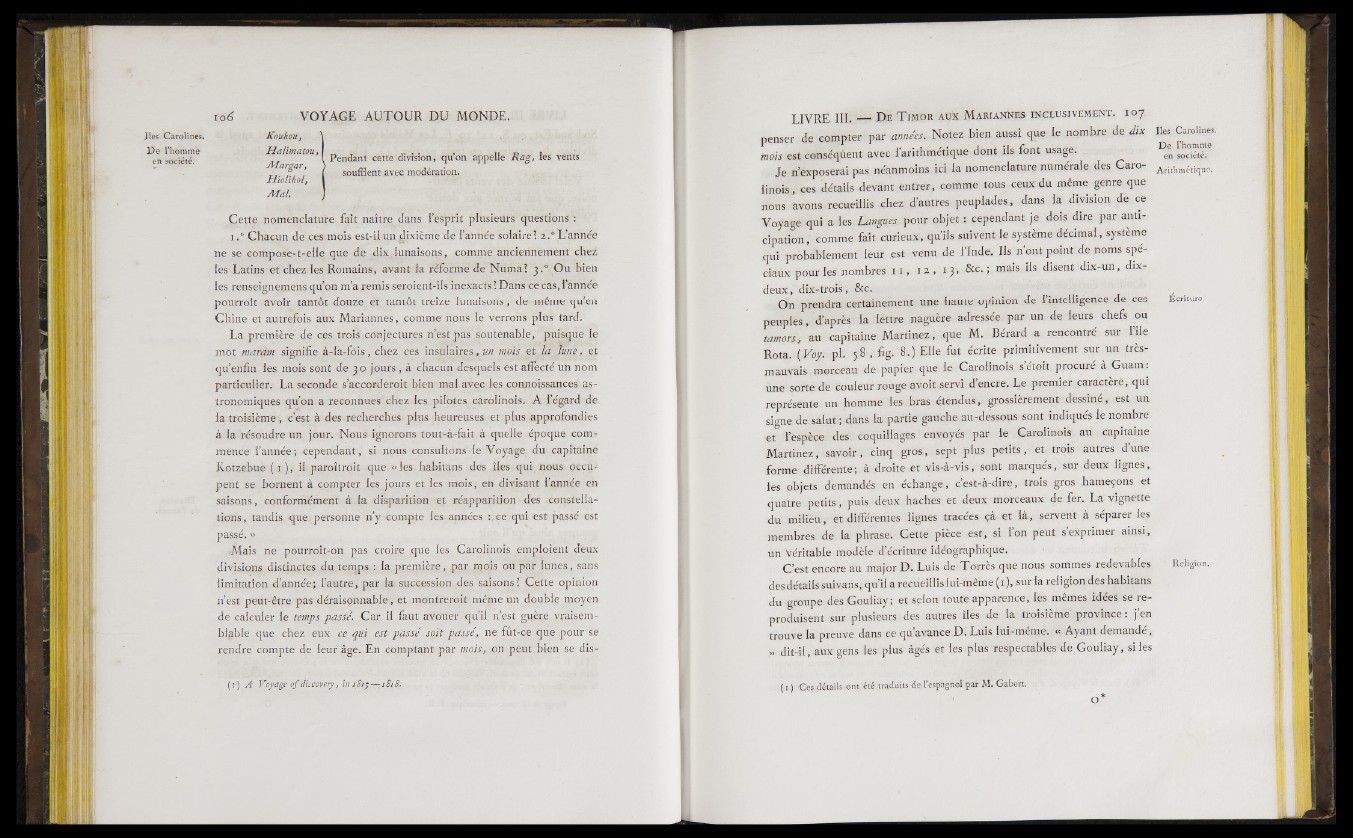
u.'il' lf> ' in
ii
D e i’homnie
en société.
Kouhou,
Halimatou,
A ia r g a r ,
Hio liho l,
M a i.
Pendant cette division, qu’on appelle R a g , les vents
soufflent avec modération.
Cette nomenclature fait naître dans i’esprit piusieurs questions :
I .° Chacun de ces mois est-il un dixième de l’année soiaire! 2.° L’année
ne se compose-t-elle que de dix iunaisons, comme anciennement chez
ies Latins et chez ies Romains, avant la réforme de Numa! 3.° Ou bien
les renseignemens qu’on m’a remis seroient-ils inexacts! Dans ce cas, l’année
pourroit avoir tantôt douze et tantôt treize lunaisons , de même qu’en
Chine et autrefois aux Mariannes, comme nous ie verrons pius tard.
La première de ces trois conjectures n’est pas soutenable, puisque le
mot maram signifie à-ia-fois, chez ces insulaires, tin mois et la lune, et
qu’enfin ies mois sont de 30 jours , à chacun desquels est affecté un nom
particulier. La seconde s’accorderoit bien mal avec les connoissances astronomiques
qu’on a reconnues chez ies pilotes carolinois. A l’égard de
la troisième, c’est à des recherches plus heureuses et plus approfondies
à ia résoudre un jour. Nous ignorons tout-à-fait à quelle époque commence
l’année; cependant, si nous consultons le Voyage du capitaine
Kotzebue ( i ), il paroîlroit que «les habitans des îles qui nous occupent
se bornent à compter les jours et les mois, en divisant i’année en
saisons, conformémient à la disparition el réapparition des constellations,
tandis que personne n’y compte ies années : ce qui est passé est
passé. »
Mais ne ponrroit-on pas croire que les Carolinois emploient deux
divisions distinctes du temps : la première, par mois ou par lunes, sans
limitation d'année; l’autre, par la succession des saisons! Cette opinion
n’est peut-être pas déraisonnable, et montreroit même un double moyen
de calculer le temps passe'. Car il faut avouer qu’il n’est guère vraisemblable
que chez eux ce qui est passé soit passé, ne fût-ce que pour se
rendre compte de ieur âge. En comptant par mois, on peut bien se dis-
( i ) A Voyage o f discovery, in i8 i^ — iS i8 .
penser de compter par années. Notez bien aussi que ie nombre de dix Iles
mois est conséquent avec l’arithmétique dont ils font usage.
Je n’êxposerai pas néanmoins ici la nomenclature numérale des Carolinois,
D e l’homme
en société.
Arithmétique.
( I ) Ce s détails ont été traduits de l’espagnol par M . Gabert.
É criture.
ces détails devant entrer, comme tous ceux du même pure que
nous avons recueillis chez d’autres peuplades, dans la division de ce
Voyage qui a ies Uingues pour objet : cependant je dois dire par anti-
cipatiOT, comme fait curieux, qu’ils suivent le système décimal, système
qui probablement leur est venu de l’Inde. Iis n’ont point de noms spéciaux
pour les nombres 1 1 , 1 2 , 13 , & c .; mais ils disent dix-un, dixdeux
, dix-trois, &c.
On prendra certainement une haute opinion de l’intelligence de ces
peuples, d’après la lettre naguère adressée par un de ieurs chefs ou
tamors, au capitaine Martinez, que M. Bérard a rencontré sur l’île
Rota. [Voy. pl. 58 , fig. 8.) Elle fut écrite primitivement sur un très-
mauvais morceau de papier que le Carolinois s étoit procuré à Guam:
une sorte de couleur rouge avoit servi d’encre. Le premier caractère, qui
représente un homme ies bras étendus, grossièrement dessiné, est un
signe de salut ; dans la partie gauche au-dessous sont indiqués le nombre
et l’espèce des coquillages envoyés par le Carolinois au capitmne
Martinez, savoir , cinq gros, sept plus petits, et trois autres d une
forme différente; à droite et vis-à-vis, sont marqués, sur deux lignes,
ies objets demandés en échange, c’est-à-dire, trois gros hameçons et
quatre petits , puis deux haches et deux morceaux de fer. La vignette
du milieu, et différentes lignes tracées çà et là, servent à séparer les
membres de la phrase. Cette pièce est, si i’on peut s’exprimer ainsi,
un véritable modèle d’écriture idéographique.
C ’est encore au major D. Luis de Torrès que nous sommes redevables
des détails suivans, qu’ii a recueillis iui-même (i), sur la religion des habitans
du groupe des Gouliay; et selon toute apparence, les mêmes idées se reproduisent
sur plusieurs des autres îles de la troisième province : j’en
trouve la preuve dans ce qu’avance D. Luis Iui-même. « Ayant demandé,
.. dit-il, aux gens les plus âgés et ies plus respectables de Gouliay, si les
Reli!
O"