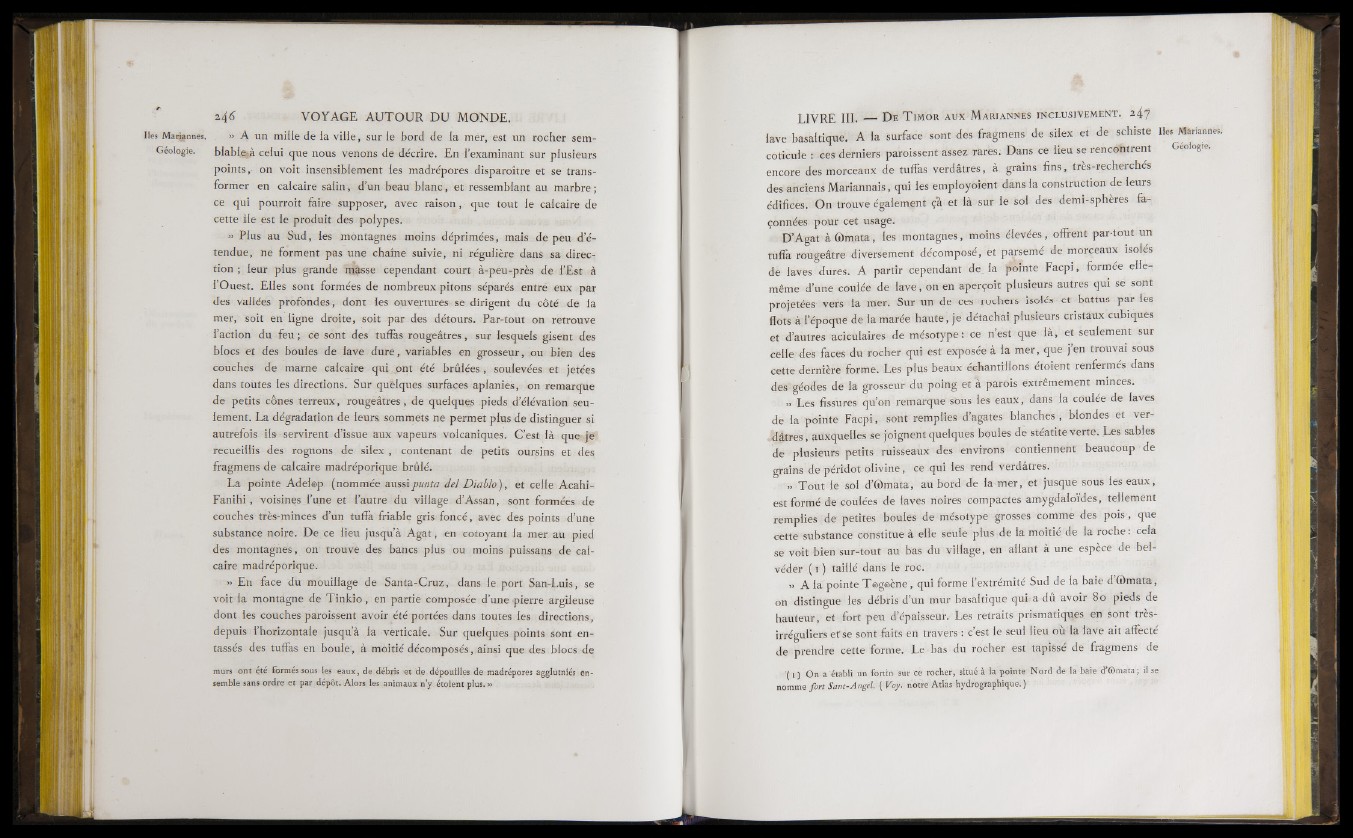
!î!
i l
Jles Mariannes. » A un mille de la ville, sur le bord de la mer, est un rocher sem-
Géologie. blahle à ceiui que nous venons de décrire. En l’examinant sur plusieurs
points, on voit insensiblement ies madrépores disparoître et se transformer
en calcaire salin, d’un beau blanc, et ressemblant au marbre;
ce qui pourroit faire supposer, avec raison, que tout ie calcaire de
cette île est le produit des polypes.
» Plus au Sud, les montagnes moins déprimées, mais de peu d’étendue,
ne forment pas une chaîne suivie, ni régulière dans sa direction
; leur plus grande masse cependant court à-peu-près de l’Est à
l’Ouest. Elles sont formées de nombreux pitons séparés entre eux par
des vallées profondes, dont ies ouvertures se dirigent du côté de la
mer, soit en ligne droite, soit par des détours. Par-tout on retrouve
l’action du feu ; ce sont des tuffas rougeâtres, sur lesquels gisent des
blocs et des boules de lave dure, variables en grosseur, ou bien des
couches de marne calcaire qui ont été brûlées, soulevées et jetées
dans toutes les directions. Sur quelques surfaces aplanies, on remarque
de petits cônes terreux, rougeâtres, de quelques pieds d’élévation seulement.
La dégradation de leurs sommets ne permet plus de distinguer si
autrefois ils servirent d’issue aux vapeurs volcaniques. C’est là que je
recueillis des rognons de silex , contenant de petits oursins et des
fragmens de calcaire madréporique brûlé.
La pointe Adelop (nommée awssïpunta del Diablo), et celle Acahi-
Fanihi , voisines i’une et l’autre du village d’Assan, sont formées de
couches très-minces d’un tuffa friable gris foncé, avec des points d’une
substance noire. De ce lieu jusqu’à Agat, en cotoyant ia mer au pied
des montagnes, on trouve des bancs plus ou moins puissans de calcaire
madréporique.
» En face du mouillage de Santa-Cruz, dans le port San-Luis, se
voit la montagne de Tinkio , en partie composée d’une pierre argileuse
dont ies couches paroissent avoir été portées dans toutes les directions,
depuis l’horizontale jusqu’à la verticale. Sur quelques points sont entassés
des tuffas en boule, à moitié décomposés, ainsi que des blocs de
murs ont été formés sous les eaux, de débris et de dépouilles de madrépores agglutniés ensemble
sans ordre et par dépôt. Alors les animaux n’y étoient plus. »
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 247
lave basaltique. A ia surface sont des fragmens de silex et de schiste lies Mariannes,
coticule : ces derniers paroissent assez rares. Dans ce iieu se rencontrent Geologie,
encore des morceaux de tuffas verdâtres, à grains fins, très-recherchés
des anciens Mariannais, qui les employoient dans la construction de ieurs
édifices. On trouve également çà et là sur ie sol des demi-sphères façonnées
pour cet usage.
D’Agat à ©mata, les montagnes, moins élevées , offrent par tout un
tuffa rougeâtre diversement décomposé, et parsemé de morceaux isolés
de laves dures. A partir cependant de la pointe Facpi, formée elle-
même d’une coulée de lave, on en aperçoit plusieurs autres qui se sont
projetées vers ia mer. Sur un de ces rochers isolés et battus par les
flots à l’époque de la marée haute, je détachai plusieurs cristaux cubiques
et d’autres aciculaires de mésotype: ce n’est que là, et seulement sur
celle des faces du rocher qui est exposée à la mer, que j’en trouvai sous
cette dernière forme. Les plus beaux échantillons étoient renfermés dans
des géodes de ia grosseur du poing et à parois extrêmement minces.
» Les fissures qu’on remarque sous les eaux, dans la coulée de laves
de la pointe Facpi, sont remplies d’agates blanches , blondes et verdâtres,
auxquelles se joignent quelques boules de stéatite verte. Les sables
de plusieurs petits ruisseaux des environs contiennent beaucoup de
grains de péridot olivine, ce qui ies rend verdâties.
.. Tout le sol d’ômata, au bord de la mer, et jusque sous les eaux,
est formé de coulées de laves noires compactes amygdaloïdes, tellement
remplies de petites boules de mésotype grosses comme des pois , que
cette substance constitue à elle seuie plus de la moitié de la roche : cela
se voit bien sur-tout au bas du viliage, en allant à une espèce de belvéder
( i ) taillé dans ie roc.
» A la pointe Tûgfflène, qui forme l’extrémité Sud de la baie d’ômata,
on distingue les débris d’un mur basaltique qui a du avoir 80 pieds de
hauteur, et fort peu d’épaisseur. Les retraits prismatiques en sont très-
irréguliers ef se sont faits en travers : c’est le seul lieu où la lave ait affecté
de prendre cette forme. Le bas du rocher est tapisse de fragmens de
'( 1 ) On a établi un fortin sur ce rocher, situé à la pointe Nord de la baie d’Omata ; il se
n o m m e fort Sant-Anget. [Voy. notre Atlas hydrographique.)