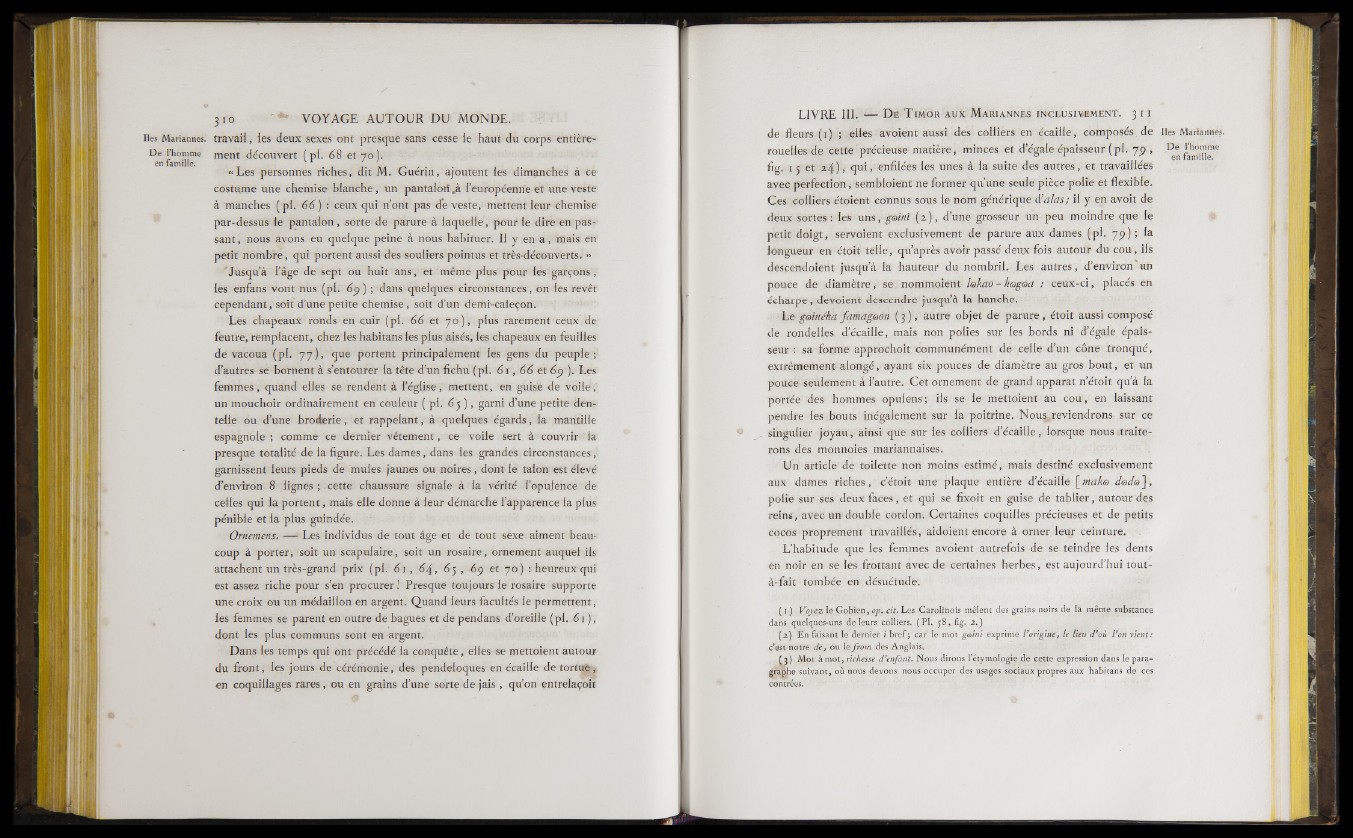
Iles Mariannes. travail, ies deux sexes ont presque sans cesse le haut du corps entière-
De rhomme rnent découvert (pl. 68 et 70).
«Les personnes riches, dit M. Guérin, ajoutent les dimanches à ce
costume une chemise blanche, un pantaiori.à i’européenne et une veste
à manches (pl. 66) : ceux qui n’ont pas de veste, mettent ieur chemise
par-dessus le pantalon, sorte de parure à laquelle, pour ie dire en passant
, nous avons eu quelque peine à nous habituer. Il y en a , mais en
petit nombre, qui portent aussi des souliers pointus et très-découverts. »
Jusqu’à i’âge de sept ou huit ans, et même plus pour ies garçons,
les enfans vont nus (pl. 69) ; dans quelques circonstances, on les revêt
cependant, soit d’une petite chemise, soit d’un demi-caleçon.
Les chapeaux ronds en cuir (pl. 66 et 70), plus rarement ceux de
feutre, remplacent, chez les habitans ies plus aisés, ies chapeaux en feuilles
de vacoua (pl. 77), que portent principalement les gens du peuple;
d’autres se bornent à s’entourer la tête d’un fichu (pl. 6 1 , 66 et 69 ). Les
femm.es, quand elies se rendent à l’église, mettent, en guise de voile,
un mouchoir ordinairement en couleur (pl. 65 ), garni d’une petite dentelle
ou d’une broderie , et rappelant, à quelques égards, ia mantille
espagnole ; comme ce dernier vêtement, ce voile sert à couvrir ia
presque totalité de la figure. Les dames , dans ies grandes circonstances ,
garnissent leurs pieds de mules jaunes ou noires, dont le talon est élevé
d’environ 8 lignes ; cette chaussure signale à la vérité l’opuience de
celles qui la portent, mais elle donne à leur démarche l’apparence la plus
pénible et la plus guindée.
Ornemens. — Les individus de tout âge et de tout sexe aiment beaucoup
à porter, soit un scapulaire, soit un rosaire, ornement auquel ils
attachent un très-grand prix (pi. 61 , 64, 65 , 69 et 70) : heureux qui
est assez riche pour s’en procurer ! Presque toujours le rosaire supporte
une croix ou un médaillon en argent. Quand leurs facultés ie permettent,
les femmes se parent en outre de bagues et de pendans d’oreille (pl. 61 ),
dont les plus communs sont en argent.
Dans les temps qui ont précédé la conquête, elies se mettoient autour
du front, ies jours de cérémonie, des pendeloques en écaiile de tortue,
en coquillages rares, ou en grains d’une sorte de jais , qu’on entrelaçoit
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 3 1 1
de fleurs (i) ; elies avoient aussi des colliers en écaille, composés de lies Mariannes.
rouelles de cette précieuse matière, minces et d’égaie épaisseur (pl. 7 9 ,
fig. 15 et 24 ), qui, enfilées les unes à la suite des autres, et travaillées
avec perfection, sembloient ne former qu’une seule pièce polie et flexible.
Ces colliers étoient connus sous le nom générique d’alas; il y en avoit de
deux sortes : les uns, goinî ( 2 ), d’une grosseur un peu moindre que le
petit doigt, servoient exclusivement de parure aux dames (pl. 79); la
longueur en étoit telle, qu’après avoir passé deux fois autour du cou, iis
descendoient jusqu’à la hauteur du nombril. Les autres, d’environ un
pouce de diamètre, se nommoient lakao - hogaa : ceux-ci, placés en
écharpe, devoient descendre jusqu’à ia hanche.
Le gaine'ha famagoon (3), autre objet de parure, étoit aussi composé
de rondelles d’écaille, mais non poiies sur les bords ni d’égale épaisseur
: sa forme approchoit communément de celle d’un cône tronqué,
extrêmement aiongé, ayant six pouces de diamètre au gros bout, et un
pouce seulement à l’autre. Cet ornement de grand apparat n’étoit qu’à la
portée des hommes opuiens ; ils se ie mettoient au cou, en laissant
pendre ies bouts inégalement sur la poitrine. Nous reviendrons sur ce
singulier joyau, ainsi que sur ies colliers d’écaille, lorsque nous traiterons
des monnoies mariannaises.
Un article de toilette non moins estimé, mais destiné exclusivement
aux dames riches, c’étoit une plaque entière d’écaille [maka dada],
poiie sur ses deux faces, et qui se fixoit en guise de tablier, autour des
reins, avec un double cordon. Certaines coquilles précieuses et de petits
cocos proprement travaillés, aidoient encore à orner leur ceinture.
L ’habitude que les femmes avoient autrefois de se teindre les dents
en noir en se les frottant avec de certaines herbes, est aujourd’hui tout-
à-fait tombée en désuétude.
( I ) Voyez le G o b ien , op. cit. L e s C a rolin ois mêlent des grains noirs de ia même substance
dans quelques-uns de leurs colliers. (P I . 5 8 , fig. 2 . )
( 2 ) E n faisant le dernier i b r e f ; car le mot g a in i exprime l'o r ig in e , le lieu d ’ où l ’on v ien t:
c’est notre d e , ou \e from des Angla is.
{ 3 ) M o t à m ot, richesse d ’enfant. Nous dirons l’étymologie de cette expression dans le paragraphe
suivant, oit nous devons nous occuper des usages sociaux propres aux habitans de ces
contrées.