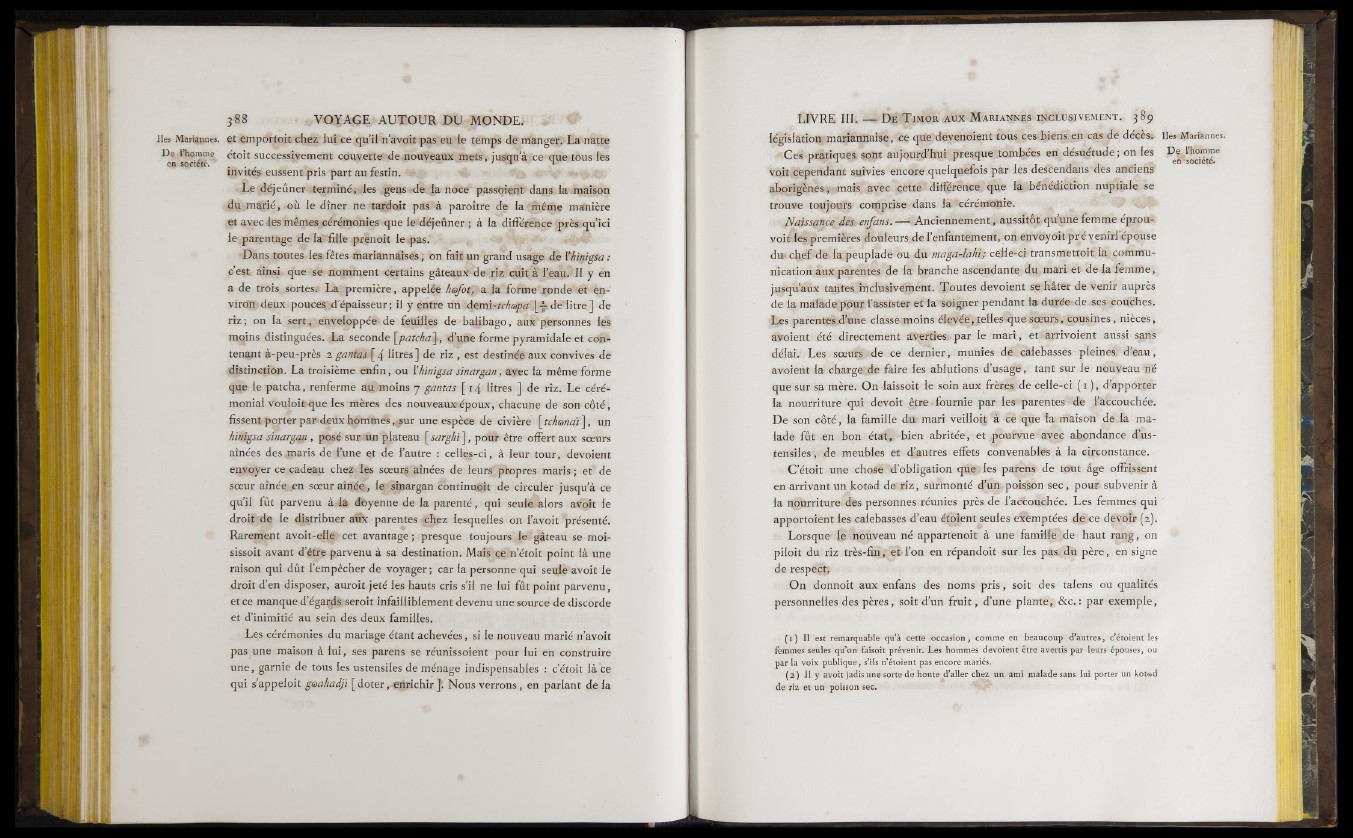
Jle s Mariannes. et emportoit chez iui ce qu’il n’avoit pas eu ie temps de manger. La natte
D e Thomme
en société.
étoit successivement couverte de nouveaux mets, jusqu’à ce que tous ies
invités eussent pris part au festin.
Le déjeûner terminé, les gens de la noce passoient dans la maison
du marié, où le dîner ne tardoit pas à paroître de ia même manière
et avec les mêmes cérémonies que le déjeûner ; à la différence près qu’ici
le parentage de ia fille prenoit ie pas.
Dans tontes les fêtes mariannaises, on fait un grand usage de ï hinigsa :
c’est ainsi que se nomment certains gâteaux de riz cuit à l’eau. Il y en
a de trois sortes. La première, appelée hofot, a la forme ronde et environ
deux pouces d’épaisseur; il y entre un àeml-tchapa [-|- de litre] de
riz; on ia sert, enveioppée de feuiiles de baiihago, aux personnes ies
moins distinguées. La seconde [patcha], d’une forme pyramidale et contenant
à-peu-près 2 gantas [ 4 litres ] de riz , est destinée aux convives de
distinction. La troisième enfin, ou ï hinigsa sinargan, avec la même forme
que le patcha, renferme au moins 7 gantas [ 14 litres ] de riz. Le cérémonial
vouioit que ies mères des nouveaux époux, chacune de son côté,
fissent porter par deux hommes, sur une espèce de civière [tchanaï], nn
hinigsa sinargan , posé sur un plateau [sarghi], pour être offert aux soeurs
aînées des maris de i’une et de l’autre : celles-ci, à ieur tour, devoient
envoyer ce cadeau chez les soeurs aînées de ieurs propres maris ; et de
soeur aînée en soeur aînée, le sinargan continuoit de circuler jusqu’à ce
qu’il fût parvenu à la doyenne de la parenté, qui seule alors avoit le
droit de le distribuer aux parentes chez lesquelles on i’avoit présenté.
Rarement avoit-elle cet avantage ; presque toujours le gâteau se moi-
sissoit avant d’être parvenu à sa destination. Mais ce n’étoit point ià une
raison qui dût l’empêcher de voyager; car la personne qui seule avoit le
droit d’en disposer, auroit jeté ies hauts cris s’il ne iui fût point parvenu,
et ce manque d’égards seroit infailliblement devenu une source de discorde
et d’inimitié au sein des deux familles.
Les cérémonies du mariage étant achevées, si le nouveau marié n’avoit
pas une maison à lui, ses parens se réunissoient pour iui en construire
une, garnie de tous ies ustensiles de ménage indispensables : c’étoit là ce
qui s’appeloit gaahadji [doter, enrichir]. Nous verrons, en parlant de ia
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t , 389
législation mariannaise, ce que devenoient tous ces biens en cas de décès. Iles Mariannes.
Ces pratiques sont aujourd’hui presque tombées en désuétude ; on ies De 'L“ ™?'"
voit cependant suivies encore quelquefois par les descendans des anciens
aborigènes, mais avec cette différence que la bénédiction nuptiale se
trouve toujours comprise dans ia cérémonie.
Naissance des enfans.— Anciennement, aussitôt qu’une femme éprouvoit
ies premières douleurs dei’enfantement, on envoyoitprévenirl’épouse
du chef de la peuplade ou du ?naga-lahi; celle-ci transmettait ia communication
aux parentes de ia branche ascendante du mari et de la femme,
jusqu’aux tantes inclusivement. Toutes devoient se hâter de venir auprès
de la malade pour l’assister et la soigner pendant la durée de ses couches.
Les parentes d’une classe moins élevée, telles que soeurs, cousines , nièces,
avoient été directement averties par le mari, et arrivoient aussi sans
délai. Les soeurs de ce dernier, munies de calebasses pleines d’eau,
avoient ia charge de faire ies ablutions d’usage, tant sur le nouveau né
que sur sa mère. On iaissoit le soin aux frères de celle-ci (i ), d’apporter
ia nourriture qui devoit être fournie par ies parentes de l’accouchée.
De son côté, la famille du mari veilloit à ce que ia maison de la malade
fût en bon état, bien abritée, et pourvue avec abondance d’ustensiles
, de meubles et d’autres effets convenables à la circonstance.
C ’étoit une chose d’obligation que les parens de tout âge offrissent
en arrivant un kotod de riz, surmonté d’un poisson sec, pour subvenir à
ia nourriture des personnes réunies près de l’accouchée. Les femmes qui
apportoient les caiebasses d’eau étoient seules exemptées de ce devoir (2).
Lorsque le nouveau né appartenoit à une famiile de haut rang, on
piloit du riz très-fin, et i’on en répandoit sur les pas du père, en signe
de respect.
On donnoit aux enfans des noms pris, soit des taiens ou qualités
personnelles des pères, soit d’un fruit, d’une plante, &c. : par exemple,
( 1 ) II est remarquable qu’à cette o c c a s io n , comme en beaucoup d’a u tre s, c’étoient les
femmes seules qu’on faisoit prévenir. L e s hommes devoient être avertis par leurs épouses, ou
par la vo ix publiqu e, s’ ils n’ étoient pas encore mariés.
( 2 ) I l y avoit jadis une sorte de honte d’aller chez un ami malade sans lui porter un kotod
de riz et un poisson sec.