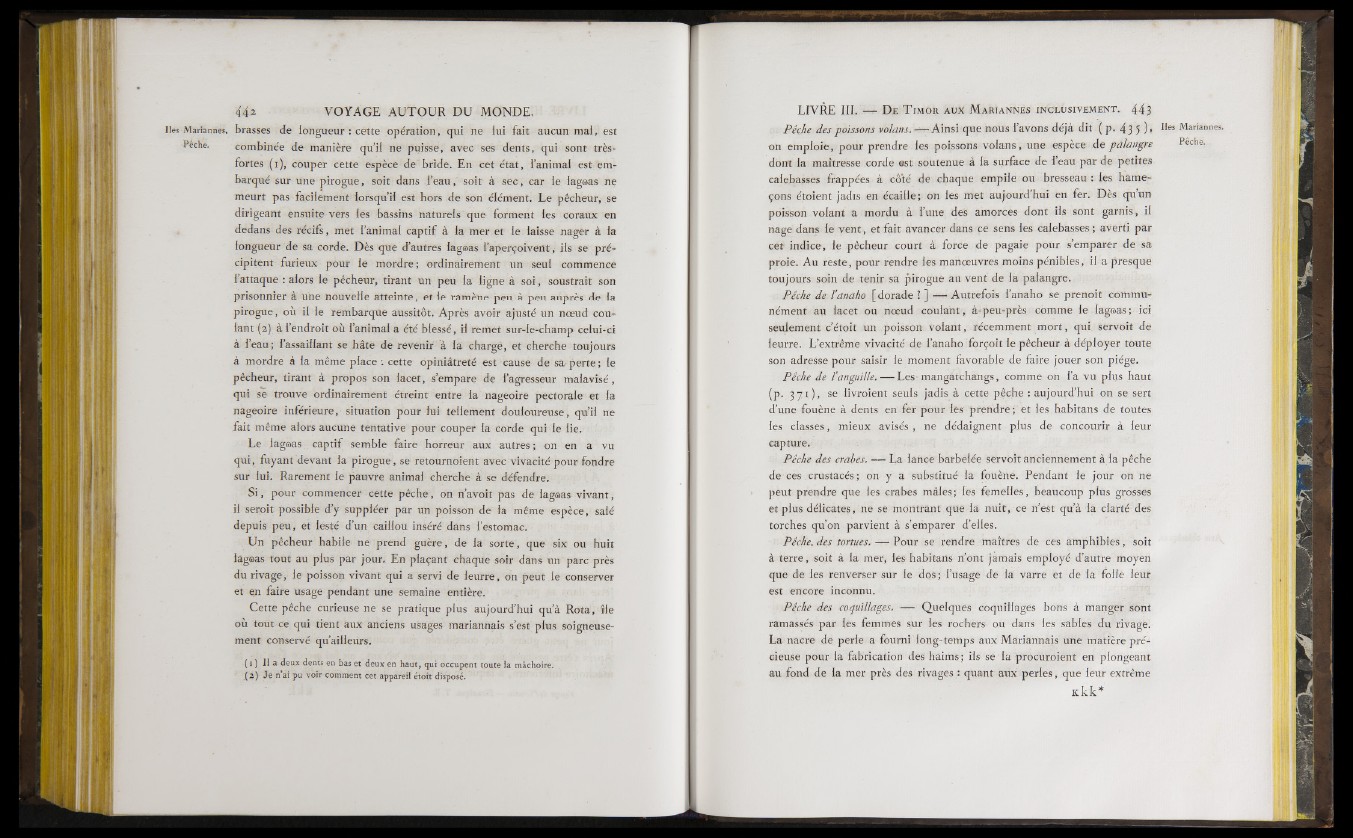
lies Mariannes. brasses de longueur : cette opération, qui ne ini fait aucun mal, est
Peche. combinée de manière qu’il ne puisse, avec ses dents, qui sont trèsfortes
(i), couper cette espèce de bride. En cet état, l’animal est embarqué
sur une pirogue, soit dans l’eau, soit à sec, car le lagoas ne
meurt pas facilement lorsqu’il est hors de son élément. Le pêcheur, se
dirigeant ensuite vers les bassins naturels que forment les coraux en
dedans des récifs, met i’animal captif à la mer et le laisse nager à la
longueur de sa corde. Dès que d’autres lagoas l’aperçoivent, ils se précipitent
furieux pour le mordre; ordinairement un seul commence
l’attaque : alors le pêcheur, tirant un peu la ligne à soi, soustrait son
prisonnier à une nouvelle atteinte, et le ramène peu à peu auprès de la
pirogue, où il le rembarque aussitôt. Après avoir ajusté un noeud coulant
(2) à l’endroit où l’animal a été biessé, il remet sur-le-champ celui-ci
à l’eau; l’assaillant se hâte de revenir â ia charge, et cherche toujours
à mordre à ia même piace ; cette opiniâtreté est cause de sa perte ; le
pêcheur, tirant à propos son lacet, s’empare de l’agresseur malavisé,
qui se trouve ordinairement étreint entre la nageoire pectorale et la
nageoire inférieure, situation pour lui tellement douloureuse, qu’il ne
fait même alors aucune tentative pour couper la corde qui le lie.
Le lagoas captif semble faire horreur aux autres ; on en a vu
qui, fuyant devant la pirogue, se retournoient avec vivacité pour fondre
sur lui. Rarement le pauvre animal cherche à se défendre.
S i, pour commencer cette pêche, on n’avoit pas de lagoas vivant,
il seroit possible d’y suppléer par un poisson de ia même espèce, saié
depuis peu, et lesté d’un caillou inséré dans l’estomac.
Un pêcheur habile ne prend guère, de ia sorte, que six ou huit
lagoas tout au plus par jour. En plaçant chaque soir dans un parc près
du rivage, le poisson vivant qui a servi de leurre, on peut le conserver
et en faire usage pendant une semaine entière.
Gette pêche curieuse ne se pratique plus aujourd’hui qu’à Rota, île
où tout ce qui tient aux anciens usages mariannais s’est plus soigneusement
conservé qu’ailleurs.
( I ) l i a deux dents en bas et deux en haut, qui occupent toute la mâchoire.
(z) Je n’ ai pu voir comment cet appareil étoit disposé.
Pêche des poissons volans.— Ainsi que nous l’avons déjà dit ( p. 43 5 ).
on emploie, pour prendre les poissons volans, une espèce de palangre
dont la maîtresse corde est soutenue à la surface de l’eau par de petites
calebasses frappées à côté de chaque empile ou bresseau : les hameçons
étoient jadis en écaille; on les met aujourd’hui en fer. Dès qu’un
poisson volant a mordu à i’une des amorces dont ils sont garnis, ii
nage dans le vent, et fait avancer dans ce sens les calebasses; averti par
cet indice, le pêcheur court à force de pagaie pour s’emparer de sa
proie. Au reste, pour rendre les manoeuvres moins pénibles, il a presque
toujours soin de tenir sa pirogue au vent de la palangre.
Pêche de l’anaho [dorade î ] — Autrefois l’anaho se prenoit communément
au lacet ou noeud coulant, à-peu-près comme le lagoas; ici
seulement c’étoit un poisson volant, récemment mort, qui servoit de
leurre. L’extrême vivacité de l’anaho forçoit ie pêcheur à déployer toute
son adresse pour saisir le moment favorable de faire jouer son piège.
Pêche de l'anguille. — Les mangatchangs, comme on l’a vu plus haut
(p. 3 7 1 ) , se livroient seuls jadis à cette pêche : aujourd’hui on se sert
d’une fouène à dents en fer pour les prendre ; et les habitans de tontes
les classes, mieux avisés , ne dédaignent plus de concourir à leur
capture.
Pêche des crabes. — La lance barbelée servoit anciennement à la pêche
de ces crustacés; on y a substitué la fouène. Pendant le jour on ne
peut prendre que les crabes mâles; les femelles, beaucoup plus grosses
et plus délicates, ne se montrant que la nuit, ce n’est qu’à la clarté des
torches qu’on parvient à s’emparer d’elles.
Pêche, des tortues. — Pour se rendre maîtres de ces amphibies , soit
à terre, soit à ia mer, les habitans n’ont jamais employé d’autre moyen
que de les renverser sur le dos ; l’usage de la varre et de la folle leur
est encore inconnu.
Pêche des coquillages. — Quelques coquillages bons à manger sont
ramassés par les femmes sur les rochers ou dans les sables du rivage.
La nacre de perie a fourni long-temps aux Mariannais une matière précieuse
pour la fabrication des haims; ils se la procuroient en plongeant
au fond de la mer près des rivages : quant aux perles, que leur extrême
K k k *