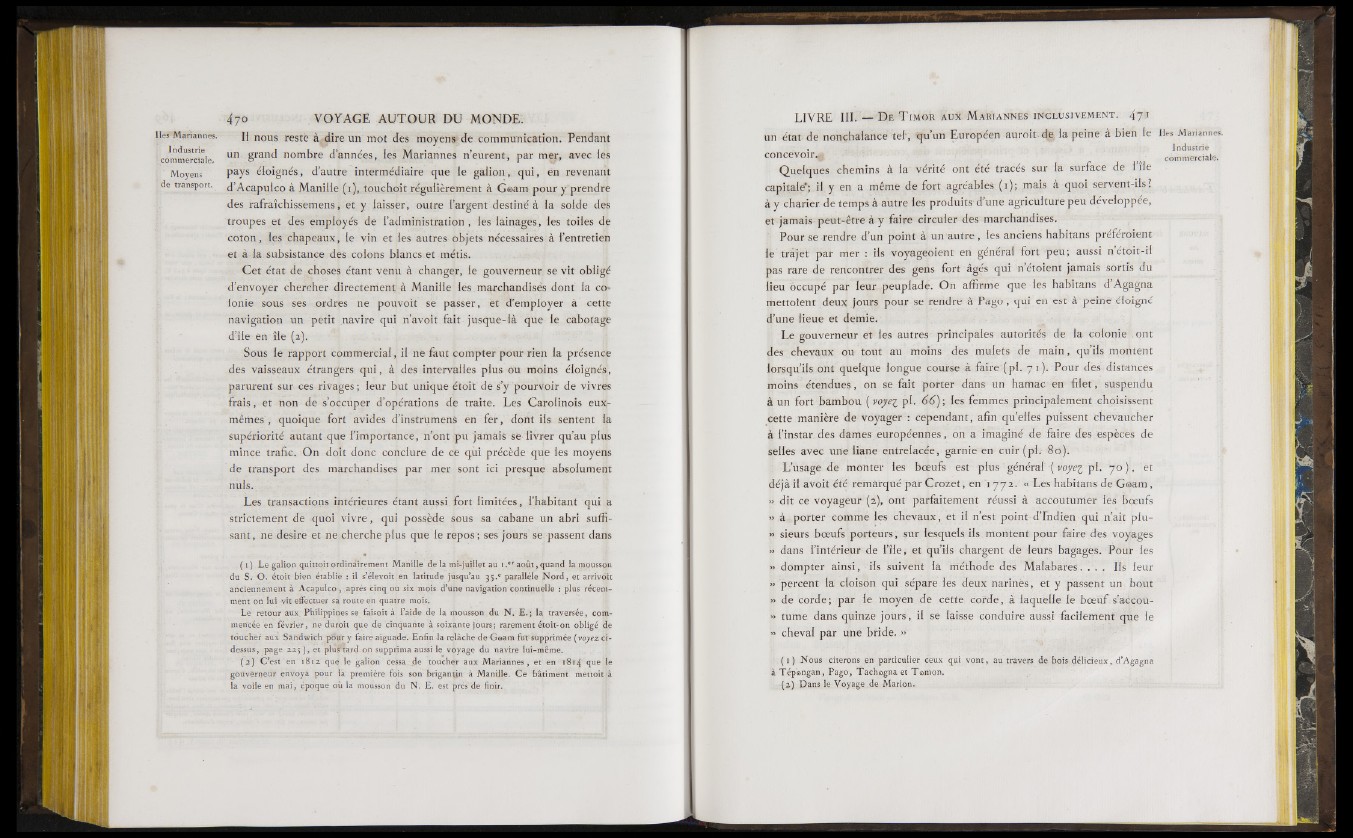
Industrie
commerciale.
Moyens
de transport.
Ii nous reste à dire un mot des moyens de communication. Pendant
un grand nombre d’années, les Mariannes n’eurent, par mer, avec les
pays éloignés, d’autre intermédiaire que le galion, qui, en revenant
d’AcapuIco à Manille (i), touchoit régulièrement à Gaam pour y prendre
des rafraîchissemens, et y laisser, outre i’argent destiné à la solde des
troupes et des employés de l’administration , les lainages, les toiles de
coton, les chapeaux, le vin et les autres objets nécessaires à l’entretien
et à la subsistance des colons blancs et métis.
Cet état de choses étant venu à changer, le gouverneur se vit obiigé
d’envoyer chercher directement à Maniiie les marchandises dont la colonie
sous ses ordres ne pouvoit se passer, et d’employer à cette
navigation un petit navire qui n’avoit fait jusque-ià que le cabotage
d’île en île (2).
Sous ie rapport commercial, il ne faut compter pour rien la présence
des vaisseaux étrangers qui, à des intervalles plus ou moins éloignés,
parurent sur ces rivages; leur but unique étoit de s’y pourvoir de vivres
frais , et non de s’occuper d’opérations de traite. Les Carolinois eux-
mêmes , quoique fort avides d’instrumens en fer, dont ils sentent ia
supériorité autant que l’importance, n’ont pu jamais se livrer qu’au pius
mince trafic. On doit donc conclure de ce qui précède que les moyens
de transport des marchandises par mer sont ici presque absolument
nuls.
Les transactions intérieures étant aussi fort limitées, l’habitant qui a
strictement de quoi vivre, qui possède sous sa cabane un abri suffisant,
ne desire et ne cherche plus que le repos; ses jours se passent dans
( i ) L e galion quittoit ordinairement M an ille de la mi-juiilet au i a o û t, quand la mousson
du S . O. étoit bien établie : il s’éievoit en latitude jusqu’au 35.® parallèle N o rd , et a rrivoit
anciennement à A c a p u lc o , après cinq ou six mois d’une navigation continuelle : plus récemment
on lui vit effectuer sa rouie en quatre mois.
Le retour aux Philippines se faisoit à l’aide de la mousson du N . E . ; la traversée , commencée
en fé v r ie r , ne duroil que de cinquante à soixante jours; rarement étoit-on obligé de
toucher aux Sandwich pour y faire aiguade. Enfin ia relâche de Goam fut supprimée (voyez ci-
dessus, page 2 2 5 ) , et plus tard on supprima aussi le voyage du navire lui-même.
( 2 ) C ’est en 1 8 1 2 que le galion cessa de toucher aux M a r ian n e s , et en 1 8 1 4 que le
gouverneur envoya pour la première fois son brigantin à Manille. C e bâtiment mettoit à
la voile en m a i, époque où la mousson du N . E . est près de finir.
un état de nonchalance tel, qu’un Européen auroit de la peine à bien le Jle s Mariannes.
Industrie
concevou. commerciale.
Quelques chemins à la vérité ont été tracés sur la surface de i’île
capitale; il y en a même de fort agréables (i); mais à quoi servent-ils?
à y charier de temps à autre les produits d’une agricuiture peu développée,
et jamais peut-être à y faire circuler des marchandises.
Pour se rendre d’un point à un antre , ies anciens habitans preferoient
le trajet par mer ; ils voyageoient en général fort peu; aussi n étoit-il
pas rare de rencontrer des gens fort âgés qui n’étoient jamais sortis du
lieu occupé par leur peuplade. On affirme que les habitans d’Agagna
mettoient deux jours pour se rendre à Pago , qui en est à peine éloigné
d’une lieue et demie.
Le gouverneur et les autres principales autorités de la colonie ont
des chevaux ou tout au moins des mulets de main, qu’ils montent
lorsqu’ils ont quelque longue course à faire (pl. 7 1) . Pour des distances
moins étendues , on se fait porter dans un hamac en filet, suspendu
à un fort bambou (voyez pi. 66); les femmes principalement choisissent
cette manière de voyager : cependant, afin qu’elles puissent chevaucher
à l’instar des dames européennes, on a imaginé de faire des espèces de
selles avec une liane entrelacée, garnie en cuir (pl. 80).
L ’usage de monter ies boeufs est plus général ( voyez pù 7 ° ) >
déjà il avoit été remarqué par Crozet, en 1772 - « Les habitans de Gaam ,
» dit ce voyageur (2), ont parfaitement réussi à accoutumer les boeufs
» à porter comme les chevaux, et il n’est point d’Indien qui n’ait plu-
» sieurs boeufs porteurs, sur iesqueis ils montent pour faire des voyages
» dans i’intérieur de l’île, et qu’ils chargent de leurs bagages. Pour ies
» dompter ainsi, ils suivent la méthode des Malabares. . . . Ils leur
» percent la cloison qui sépare les deux narines, et y passent un bout
» de corde ; par le moyen de cette corde, à laquelle le boeuf s’accou-
» tume dans quinze jours, il se iaisse conduire aussi facilement que le
» cheval par une bride. »
( 1 ) N ous citerons en particulier ceux qui v o n t , au travers de bois d é lic ieu x , d’Agagn a
à Téptangan, P a g o , T a ch o gn a et T om on .
(2 ) Dans le V o y a g e de Marion.