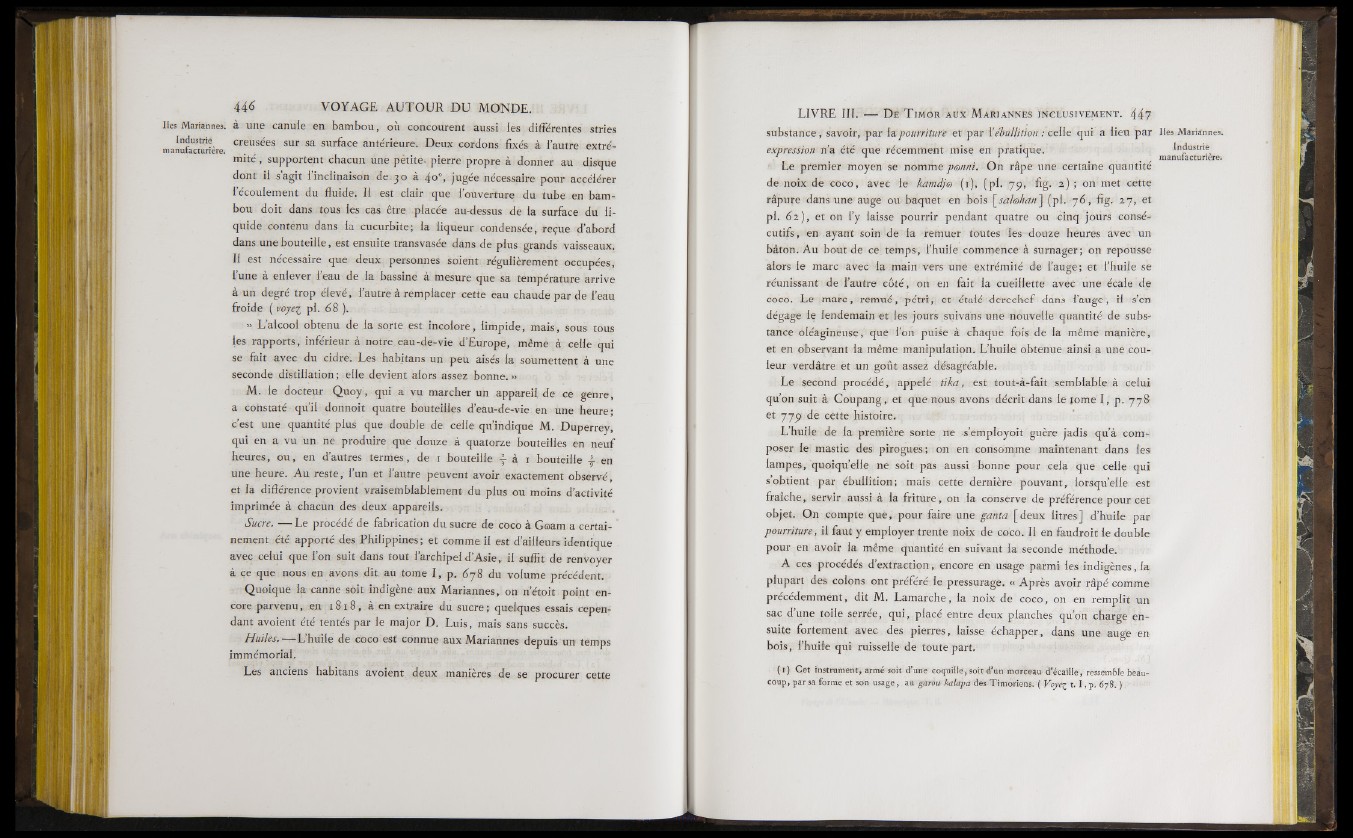
mm
i l ï f
Iles Mariannes, à une canule en bambou, où concourent aussi les différentes stries
m a iu fa a u r iè r e sur sa surface antérieure. Deux cordons fixés à l’autre extrémité
, supportent chacun une petite pierre propre à donner au disque
dont il s’agit l’inclinaison de 30 à 4o% jugée nécessaire pour accélérer
l’écoulement du fluide. Il est clair que l’ouverture du tube en bambou
doit dans tous les cas être placée au-dessus de la surface du liquide
contenu dans ia cucurbite; la liqueur condensée, reçue d’abord
dans une bouteille, est ensuite transvasée dans de plus grands vaisseaux.
Il est nécessaire que deux personnes soient régulièrement occupées,
l’une à enlever l’eau de la bassine à mesure que sa température arrive
à un degré trop éievé, l’autre à remplacer cette eau chaude par de l’eau
froide ( voyez pl. 68 ).
» L’alcool obtenu de la sorte est incolore, limpide, mais, sous tous
les rapports, inférieur à notre eau-de-vie d’Europe, même à celle qui
se fait avec du cidre. Les habitans un peu aisés la soumettent à une
seconde distillation; elle devient alors assez bonne.»
M. le docteur Quoy, qui a vu marcher un appareil de ce genre,
a constaté qu’il donnoit quatre bouteilles d’eau-de-vie en une heure;
c’est une quantité pius que doubie de celie qu’indique M. Duperrey,
qui en a vu un ne produire que douze à quatorze bouteilles en neuf
heures, ou, en d’autres termes, de i bouteille f à i bouteille ] en
une heure. Au reste, l’un et l’autre peuvent avoir exactement observé,
et la différence provient vraisemblablement du plus ou moins d’activité
imprimée à chacun des deux appareils.
Sucre. — Le procédé de fabrication du sucre de coco à Goam a certainement
été apporté des Philippines; et comme il est d’ailleurs identique
avec celui que l’on suit dans tout l’archipel d’Asie, il suffit de renvoyer
à ce que nous en avons dit au tome I, p. 678 du volume précédent.
Quoique la canne soit indigène aux Mariannes, on n’étoit point encore
parvenu, en 1 8 i 8 , à en extraire du sucre ; quelques essais cependant
avoient été tentés par le major D. Luis, mais sans succès.
Huiles.— L’huile de coco est connue aux Mariannes depuis un temps
immémorial.
Les anciens habitans avoient deux manières de se procurer cette
E m* *'
LIVRE IJI. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 4 7
substance , savoir, par la pourriture et par ï ébullition ; celie qui a iieu par lies Mariannes.
expression n’a été que récemment mise en pratique. Industrie
^ ^ ^ manuracturiere.
Le premier moyen se nomme panni. On râpe une certaine quantité
de noix de coco, avec le kamdja (i), (pi. 79, fig. 2) ; on met cette
râpure dans une auge ou baquet en bois [salahan] (pl. 76 , fig. 27, et
pl. 62 ), et on l’y laisse pourrir pendant quatre ou cinq jours consécutifs,
en ayant soin de la remuer toutes les douze heures avec un
bâton. Au bout de ce temps, l’huile commence à surnager; on repousse
alors ie marc avec la main vers une extrémité de l’auge; et l’huile se
réunissant de l’autre côté, on en fait ia cueillette avec une écale de
coco. Le marc, remué, pétri, et étalé derechef dans l’auge, il s’en
dégage le lendemain et ies jours suivans une nouvelle quantité de substance
oléagineuse, que i’on puise à chaque fois de la même manière,
et en observant la même manipulation. L’huile obtenue ainsi a une couleur
verdâtre et un goût assez désagréable.
Le second procédé, appelé tika, est tout-à-fait semblable à celui
qu’on suit à Coupang, et que nous avons décrit dans le tome I, p. 778
et 779 de cette histoire.
L’huile de la première sorte ne s’employoit guère jadis qu’à composer
le mastic des pirogues; on en consomme maintenant dans les
lampes, quoiqu’elle ne soit pas aussi bonne pour ceia que celle qui
s’obtient par ébullition; mais cette dernière pouvant, lorsqu’elle est
fraîche, servir aussi à la friture, on ia conserve de préférence pour cet
objet. On compte que, pour faire une ganta [deux litres] d’huile par
pourriture, il faut y employer trente noix de coco. Il en faudroit le double
pour en avoir la même quantité en suivant la seconde méthode.
A ces procédés d’extraction, encore en usage parmi les indigènes, ia
plupart des colons ont préféré le pressurage. « Après avoir râpé comme
précédemment, dit M. Lamarche, la noix de coco, on en remplit un
sac d’une toile serrée, qui, piacé entre deux planches qu’on charge ensuite
fortement avec des pierres, laisse échapper, dans une auge en
bois, l’huile qui ruisselle de toute part,
( I ) Cet instrument, armé soit d’une coquille, soit d’un morceau d’écaille, ressemble beaucoup,
par sa forme et son usage, au garou halapa des Timoriens. ( Voyez 1 . 1, p. 678. )