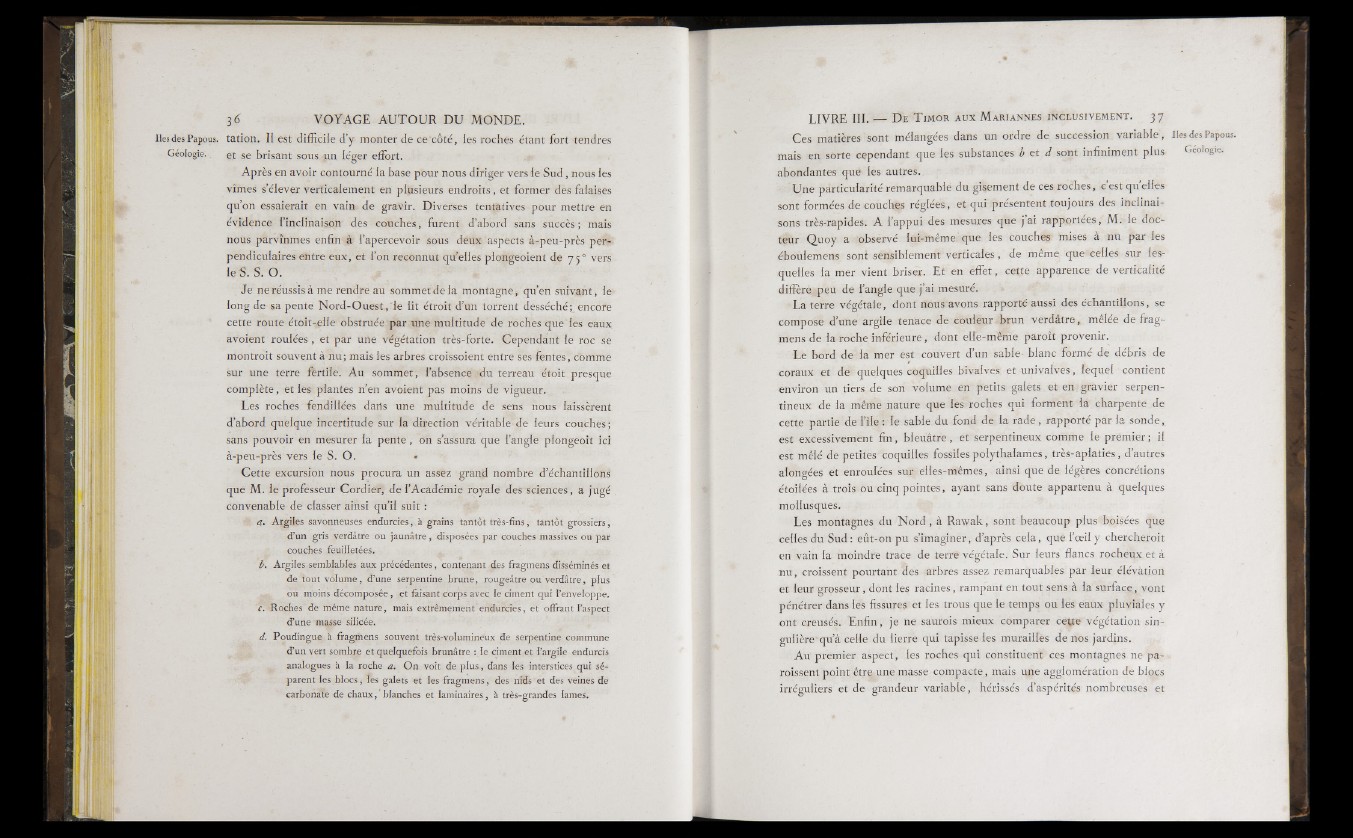
Ile s des Papous, tation. II est difficile d’y monter de ce côté, les roches étant fort tendres
Géolo g ie . et se brisant sous un léger effort.
Après en avoir contourné la base pour nous diriger vers ie Sud, nous les
vîmes s’élever verticalement en plusieurs endroits, et former des falaises
qu’on essaierait en vain de gravir. Diverses tentatives pour mettre en
évidence l’inclinaison des couches, furent d’abord sans succès ; mais
nous parvînmes enfin à l’apercevoir sous deux aspects à-peu-près perpendiculaires
entre eux, et l’on reconnut qu’elles piongeoient de 75° vers
le S. S. O.
Je ne réussis à me rendre au sommet de la montagne, qu’en suivant, le
long de sa pente Nord-Ouest, ie lit étroit d’un torrent desséché; encore
cette route étoit-elle obstruée par une multitude de roches que ies eaux
avoient roulées , et par une végétation très-forte. Cependant le roc se
montroit souvent à nu; mais les arbres croissoient entre ses fentes, comme
sur une terre fertile. Au sommet, i’absence du terreau étoit presque
complète, et les plantes n’en avoient pas moins de vigueur.
Les roches fendillées daris une multitude de sens nous laissèrent
d’abord quelque incertitude sur la direction véritable de ieurs couches ;
sans pouvoir en mesurer la pente , on s’assura que l’angle plongeoit ici
à-peu-près vers ie S. O.
Cette excursion nous procura un assez grand nombre d’échantillons
que M. le professeur Cordier, de l’Académie royale des sciences, a jugé
convenable de classer ainsi qu’il suit :
a. Argiles savonneuses endurcies, h grains tantôt très-fins, tantôt grossiers,
d’un gris verdâtre ou jaunâtre, disposées par couches massives ou par
couches feuilletées.
b. Argiles semblabies aux précédentes, contenant des fragmens disséminés et
de tout volume, d’une serpentine brune, rougeâtre ou verdâtre, pius
ou moins décomposée , et faisant corps avec ie ciment qui l’enveloppe,
f. Roches de même nature, mais extrêmement endurcies, et offrant l’aspect
d’une masse silicée.
d. Poudingue â fragmens souvent très-volumineux de serpentine commune
d’un vert sombre et quelquefois brunâtre : le ciment et i’argiie endurcis
analogues h ia roche a. On voit de p lu s , dans ies interstices qui séparent
les blo c s, ies galets et les fragmens, des nids et des veines de
carbonate de chaux, blanches et laminaires, â très-grandes iames.
Ces matières sont mélangées dans un ordre de succession variable, lie s des Papous,
mais en sorte cependant que les substances l> et d sont infiniment plus G éologie,
abondantes que les autres.
Une particularité remarquabie du gisement de ces roches, c’est qu’elles
sont formées de couches réglées, et qui présentent toujours des inclinaisons
très-rapides. A l’appui des mesures que j’ai rapportées, M. le docteur
Quoy a observé lui-même que les couches mises a nu par ies
ébouiemens sont sensiblement verticales , de même que celles sur ies-
quelles ia mer vient briser. Et en effet, cette apparence de verticalité
diffère peu de i’angle cjue j’ai mesuré.
La terre végétale, dont nous avons rapporté aussi des échantillons, se
compose d’une argile tenace de couleur brun verdâtre, mêlée de fragmens
de la roche inférieure , dont elle-même paroît provenir.
Le bord de ia mer est couvert d’un sable- blanc formé de débris de
coraux et de quelques coquilles bivalves et univalves, lequel contient
environ un tiers de son volume en petits galets et en gravier serpen-
tineux de la même nature que les roches qui forment la charpente de
cette partie de l’île : le sable du fond de ia rade , rapporté par la sonde,
est excessivement fin, bleuâtre, et serpentineux comme le premier; il
est mêlé de petites coquilles fossiles poiythaiames, très-apiaties, d’autres
alongées et enroulées sur elles-mêmes, ainsi que de légères concrétions
étoilées à trois ou cinq pointes, ayant sans doute appartenu à quelques
mollusques.
Les montagnes du Nord, à Rawak, sont beaucoup plus boisées que
celles du Sud; eût-on pu s’imaginer, d’après cela, que l’oeil y chercheroit
en vain la moindre trace de terre végétale. Sur leurs flancs rocheux et à
nu, croissent pourtant des arbres assez remarquables par leur élévation
et leur grosseur, dont ies racines, rampant en tout sens à la surface, vont
pénétrer dans ies fissures et les trous que le temps ou les eaux pluviales y
ont creusés. Enfin , je ne saurois mieux comparer cette végétation singulière
qu’à celle du lierre qui tapisse ies murailles de nos jardins.
Au premier aspect, les roches qui constituent ces montagnes ne paroissent
point être une masse compacte, mais une agglomération de blocs
irréguliers et de grandeur variable, hérissés d’aspérités nombreuses et