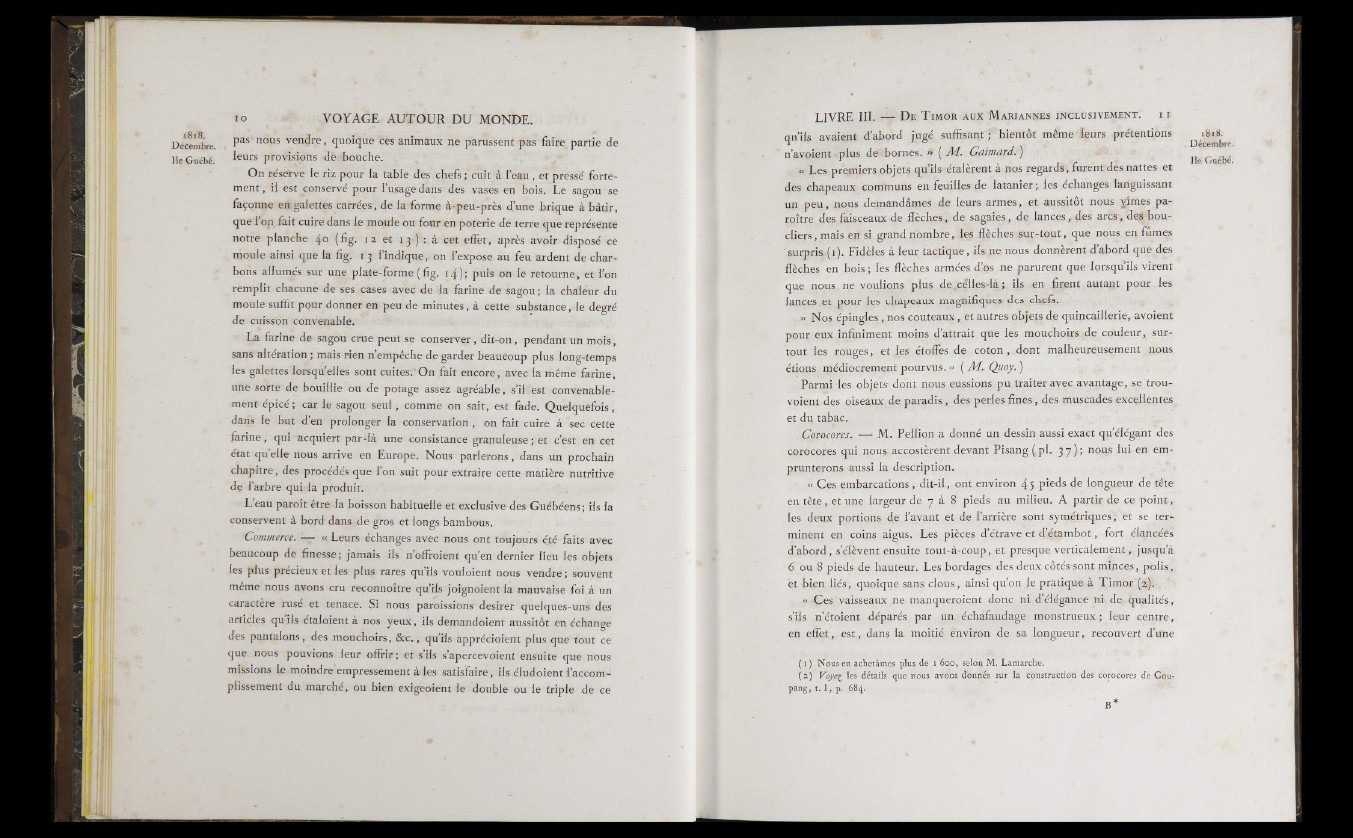
Dé'cenlbre vendre, quoique ces animaux ne parussent pas faire partie de
lie Guébé. provisions de bouche.
On re'serve le riz pour la table des chefs ; cuit à l’eau , et pressé fortement,
il est conservé pour l’usage dans des vases en bois. Le sagou se
façonne en galettes carrées, de la forme à-peu-près d’une brique à bâtir,
que l’on fait cuire dans ie moule ou four en poterie de terre que représente
notre planche 4o (fig. i 2 et i 3 ) : à cet effet, après avoir disposé ce
moule ainsi que ia fig. i 3 l’indique, on l’expose au feu ardent de charbons
allumés sur une plate-forme (fig. 14); puis on le retourne, et l’on
remplit chacune de ses cases avec de la farine de sagou; la chaleur du
moule suffit pour donner en peu de minutes, à cette substance, le degré
de cuisson convenable.
La farine de sagou crue peut se conserver , dit-on , pendant un mois,
sans altération ; mais rien n’empêche de garder beaucoup plus long-temps
les galettes lorsqu’eiles sont cuites. On fait encore, avec la même farine,
une sorte de bouillie ou de potage assez agréable, s’il est convenablement
épicé; car le sagou seul , comme on sait, est fade. Quelquefois,
dans le but d’en prolonger ia conservation , on fait cuire à sec cette
farine , qui acquiert par-là une consistance granuleuse ; et c’est en cet
état quelle nous arrive en Europe. Nous parierons, dans un prochain
chapitre, des procédés que l’on suit pour extraire cette matière nutritive
de l’arbre qui la produit.
L ’eau paroît être ia boisson habituelle et exclusive des Guébéens; iis la
conservent à bord dans de gros et longs bambous.
Commerce. — « Leurs échanges avec nous ont toujours été faits avec
beaucoup de finesse; jamais ils n’offroient qu’en dernier lieu les objets
les plus précieux et les plus rares qu’ils vouloient nous vendre ; souvent
même nous avons cru reconnoitre qu’ils joignaient la mauvaise foi à un
caractère ruse et tenace. Si nous paroissions desirer queiques-uns des
articles quils étaloient à nos yeux, ils demandoient aussitôt en échange
des pantalons, des mouchoirs, & c ., qu’iis apprécioient plus que tout ce
que nous pouvions leur offrir; et s’ils s’apercevoient ensuite que nous
missions le moindre empressement à les satisfaire , ils éludoient l’accom-
piissement du marche, ou bien exigeoient le double ou le triple de ce
oti’ils avaient d’abord jugé suffisant; bientôt même leurs prétentions 1818.
' . Dé cembre ,
n’avoient plus de bornes. « Ad. Gaimard. )
‘ . T r r î le Guebe. « Les premiers objets qu’ils étalèrent a nos regards, furent des nattes et
des chapeaux communs en feuilles de latanier; les échanges languissant
un peu, nous demandâmes de leurs armes, et aussitôt nous vîmes pa-
roître des faisceaux de flèches, de sagaies, de lances, des arcs, des boucliers,
mais en si grand nombre, ies flèches sur-tout, que nous en fumes
surpris (i). Fidèles à leur tactique, iis ne nous donnèrent d’abord que des
flèches en bois ; les flèches armées d’os ne parurent que iorsqu’ils virent
que nous ne voulions plus de célies-Ià ; ils en firent autant pour les
lances et pour ies chapeaux magnifiques des chefs.
- » Nos épingles, nos couteaux, et autres objets de quincaillerie, avoient
pour eux infiniment moins d’attrait que ies mouchoirs de couleur, surtout
ies rouges, et les étoffes de coton, dont malheureusement nous
étions médiocrement pourvus. » ( Ai. Quoy. )
Parmi les objets dont nous eussions pu traiter avec avantage, se trou-
voient des oiseaux de paradis , des perles fines, des muscades excellentes
et du tabac.
Corocores. — M. Peilion a donné un dessin aussi exact cju’élégant des
corocores qui nous accostèrent devant Pisang (pi. 37) ; nous lui en emprunterons
aussi la description.
« Ces embarcations, dit-il, ont environ 4 5 pieds de longueur de tête
en tête, et une largeur de 7 à 8 pieds au milieu. A partir de ce point,
les deux portions de l’avant et de l’arrière sont symétriques, et se terminent
en coins aigus. Les pièces d’étrave et d’étambot, fort élancées
d’abord, s’élèvent ensuite tout-à-coup, et presque verticalement, jusqu’à
6 ou 8 pieds de hauteur. Les bordages des deux côtés sont minces, polis,
et bien liés, quoique sans clous, ainsi qu’on le pratique à Timor (2).
■> Ces vaisseaux ne manqueroient donc ni d’éiégance ni de qualités,
s’ils n’étoient déparés par un échafaudage monstrueux ; leur centre,
en effet, est, dans la moitié environ de sa longueur, recouvert d’une
( 1 ) Nous en achetâmes plus de i 6 0 0 , selon M . Lama rche.
( 2 ) Vqy ei les détails que nous avons donnés sur la construction des corocores de C ou -
pan g , t. I , p. 684.
B*