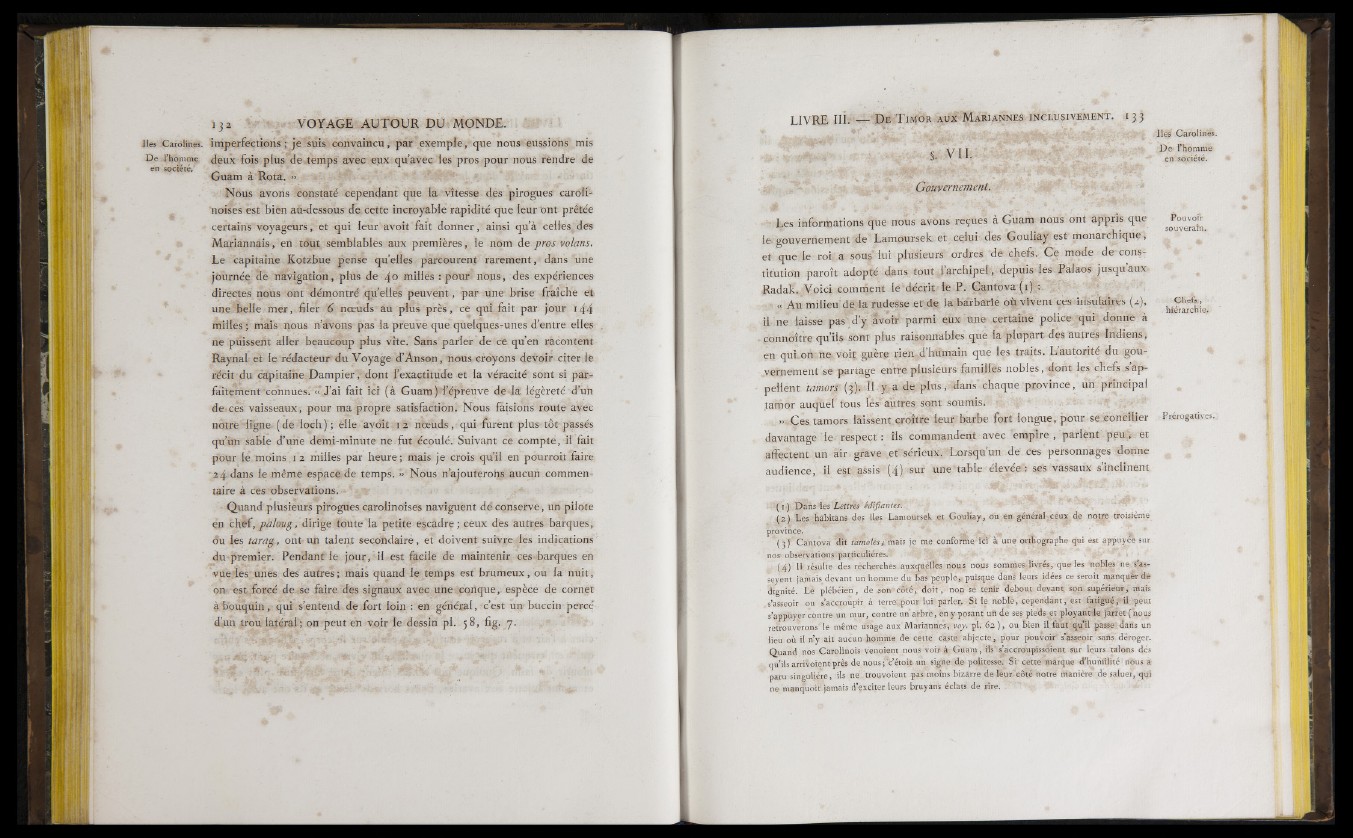
D e i’homme
en société.
li
Iles Ca roline s. imperfections; je suis convaincu, par exemple, que nous eussions mis
deux fois plus de temps avec eux qu’avec les pros pour nous rendre de
Guam à Rota. »
Nous avons constaté cependant que la vitesse des pirogues carolinoises
est bien au-dessous de cette incroyable rapidité que leur ont prêtée
certains voyageurs, et qui leur avoit fait donner, ainsi qu’à celies des
Mariannais, en tout semblables aux premières, le nom de pros volans.
Le capitaine Kotzbue pense quelles parcourent rarement, dans une
journée de navigation, plus de 4 ° milles : pour nous, des expériences
directes nous ont démontré quelles peuvent, par une brise fraîche et
une belie mer, filer 6 noeuds au plus près, ce qui fait par jour i44
milles ; mais nous n’avons pas ia preuve que quelques-unes d’entre eiles
ne puissent aller beaucoup plus vite. Sans parler de ce qu’en racontent
Raynal et le rédacteur du Voyage d’Anson, nous croyons devoir citer ie
récit du capitaine Dampier, dont l’exactitude et la véracité sont si parfaitement
connues. « J ’ai fait ici (à Guam) l’épreuve de la légèreté d’un
de ces vaisseaux, pour ma propre satisfaction. Nous faisions route avec
notre ligne (de loch); eile avoit 12 noeuds, qui furent plus tôt passés
qu’un sable d’une demi-minute ne fut écoulé. Suivant ce compte, il fait
pour le moins i 2 milles par heure ; mais je crois qu’il en pourroit faire
24 dans le même espace de temps. » Nous n’ajouterons aucun commentaire
à ces observations.
Quand piusieurs pirogues carolinoises naviguent de conserve, un pilote
en chei, paloug, dirige toute la petite escadre; ceux des autres barques,
ou ies tarag, ont un talent secondaire, et doivent suivre les indications
du premier. Pendant le jour, il est facile de maintenir ces barques en
vue ies unes des autres; mais quand le temps est brumeux, ou la nuit,
on est forcé de se faire des signaux avec une conque, espèce de cornet
à bouquin, qui s’entend de fort ioin : en générai, c’est un buccin percé
d’un trou latéral; on peut en voir le dessin pl. 58, fig. 7.
V I I . D e l’ homme
en société.
Gouvernement.
Les informations que nous avons reçues à Guam nous ont appris que
le gouvernement de Lamoursek et celui des Gouliay est monarchique,
et que le roi a sous lui plusieurs ordres de chefs. Ce mode de constitution
paroît adopté dans tout l’archipel, depuis ies Palaos jusqu aux
Radak. Voici comment le décrit le P. Cantova (i) ;
« Au milieu de la rudesse et de la barbarie où vivent ces insulaires (2),
il ne laisse pas d’y avoir parmi eux une certaine police qui donne à
connoître qu’ils sont pius raisonnables que la plupart des autres Indiens,
en qui on ne voit guère rien d’humain que les traits. L ’autorité du gouvernement
se partage entre piusieurs familles nobles, dont les chefs s’appellent
tamors (3). Il y a de plus, dans chaque province, un principal
tamor auquel tous les autres sont soumis.
» Ces tamors laissent croître leur barbe fort longue, pour se concilier
davantage le respect : iis commandent avec empire , parlent peu, et
affectent un air grave et sérieux. Lorsqu’un de ces personnages donne
audience, il est assis (4) sur une table élevée : ses vassaux s’inciinent
( ! ) D an s ies Lettres édifiantes.
( 2 ) Les habitans des îles Lamoursek et G o u lia y , ou en général ceux de notre troisième
province.
( 3 ) C an to v a dit tamoles; mais je me conforme ici à une orthographe qui est appuyée sur
nos observations particulières.
(4 ) II résulte des recherches auxquelles nous nous sommes livrés, que les nobles ne sa s -
seyent jamais devant un homme du bas peuple, puisque dans leurs idées ce seroit manquer de
dignité. L e p léb é ien , de son cô té , d o i t , non se tenir debout devant son supé rieur, mais
s’asseoir ou s’accroupir à terre pour lui parler. S i le noble, cependant, est fa tig u é , il peut
s’appuyer contre un mur, contre un a rb re , en y posant un de ses pieds et ployant le jarret ( nous
retrouverons le même usage aux Mariannes, voy. pl. 6 2 ) , ou bien il faut qu’ il passe dans un
lieu où il n’y ait aucun homme de cette caste a b je c te , pour pouvoir s’ asseoir sans déroger.
Quand nos Carolinois venoient nous voir à G u am , ils s’accroupissoient sur leurs talons dès
qu’ ils arrivoient près de nous; c’ étoit un signe de politesse. S i cette marque d’humilité nous a
paru singulière, ils ne trouvoient pas moins bizarre de leur côté notre manière de saluer, qui
ne manquoit jamais d’exciter leurs bruyans éclats de rire.
P ouvoir
souverain.
C h e f s ,
hiérarchie.
Prérogatives.