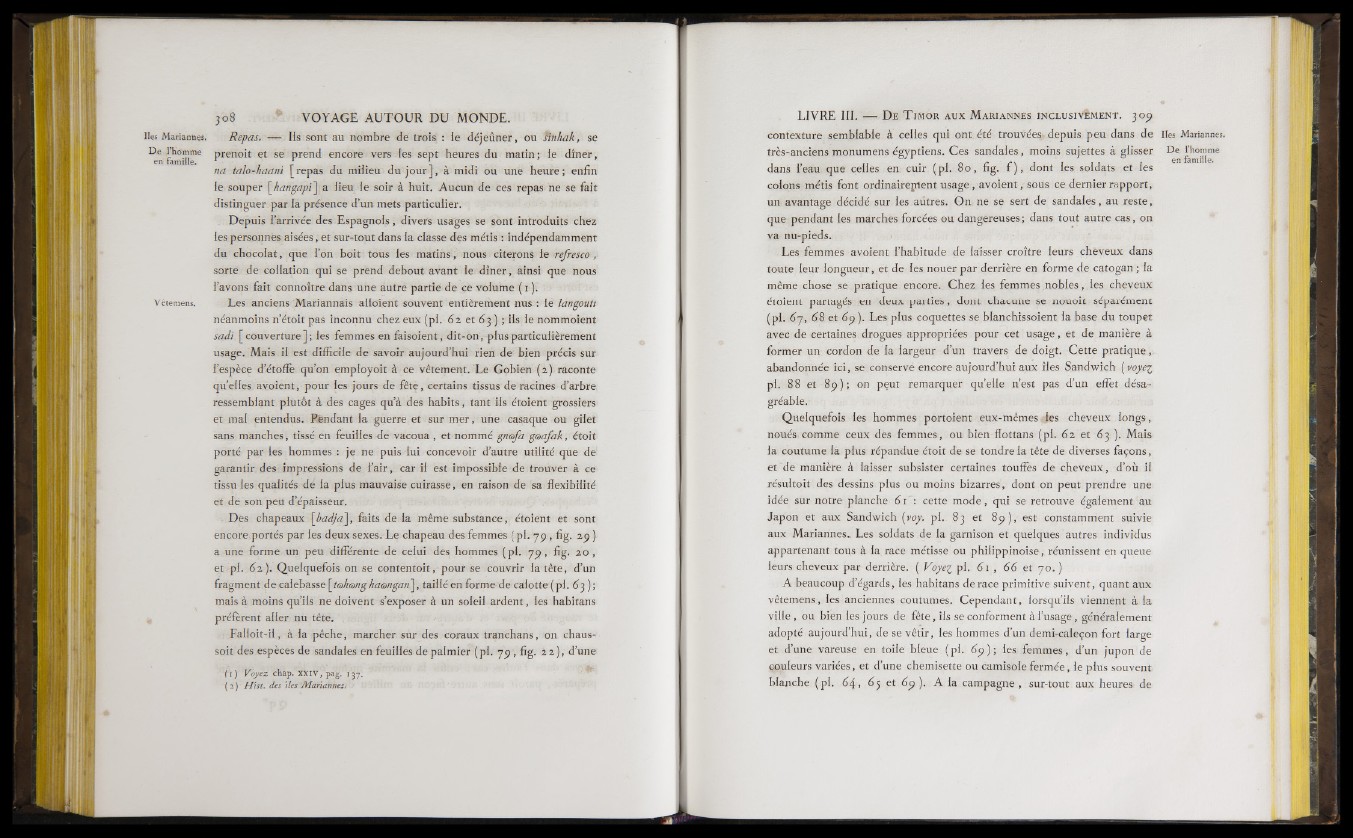
D e rhomme
en famille.
Vêtemens.
Repas. — Ils sont au nombre de trois : le déjeûner, ou sinhak, se
prenoit et se prend encore vers les sept heures du matin; le dîner,
na talo-haani [repas du milieu du jour], à midi ou une heure; enfin
ie souper [hangapi] a lieu le soir à huit. Aucun de ces repas ne se fait
distinguer par ia présence d’un mets particulier.
Depuis l’arrivée des Espagnols, divers usages se sont introduits chez
les personnes aisées, et sur-tout dans la classe des métis : indépendamment
du chocolat, que l’on boit tous les matins, nous citerons le refresco ,
sorte de collation qui se prend debout avant le dîner, ainsi que nous
l’avons fait connoître dans une autre partie de ce volume ( i ).
Les anciens Mariannais ailoient souvent entièrement nus : le langouti
néanmoins n’étoit pas inconnu chez eux (pl. 62 et 63 ) ; ils ie nommoient
sadi [couverture]; les femmes en faisoient, dit-on, plus particulièrement
usage. Mais il est difficile de savoir aujourd’hui rien de bien précis sur
i’espèce d’étoffe qu’on empioyoit à ce vêtement. Le Gobien (2) raconte
qu’elles avoient, pour les jours de fête, certains tissus déracinés d’arbre
ressemblant piutôt à des cages qu’à des habits, tant ils étoient grossiers
et mai entendus. Pendant la guerre et sur mer, une casaque ou gilet
sans manches, tissé en feuilles de vacoua , et nommé gnafa gaafak, étoit
porté par les hommes : je ne puis iui concevoir d’autre utilité que de
garantir des impressions de l’air, car il est impossible de trouver à ce
tissu les qualités de la plus mauvaise cuirasse, en raison de sa flexibilité
et de son peu d’épaisseur.
Des chapeaux [badja], faits de ia même substance, étoient et sont
encore portés par les deux sexes. Le chapeau des femmes ( pl. 79 , fig. 29 )
a une forme un peu différente de ceiui des hommes (pl. 79 , fig. 2 0 ,
et pl. 62). Quelquefois on se contentoit, pour se couvrir la tête, d’un
fragment de calebasse [tahanghaangan], taillé en forme de calotte (pi. 63 );
mais à moins qu’ils ne doivent s’exposer à un soleil ardent, les habitans
préfèrent aller nu tête.
Falloit-il, à la pêche, marcher sur des coraux tranchans, on chaus-
soit des espèces de sandales en feuilles de palmier (pl. 79, fig. 22), d’une
f i ) Voyez chap. X X IV, pag. 13 7 .
( 2 ) H is t . des iles M ariannes.
D e rhomme
en famille.
LIVRE IIL — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 309
contexture semblable à celles qui ont été trouvées depuis peu dans de lie s Mariannes,
très-anciens monumens égyptiens. Ces sandales, moins sujettes à glisser
dans l’eau que celles en cuir (pl. 80, fig. f ) , dont les soldats et les
colons métis font ordinairement usage , avoient, sous ce dernier rapport,
un avantage décidé sur les autres. On ne se sert de sandales, au reste,
que pendant les marches forcées ou dangereuses; dans tout autre cas, on
va nu-pieds.
Les femmes avoient l’habitude de laisser croître ieurs cheveux dans
toute leur longueur, et de les nouer par derrière en forme de catogan ; la
même chose se pratique encore. Chez les femmes nobles , les cheveux
étoient partagés en deux parties , dont chacune se nouoit séparément
(pl. 67, 68 et 69 ). Les plus coquettes se blanchissoient la base du toupet
avec de certaines drogues appropriées pour cet usage, et de manière à
former un cordon de la largeur d’un travers de doigt. Cette pratique ,
abandonnée ici, se conserve encore aujourd’hui aux îies Sandwich [voyez
pl. 88 et 89); on peut remarquer qu’eile n’est pas d’un effet désagréable.
Quelquefois les hommes portoient eux-mêmes ies cheveux longs,
noués comme ceux des femmes, ou bien flottans (pl. 62 et 63 ). Mais
la coutume la plus répandue étoit de se tondre la tête de diverses façons,
et de manière à laisser subsister certaines touffes de cheveux, d’où il
résultoit des dessins pius ou moins bizarres, dont on peut prendre une
idée sur notre planche 61 : cette mode, qui se retrouve également au
Japon et aux Sandwich [voy. pl. 83 et 89), est constamment suivie
aux Mariannes.. Les soldats de la garnison et quelques autres individus
appartenant tous à la race métisse ou philippinoise, réunissent en queue
leurs cheveux par derrière. ( Voyez pl. 61 , 66 et 70. )
A beaucoup d’égards, les habitans de race primitive suivent, quant aux
vêtemens, les anciennes coutumes. Cependant, lorsqu’ils viennent à la
ville , ou bien ies jours de fête , iis se conforment à l’usage , généralement
adopté aujourd’hui, de se vêtir, les hommes d’un demi-caleçon fort large
et d’une vareuse en toile bleue (pi. 6 9 ); les femmes, d’un jupon de
couleurs variées, et d’une chemisette ou camisole fermée, le plus souvent
blanche (pi. 64, 65 et 69 ). A la campagne , sur-tout aux heures de