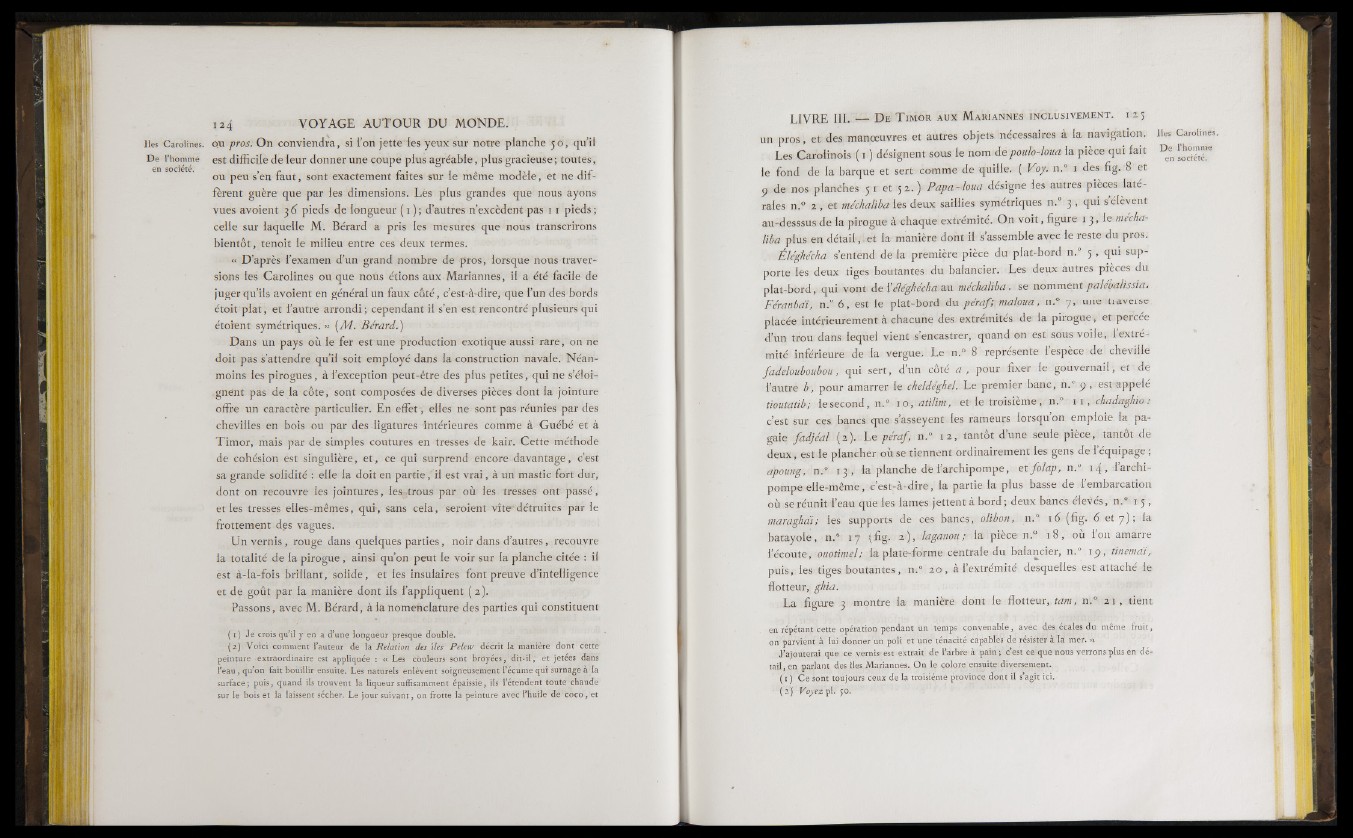
en société.
ii
Iles Ca roline s. QU pros. On conviendra, si l’on jette ies yeux sur notre planche 50, qu’ii
D e l’ homme est difficile de ieur donner une coupe plus agréable, plus gracieuse ; toutes,
ou peu s’en faut, sont exactement faites sur le même modèle, et ne diffèrent
guère que par les dimensions. Les plus grandes que nous ayons
vues avoient 3 6 pieds de longueur ( i ) ; d’autres n’excèdent pas 1 1 pieds ;
celle sur laquelle M. Bérard a pris les mesures que nous transcrirons
bientôt, tenoit le miiieu entre ces deux termes.
« D’après l’examen d’un grand nombre de pros, lorsque nous traversions
les Carolines ou que nous étions aux Mariannes, il a été facile de
juger qu’ils avoient en générai un faux côté, c’est-à-dire, que l’un des bords
étoit plat, et l’autre arrondi; cependant il s’en est rencontré piusieurs qui
étoient symétriques. » [Ai. Bérard.)
Dans un pays où le fer est une production exotique aussi rare, on ne
doit pas s’attendre qu’il soir employé dans la construction navale. Néanmoins
ies pirogues , à l’exception peut-être des pius petites, qui ne s’éloignent
pas de la côte, sont composées de diverses pièces dont la jointure
offre un caractère particulier. En effet, elles ne sont pas réunies par des
chevilles en bois ou par des ligatures intérieures comme à Guébé et à
Timor, mais par de simples coutures en tresses de kair. Cette méthode
de cohésion est singulière, et, ce qui surprend encore davantage, c’est
sa grande solidité : elle la doit en partie, il est vrai, à un mastic fort dur,
dont on recouvre les jointures, les trous par où les tresses ont passé,
et les tresses elles-mêmes, qui, sans cela, seroient vite détruites par le
frottement des vagues.
Un vernis , rouge dans quelques parties , noir dans d’autres , recouvre
la totalité de ia pirogue , ainsi qu’on peut ie voir sur la planche citée : il
est à-la-fois brillant, solide, et ies insulaires font preuve d’intelligence
et de goût par la manière dont ils l’appliquent (2).
Passons, avec M. Bérard, à la nomenclature des parties qui constituent
( I ) J e crois qu’il y en a d’une longueur presque double.
(2 ) V o ic i comment fau teu r de la R elation des iles P e lew décrit la manière dont cette
peinture extraordinaire est appliquée : « Les couleurs sont b royé es, d it- il, et jetées dans
T eau, qu’on fait bouillir ensuite. Les naturels enlèvent soigneusement i’écume qui surnage à la
su rfa c e ; puis, quand ils trouvent ia liqueur suffisamment épaissie, ils Tétendent toute chaude
sur ie bois et la laissent sécher. L e jour su iv an t, on frotte la peinture avec l’huile de c o c o , et
LIVRE 111. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t .
un pros, et des manoeuvres et autres objets nécessaires à la navigation.
Les Carolinois ( i ) désignent sous le nom depoulo-loua la pièce qui fait
le fond de la barque et sert comme de quille. ( Voy. n.° i des fig. 8 et
9 de nos planches 51 et 52.) Papa-loua désigne ies autres pièces latérales
n.° 2 , et méchaliha les deux saillies symétriques n.° 3 , qui s’élèvent
au-desssLis de la pirogue à chaque extrémité. On voit, figure i 3, le mecha-
lila plus en détail, et la manière dont il s’assemble avec ie reste du pros.
Éléghécha s’entend de ia première pièce du plat-bord n." 5 , qui supporte
les deux tiges boutantes du balancier. Les deux autres pièces du
plat-bord, qui vont AcVélégliéclmau méchaliha. se nomment palébalissia.
Féranhdi, n.° 6, est le plat-bord du péraf; maloua, n.° 7, une traverse
placée intérieurement à chacune des extrémités de la pirogue, et percée
d’un trou dans lequel vient s’encastrer, quand on est sous voile, l’extrémité
inférieure de ia vergue. Le n.“ 8 représente l’espèce de cheville
fadelouboubou, qui sert, d’un côté a , pour fixer ie gouvernail, et de
i’autre b , pour amarrer le clieldégliel. Le premier banc, n." 9 , est appelé
tioutatib; le second, n.“ 10 , atilim, et le troisième, n.“ 1 1 , chadaghio :
c’est sur ces bancs que s’asseyent les rameurs lorsqu on emploie la pagaie
fadjéal (2). Le péraf, n.° 12 , tantôt d’une seule pièce, tantôt de
deux, est le plancher où se tiennent ordinairement les gens de l’équipage ;
apoung, n.° 1 3 , ia planche de i’archipompe, etfoIap,n.'’ 14 , l’archi-
pompe elle-même, c’est-à-dire, la partie la plus basse de l’embarcation
où se réunit i’eau que íes lames jettent à bord ; deux bancs élevés, n.° 15 ,
maraghdi; ies supports de ces bancs, oliboti, n.° 16 (fi§- ô et 7 ) ; la
batayole, n.° 17 (fig. 2 ), laganou ; la pièce n." 1 8, où i’on amarre
i’écoute, ouotimel; la plate-forme centrale du balancier, n.° 19 , tinemdi,
puis, les tiges boutantes, n.° 20 , à l’extrémité desquelles est attaché le
flotteur, ghia.
La figure 3 montre la manière dont le flotteur, tam, n.
D e l’homme
en société.
2 1 , tient
en répétant cette opération pendant un temps co n v en ab le , a v e c des écales du même iru it ,
on parvient à lui donner un poli et une ténacité capables de résister à la mer. „
J ’ajouterai que ce vernis est extrait de l’arbre à pain ; c’ est ce que nous verrons plus en déta
il, en parlant des îles Mariannes. On le colore ensuite diversement.
( 1 ) C e sont toujours ceux de la troisième province dont il s’agit ici.
( 2)' Voyez pl. 50.