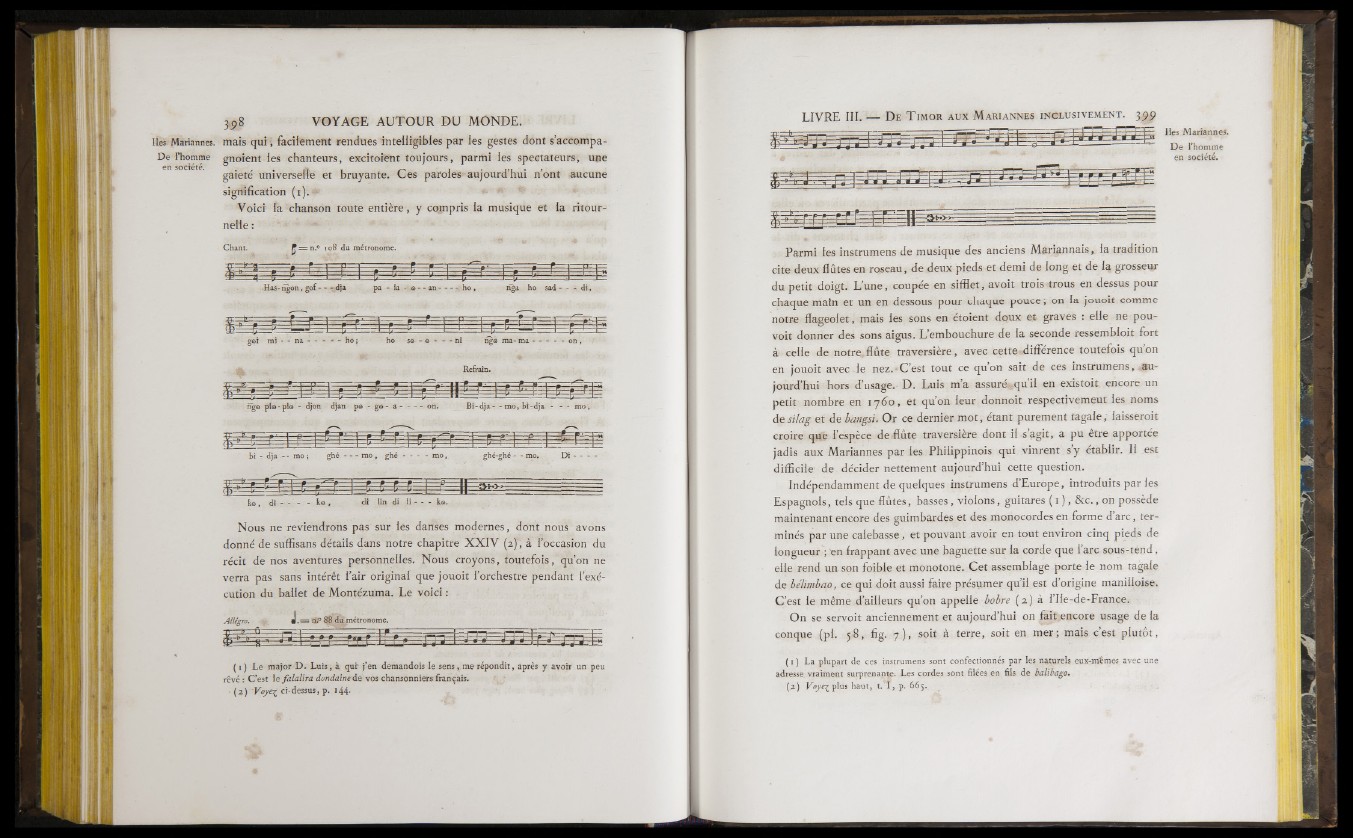
ìli '
Iles Mariannes. mais qui, facilement rendues intelligibles par les gestes dont s’accompa-
De l’homme gnoient les chanteurs, excitoient toujours, parmi les spectateurs, une
gaiete' universelle et bruyante. Ces paroles aujourd’hui n’ont aucune
signification (i).
Voici ia chanson toute entière, y compris la musique et la ritournelle
:
en société.
Chant. ^ = n.® 1 08 da métronome.
m
Has- ngon, go f d|a pa - la - û - - an ho , nga ho sad - - - d i,
mi - - na - - - - - ho ; ho so - 0 - - - ni ngo ma- ma ■
Reirahi.
m
ngta plo-plo - djon djan po • g o - a - - - - on. B i-d ja - -m o ,b i-d ja - - -
1=
bi - dja - - mo ; g h é mo , ghé - - - - mo, ghé-ghé - - mo. Di - - - -
il
k o , di - - - - ko , di iin di li - - - ko.
Nous ne reviendrons pas sur ies danses modernes, dont nous avons
donné de suffisans détails dans notre chapitre X X IV (2), à l’occasion du
récit de nos aventures personneiies. Nous croyons, toutefois, qu’on ne
verra pas sans intérêt i’air original que jouoit l’orchestre pendant l’exécution
du ballet de Montézuma. Le voici :
Allégro. J. = n.® 88 du métronome.
m
( i) Le major D. Luis, à qur j’en demandois le sens, me répondit, après y avoir un peu
rêvé : C ’est \e fila lira dandaine ds vos chansonniers français.
{ 2 ) F o y c j c i-d e s su s , p . 144.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 399
lies Mariannes.
De Thomme
m
en société.
Parmi ies instrumens de musique des anciens Mariannais, ia tradition
cite deux flûtes en roseau, de deux pieds et demi de iong et de la grosseur
du petit doigt. L’une, coupée eu sifflet, avoit trois trous en dessus pour
chaque main et un en dessous pour chaque pouce; on la jouoit comme
notre flageolet, mais les sons en étoient doux et graves : elle ne pouvoit
donner des sons aigus. L’embouchure de ia seconde ressembioit fort
à celle de notre flûte traversière, avec cette différence toutefois qu’on
en jouoit avec le nez. C ’est tout ce qu’on sait de ces instrumens, aujourd’hui
hors d usage. D. Luis m’a assure qu il en existoit encore un
petit nombre en 17 6 0 , et qu’on ieur donnoit respectivement les noms
àesÜag et de bangst. Or ce dernier mot, étant purement tagaie, iaisseroit
croire que l’espèce de flûte traversière dont il s agit, a pu etre apportée
jadis aux Mariannes par ies Philippinois qui vinrent s’y établir. Ii est
difficile de décider nettement aujourd’hui cette question.
Indépendamment de quelques instrumens d’Europe, introduits paries
Espagnols, tels que flûtes, basses , violons , guitares ( i ), & c ., on possède
maintenant encore des guimbardes et des monocordes en forme d’arc, terminés
par une calebasse, et pouvant avoir en tout environ cinq pieds de
longueur ; en frappant avec une baguette sur fa corde que l’arc sous-tend,
elle rend un son foible et monotone. Cet assemblage porte le nom tagale
de bélimhao, ce qui doit aussi faire présumer qu’il est d’origine manilloise.
C’est ie même d’ailleurs qu’on appelle bobre (2) à l’Ile-de-France.
On se servoit anciennement et aujourd’hui on fait encore usage de la
conque (pl. 58, fig. 7 ) , soit à terre, soit en mer; mais c’est piutôt,
( I ) La plupart de ces instrumens sont confectionnés par les naturels eux-mêmes avec une
adresse vraiment surprenante. Les cordes sont filées en fils de balibago.
(2) Kqyfj plus haut, t. I , p. 665.