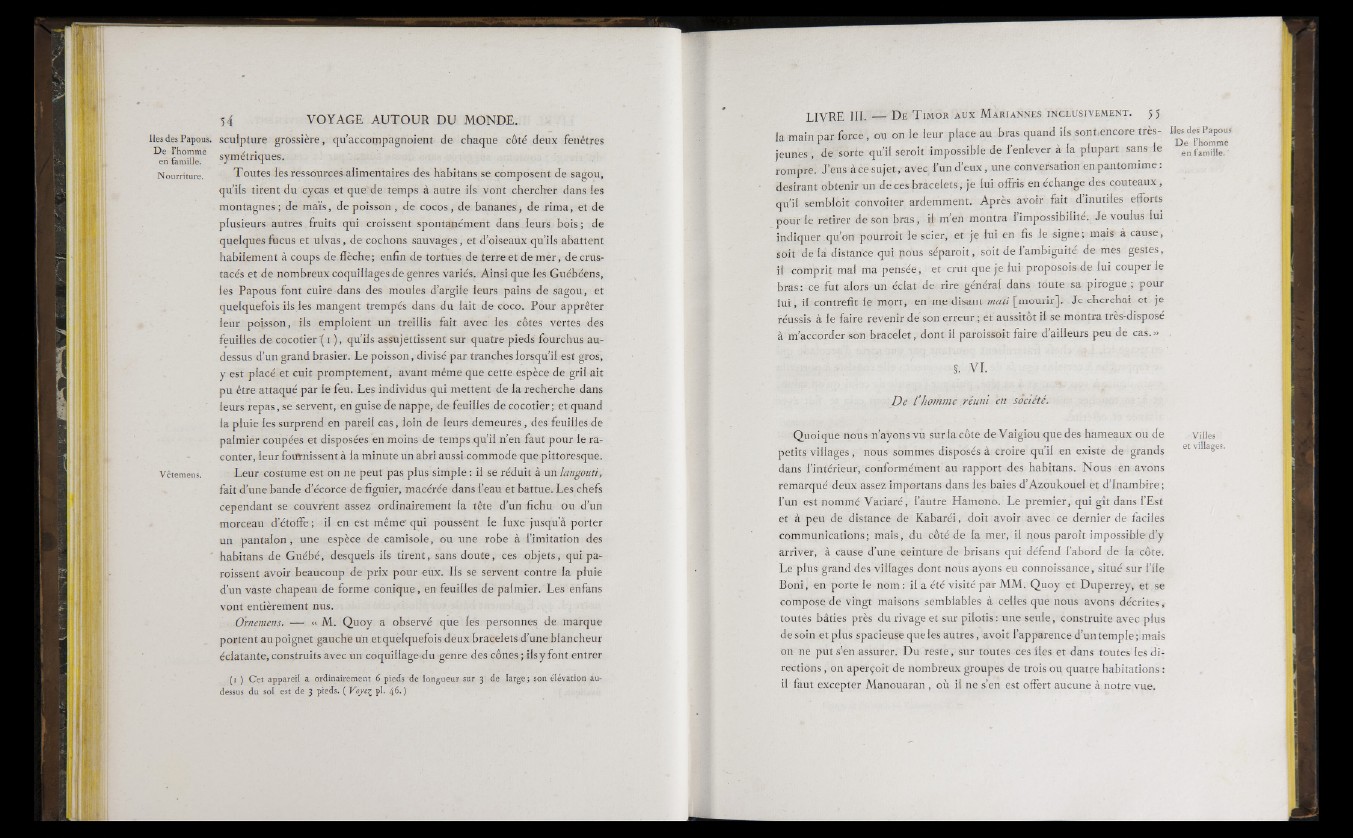
Ile s des Papous, sculpture grossière, qu’accompagnoient de chaque côté deux fenêtres
I R i S r »yn,è,ri,.es.
N ourriture, Toutes les ressources alimentaires des habitans se composent de sagou,
qu’ils tirent du cycas et que de temps à autre ils vont chercher dans ies
montagnes; de maïs, de poisson , de cocos, de bananes, de rima, et de
plusieurs autres fruits qui croissent spontanément dans ieurs bois ; de
quelques fucus et ulvas, de cochons sauvages , et d’oiseaux qu’ils abattent
habilement à coups de flèche; enfin de tortues de terre et de mer, de crustacés
et de nombreux coquillages de genres variés. Ainsi que les Guébéens,
les Papous font cuire dans des moitiés d’argile leurs pains de sagou, et
quelquefois iis les mangent trempés dans du lait de coco. Pour apprêter
leur poisson, ils emploient un treillis fait avec les côtes vertes des
feuilles de cocotier ( i ), qu’ils assujettissent sur quatre pieds fourchus au-
dessus d’un grand brasier. Le poisson, divisé par tranches lorsqu’il est gros,
y est placé et cuit promptement, avant même que cette espèce de gril ait
pu être attaqué par le feu. Les individus qui mettent de la recherche dans
leurs repas, se servent, en guise de nappe, de feuilles de cocotier ; et quand
la pluie les surprend en pareil cas, loin de leurs demeures , des feuilles de
palmier coupées et disposées en moins de temps qu’il n’en faut pour le raconter,
leur foifrnissent à la minute un abri aussi commode que pittoresque.
Vêtemens. Leur costume est on ne peut pas plus simple : il se réduit à un langouti,
fait d’une bande d’écorce de figuier, macérée dans i’eau et battue. Les chefs
cependant se couvrent assez ordinairement la tête d’un fichu ou d’un
morceau d’étoffe ; il en est même qui poussent le luxe jusqu’à porter
un pantaion, une espèce de camisole, ou une robe à l’imitation des
habitans de Guébé, desquels ils tirent, sans doute, ces objets, qui paroissent
avoir beaucoup de prix pour eux. Ils se servent contre ia piuie
d’un vaste chapeau de forme conique, en feuilles de palmier. Les enfans
vont entièrement nus.
Ornemens. — « M. Quoy a observé que les personnes de marque
portent au poignet gauche un et quelquefois deux bracelets d’une blancheur
éclatante, construits avec un coquillage du genre des cônes ; ils y font entrer
(i ) C e t appareil a ordinairement 6 pieds de longueur sur 3 de la rg e ; son élévation au-
dessus du sol est de 3 pieds. ( Voye^ pl. 4 6 .)
la main par force , ou on le leur place au bras quand ils sont encore très- Hesde s P .p c
^ . » t J - De 1 homrr
jeunes , t de ■ sorte ■ quil seroit impossible ‘ , r de T 1 i> enlever I a < I la plupart J sans le
J D e l’homme en famille .
rompre. J ’eus à ce sujet, avec l’un d’eux, une conversation en pantomime ;
désirant obtenir un de ces braceiets, je lui offris en échange des couteaux ,
qu’il sembloit convoiter ardemment. Après avoir fait d inutiles efforts
Dour le retirer de son bras, il m’en montra l’impossibilité. Je voulus lui
indiquer qu’on pourroit ie scier, et je lui en fis le signe; mais à cause,
soit de la distance qui nous séparoit, soit de 1 ambiguité de mes gestes,
il comprit mai ma pensée, et crut que je lui proposois de lui couper le
bras : ce fut alors un éclat de rire général dans toute sa pirogue ; pour
lui, il contrefit le mort, en me disant mati [mourir]. Je cherchai et je
réussis à le faire revenir de son erreur ; et aussitôt il se montra très-disposé
à m’accorder son bracelet, dont ii paroissoit faire d’ailleurs peu de cas.»
Y VI.
De L’homme réuni en société.
Quoique nous n’ayons vu sur ia côte de Vaigiou que des hameaux ou de
petits villages , nous sommes disposés à croire qu’il en existe de grands
dans l’intérieur, conformément au rapport des habitans. Nous en avons
remarqué deux assez importans dans les baies d’Azoukouel et d’Inambire ;
l’un est nommé Variaré, l’autre Hamono. Le premier, qui gît dans l’Est
et à peu de distance de Kabaréi, doit avoir avec ce dernier de faciles
communications; mais, du côté de la mer, il nous paroît impossible d’y
arriver, à cause d’une ceinture de brisans qui défend l’abord de ia côte.
Le plus grand des villages dont nous ayons eu connoissance, situé sur l’île
Boni, en porte le nom : il a été visité par MM. Quoy et Duperrey, et se
compose de vingt maisons sembiables à celles que nous avons décrites,
toutes bâties près du rivage et sur pilotis: une seule, construite avec plus
de soin et plus spacieuse que les autres, avoit l’apparence d’un temple ; mais
on ne put s’en assurer. Du reste, sur toutes ces îles et dans toutes les directions
, on aperçoit de nombreux groupes de trois ou quatre habitations :
il faut excepter Manouaran , où il ne s’en est offert aucune à notre vue.
Villes
et villages.