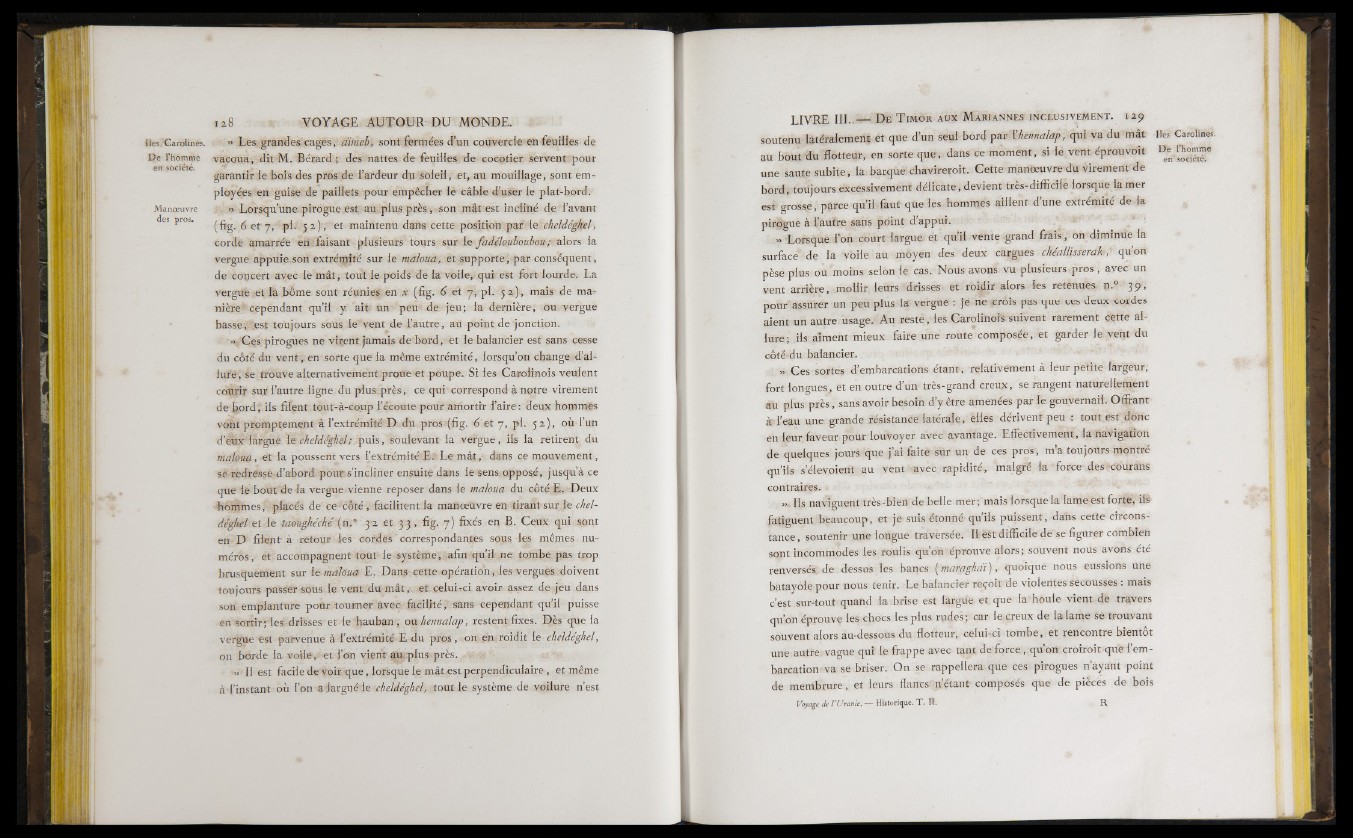
\ i
Iles C.irolines. » Les grandes cages, dimeh, sont fermées d’un couvercle en feuiiles de
D e l’homme vacoua, dit M. Bérard; des nattes de feuilles de cocotier servent pour
garantir ie bois des pros de i’ardeur du soleii, et, au mouillage, sont employées
en guise de paillets pour empêcher ie câble d’user le plat-bord.
M anoeuvre » Lorsqu’une pirogue est au plus près, son mât est incliné de l’avant
des pros. 6 et 7, pl. 52) , et maintenu dans cette position par le cheldéghel,
corde amarrée en faisant plusieurs tours sur \e fadéloubouhou; alors la
vergue appuie son extrémité sur le maloua, et supporte, par conséquent,
de concert avec le mât, tout le poids de ia voiie, qui est fort lourde. La
vergue et la bôme sont réunies en x (fig. 6 et 7, pl. 52), mais de manière
cependant qu’il y ait un peu de jeu; la dernière, ou vergue
basse, est toujours sous ie vent de l’autre, au point de jonction.
» Ces pirogues ne virent jamais de bord, et le balancier est sans cesse
du côté du vent, en sorte que ia même extrémité, lorsqu’on change d’allure,
se trouve alternativement proue et poupe. Si les Carolinois veulent
courir sur l’autre ligne du plus près, ce qui correspond à notre virement
de bord, ils fiient tout-à-coup l’écoute pour amortir l’aire: deux hommes
vont promptement à l’extrémité D du pros (fig. 6 et 7, pl. 52), où l’un
d’eux larg-ue ie cheldéghel; puis, soulevant la vergue, ils ia retirent du
maloua , et la poussent vers l’extrémité E. Le mât, dans ce mouvement,
se redresse d’abord pour s’incliner ensuite dans ie sens opposé, jusqu’à ce
que ie bout de la vergue vienne reposer dans le maloua du côté E. Deux
hommes, placés de ce côté, facilitent la manoeuvre en tirant sur ie cAî/-
déghel et ie taoughéché (n.° 32 et 3 3 , fig. 7) fixés en B. Ceux qui sont
en D filent à retour les cordes correspondantes sous ies mêmes numéros,
et accompagnent tout le système, afin qu’il ne tombe pas trop
brusquement sur le maloua E. Dans cette opération, ies vergues doivent
toujours passer sous le vent du mât, et celui-ci avoir assez de jeu dans
son emplanture pour tourner avec facilité, sans cependant qu’il puisse
en sortir; les drisses et le hauban, on hennalap, restent fixes. Dès que la
vergue est parvenue à l’extrémité E du pros, on en roidit le cheldéghel,
on borde ia voile, et l’on vient au plus près.
» Il est facile de voir que, lorsque le mât est perpendiculaire , et même
à l’instant où l’on a largué le cheldéghel, tout le système de voilure n’est
LIVRE III. — D e T imor aux M ariannes in c lu s iv em en t . 12 9
soutenu latéralement et que d’un seul bord par Xhennalap, qui va du mât lies Carolines,
au bout du flotteur, en sorte que, dans ce moment, si le vent éprouvoit De Lhomme
une saute subite, la barque chavireroit. Cette manoeuvre du virement de
bord, toujours excessivement délicate, devient très-difficile lorsque la mer
est grosse, parce qu’il faut que les hommes aillent d’une extrémité de ia
pirogue à i’autre sans point d’appui.
» Lorsque i’on court largue et qu’il vente grand frais, on diminue ia
surface de la voile au moyen des deux cargues chéallisserak, qu’on
pèse pius ou moins selon le cas. Nous avons vu piusieurs pros, avec un
vent arrière, mollir ieurs drisses et roidir alors ies retenues n.° 39,
pour assurer un peu plus la vergue : je ne crois pas que ces deux cordes
aient un autre usage. Au reste, ies Carolinois suivent rarement cette al-
iure; iis aiment mieux faire une route composée, et garder le vent du
côté du balancier.
» Ces sortes d’embarcations étant, relativement à ieur petite largeur,
fort longues, et en outre d’un très-grand creux, se rangent naturellement
au plus près, sans avoir besoin d’y être amenées par le gouvernaii. Offrant
à l’eau une grande résistance latérale, elles dérivent peu : tout est donc
en leur faveur pour louvoyer avec avantage. Effectivement, la navigation
de quelques jours que j’ai faite sur un de ces pros, m’a toujours montré
qu’iis s’élevoient au vent avec rapidité, malgré la force des courans
contraires.
» Ils naviguent très-bien de belle mer; mais lorsque la lame est forte, ils
fatiguent beaucoup, et je suis étonné qu’ils puissent, dans cette circonstance
, soutenir une longue traversée. II est difficile de se figurer combien
sont incommodes les roulis qu’on éprouve alors; souvent nous avons été
renversés de dessus les bancs [maraghdi), quoique nous eussions une
batayoie pour nous tenir. Le balancier reçoit de violentes secousses : mais
c’est sur-tout quand la brise est iargme et que la houle vient de travers
qu’on éprouve les chocs les plus rudes; car ie creux de ia lame se trouvant
souvent alors au-dessous du flotteur, celui-ci tombe, et rencontre bientôt
une autre vague qui le frappe avec tant de force , qu’on croiroit que l’embarcation
va se briser. On se rappellera que ces pirogues n’ayant point
de membrure, et leurs flancs n’étant composés que de pièces de bois
Voyage de l ’Uranie. — Historique. T . IL R