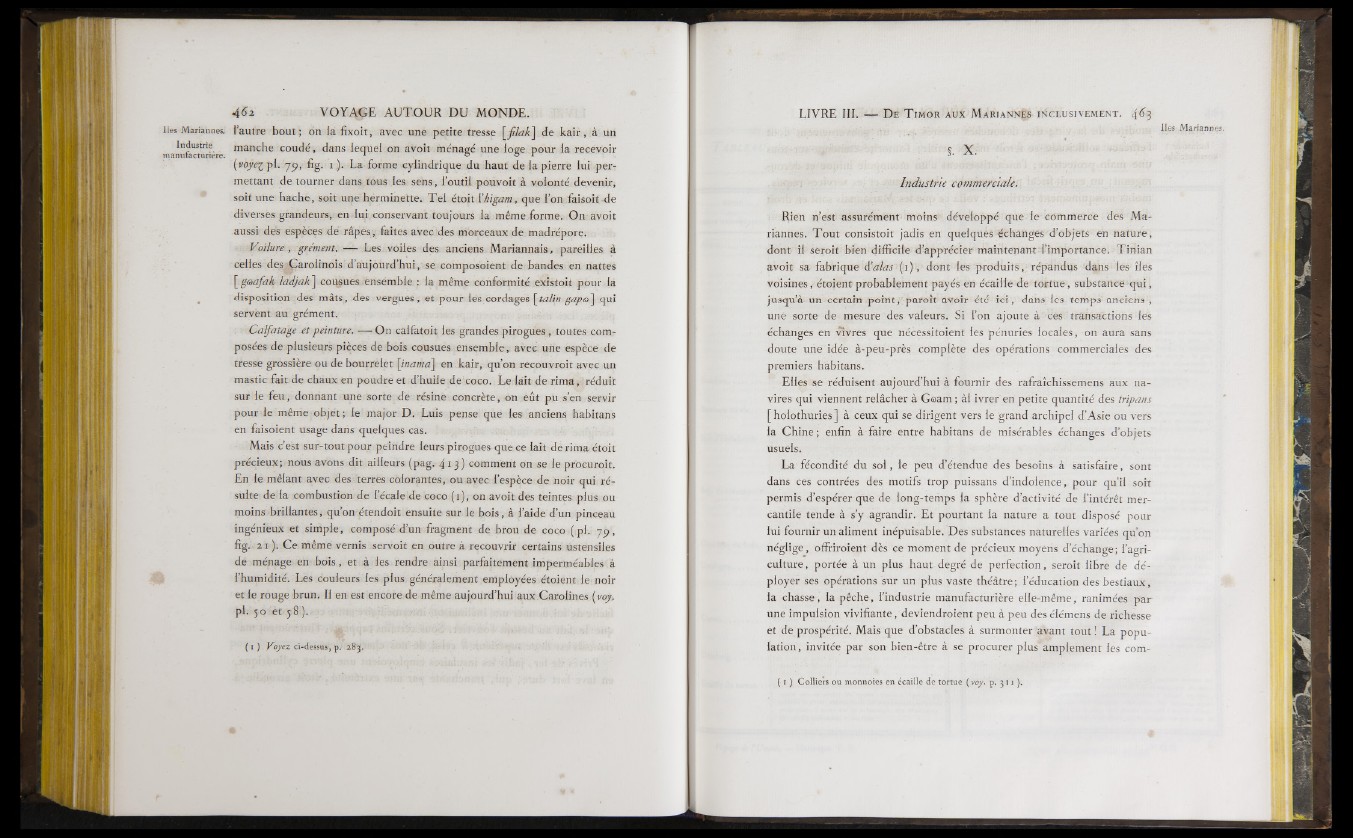
Ita
Iles Mariannes, i'autre bout; on la fixoit, avec une petite tresse [jilak] de kair, à un
Industrie manche coudé, dans lequel on avoit ménagé une loge pour ia recevoir manufacturière. > b & r
[voyez pù 79 > ''g- ') • forme cylindrique du haut de la pierre lui permettant
de tourner dans tous les sens, l’outil pouvoit à volonté devenir,
soit une hache, soit une herminette. Tel étoit ï higam, que l’on faisoit de
diverses grandeurs, en lui conservant toujours la rnême forme. On avoit
aussi des espèces de râpes, faites avec des morceaux de madrépore.
Voilure , grément. — Les voiles des anciens Mariannais, pareilles à
celles des Carolinois d'aujourd’hui, se composoient de bandes en nattes
[gaafak ladjak] cousues ensemble : la même conformité existoit pour ia
disposition des mâts, des vergues, et pour les cordages [talin gapo] qui
servent au grément.
Calfatage et peinture. — On caifatoit les grandes pirogues , toutes composées
de plusieurs pièces de bois cousues ensemble, avec une espèce de
tresse grossière ou de bourrelet \inama] en kair, qu’on recouvroit avec un
mastic fait de chaux en poudre et d’huile de coco. Le lait de rima, réduit
sur le feu, donnant une sorte de résine concrète, on eût pu s’en servir
pour le même objet ; le major D. Luis pense que ies anciens habitans
en faisoient usage dans quelques cas.
Mais c’est sur-tout pour peindre leurs pirogues que ce lait de rima étoit
précieux; nous avons dit ailleurs (pag. 4 13 ) comment on se le procuroit.
En le mêlant avec des terres colorantes, ou avec l’espèce de noir qui résulte
de ia combustion de l’écale de coco (i), on avoit des teintes plus ou
moins brillantes, qu’on étendoit ensuite sur le bois, à l’aide d’un pinceau
ingénieux et simple, composé d’un fragment de brou de coco (pl. 79,
fig. 21 ). Ce même vernis servoit en outre à recouvrir certains ustensiles
de ménage en bois , et à les rendre ainsi parfaitement imperméables à
l’humidité. Les couleurs les plus généraiement employées étoient ie noir
et ie rouge brun. II en est encore de même aujourd’hui aux Carolines [voy.
pl. 50 et 58).
( I ) Voyez ci-dessus, p. 283,
§. X .
Industrie commerciale.
Rien n’est assurément moins développé que le commerce des Mariannes.
Tout consistoit jadis en quelques échanges d’objets en nature,
dont il seroit bien difficile d’apprécier maintenant l’importance. Tinian
avoit sa fabrique à’alas ( i) , dont les produits, répandus dans les îles
voisines, étoient probablement payés en écaille de tortue, substance qui,
jusqu’à un certain point, paroît avoir été ici, dans les temps anciens ,
une sorte de mesure des valeurs. Si l’on ajoute à ces transactions les
échanges en vivres que nécessitoient les pénuries locales, on aura sans
doute une idée à-peu-près complète des opérations commerciales des
premiers habitans.
Eiles se réduisent aujourd’hui à fournir des rafraîchissemens aux navires
qui viennent relâcher à Goam ; àl ivrer en petite quantité des tripans
[holothuries] à ceux qui se dirigent vers le grand archipel d’Asie ou vers
la Chine; enfin à faire entre habitans de misérables échanges d’objets
usuels.
La fécondité du so l, le peu d’étendue des besoins à satisfaire, sont
dans ces contrées des motifs trop puissans d’indolence, pour qu’ii soit
permis d’espérer que de long-temps la sphère d’activité de l’intérêt mercantile
tende à s’y agrandir. Et pourtant la nature a tout disposé pour
iui fournir un aliment inépuisable. Des substances naturelles variées qu’on
néglige, offriroient dès ce moment de précieux moyens d’échange; l’agriculture,
portée à un plus haut degré de perfection, seroit libre de déployer
ses opérations sur un pius vaste théâtre; l’éducation des bestiaux,
la chasse, la pêche, i’industrie manufacturière elle-même, ranimées par
une impulsion vivifiante , deviendroient peu à peu des élémens de richesse
et de prospérité. Mais que d’obstacles à surmonter avant tout ! La population
, invitée par son bien-être à se procurer pius amplement les com-
( 1 ) Colliers ou monnoies en écaille de tortue [voy. p, 3 1 1 ).