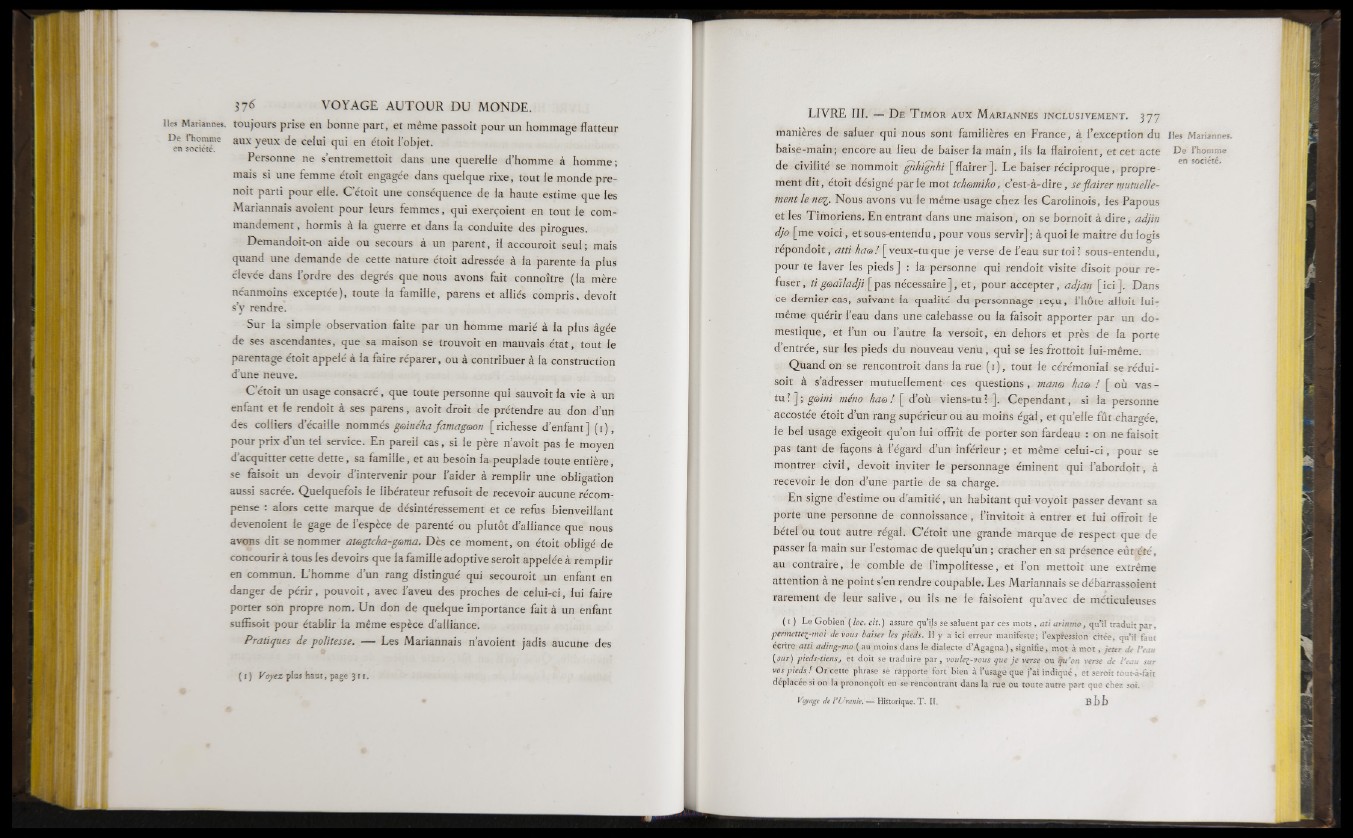
Iles Mariannes. toujours prise en bonne part, et même passoit pour un hommage flatteur
De 1 homme au.v yeux de celui qui en étoit l'objet.
en société. ' ^ ^
Personne ne s’entremettoit dans une querelle d’homme à homme;
mais si une femme étoit engagée dans quelque rixe, tout le monde prenoit
parti pour elle. C ’étoit une conséquence de la haute estime que les
Mariannais avoient pour leurs femmes, qui exerçoient en tout le commandement
, honnis à la guerre et dans la conduite des pirogues.
Demandoit-on aide ou secours à un parent, il accouroit seul; mais
quand une demande de cette nature étoit adressée à la parente la plus
élevée dans l’ordre des degrés que nous avons fait connoître (la mère
néanmoins exceptée), toute la famille, parens et alliés compris, devoit
s’y rendre.
Sur la simple observation faite par un homme marié à la plus âgée
de ses ascendantes, que sa maison se trouvoit en mauvais état, tout le
parentage étoit appelé à la faire réparer, ou à contribuer à la construction
d’une neuve.
C étoit un usage consacré , que toute personne qui sauvoit la vie à un
enfant et le rendoit à ses parens, avoit droit de prétendre au don d’un
des colliers d’écailie nommés goineha famagoon [richesse d’enfant] ( i) ,
pour prix d’un tel service. En pareil cas, si le père n’avoit pas le moyen
d’acquitter cette dette, sa famiile, et au besoin la peuplade toute entière,
se faisoit un devoir d’intervenir pour l’aider à remplir une obligation
aussi sacrée. Quelquefois le libérateur refusoit de recevoir aucune récompense
: alors cette marque de désintéressement et ce refus bienveillant
devenoient le gage de l’espèce de parenté ou plutôt d’alliance que nous
avons dit se nommer atogtcha-gama. Dès ce moment, on étoit obligé de
concourir à tous les devoirs que ia famille adoptive seroit appelée à remplir
en commun. L’homme d’un rang distingué qui secouroit un enfant en
danger de périr, pouvoit, avec l’aveu des proches de celui-ci, lui faire
porter son propre nom. Un don de quelque importance fait à un enfant
suffisoit pour établir ia même espèce d’alliance.
Pratiques de politesse. — Les Mariannais n’avoient jadis aucune des
( i ) P'ifjez plus h au t, page 3 1 1 .
D e Thomme
en société.
LIVRE IIL — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 377
manières de saluer qui nous sont familières en France, à l’exception du Ile s Mariannes,
baise-main; encore au lieu de baiser la main, ils la flairoient, et cet acte
de civilité se nommoit gùhighhi [flairer]. Le baiser réciproque, proprement
dit, étoit désigné parle mot tchomiko, c’est-à-dire , se flairer mutuellement
le nez- Nous avons vu le même usage chez les Carolinois, les Papous
et les Timoriens. En entrant dans une maison, on se bornoit à dire, adjin
djo [me voici, et sous-entendu, pour vous servir] ; à quoi le maître du logis
répondoit, atti hao! [veux-tu que je verse de l’eau sur toi! sous-entendu,
pour te laver les pieds] ; la personne qui rendoit visite disoit pour refuser,
ti goa'iladji [pas nécessaire], et, pour accepter, adjan [ici]. Dans
ce dernier cas, suivant ia qualité du personnage reçu, l’hôte alloit lui-
même quérir i’eau dans une calebasse ou la faisoit apporter par un domestique,
et i’un ou l’autre la versoit, en dehors et près de la porte
d’entrée, sur les pieds du nouveau venu, qui se les frottoit lui-même.
Quand on se rencontroit dans la rue (i), tout le cérémonial se rédui-
soit à s’adresser mutuellement ces questions , mana haa ! [ où vas -
tu ! ] ; gaini méno hao ! [ d’où viens-tu ! ]. Cependant, si la personne
accostée étoit d’un rang supérieur ou au moins égal, et qu’elle fût chargée,
le bel usage exigeoit qu’on lui offrît de porter son fardeau : on ne faisoit
pas tant de façons à l’égard d’un inférieur ; et même celui-ci, pour se
montrer civil, devoit inviter ie personnage éminent qui i’abordoir, à
recevoir le don d’une partie de sa charge.
En signe d’estime ou d’amitié, un habitant qui voyoit passer devant sa
porte une personne de connoissance, l’invitoit à entrer et lui offroit le
bétel ou tout autre régal. C’étoit une grande marque de respect que de
passer la main sur l’estomac de quelqu’un ; cracher en sa présence eût été,
au contraire, le comble de l’impolitesse, et l’on mettoit une e.xtrême
attention à ne point s’en rendre coupable. Les Alariannais se débarrassoient
rarement de leur salive, ou iis ne le faisoient qu'avec de méticuleuses
( I ) L e Gob ien ( loc. cit. ) assure qu’ils se saluent pa r ces mots , a ti a rinm o , qu’il traduit p a r .
permettei-moî d e vons baiser les pieds. Il y a ici erreur manifeste; Texpression citée, q tfil faut
écrire atti ading-tiio ( au moins dans le dialecte d’Agagna ) , s ign ifie , mot à mot , je u r de l ’eau
[su r] pieds-tiens, et doit se traduire p a r , voulei-vous que j e verse ou q u ’on verse de l ’eau sur
vos p ieds f O r cette phrase se rapporte fort bien à Tusage que j’ ai indiqué , et seroit tout-à-fait
déplacée si on la prononçoit en se rencontrant dans la rue ou toute autre part que chez soi.
Coyage de l'Uranie. — Historique. T . II. B i ) b