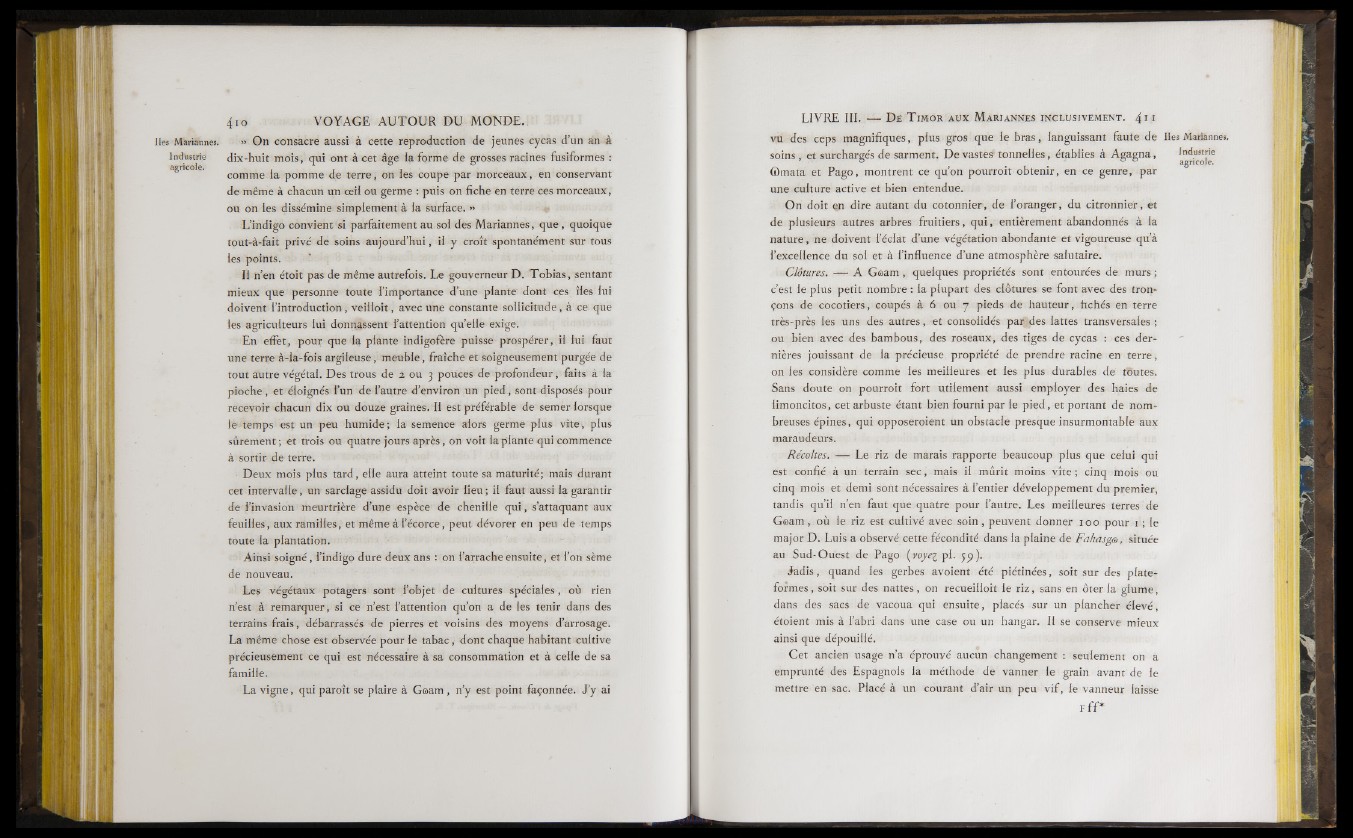
Industrie
agricole.
» On consacre aussi à cette reproduction de jeunes cycas d’un an à
dix-huit mois, qui ont à cet âge ia forme de grosses racines fusiformes :
comme ia pomme de terre, on les coupe par morceaux, en conservant
de même à chacun un oeii ou germe ; puis on fiche en terre ces morceaux,
ou on ies dissémine simplement à ia surface. »
L’indigo convient si parfaitement au soi des Mariannes, que , quoique
tout-à-fait privé de soins aujourd’hui, il y croît spontanément sur tous
les points.
Il n’en étoit pas de même autrefois. Le gouverneur D. 'Tobias, sentant
mieux que personne toute l’importance d’une plante dont ces îies lui
doivent l’introduction , veilloit, avec une constante sollicitude , à ce que
les agriculteurs lui donnassent l’attention qu’elle exige.
En effet, pour que la plante indigofère puisse prospérer, ii lui faut
une terre à-ia-fois argileuse, meuble, fraîche et soigneusement purgée de
tout autre végétal. Des trous de 2 ou 3 pouces de profondeur, faits à ia
pioche, et éloignés i’un de l’autre d’environ un pied, sont disposés pour
recevoir chacun dix ou douze graines. II est préférable de semer lorsque
le temps est un peu humide ; la semence alors germe plus vite, plus
sûrement ; et trois ou quatre jours après, on voit la plante qui commence
à sortir de terre.
Deux mois pius tard, elle aura atteint toute sa maturité; mais durant
cet intervalle, un sarclage assidu doit avoir lieu ; il faut aussi la garantir
de l’invasion meurtrière d’une espèce de chenille qui, s’attaquant aux
feuilles, aux ramilles, et même à i’écorce, peut dévorer en peu de temps
toute la plantation.
Ainsi soigné, i’indigo dure deux ans : on l’arrache ensuite, et l’on sème
de nouveau.
Les végétaux potagers sont fobjet de cultures spéciales, où rien
n’est à remarquer, si ce n’est l’attention qu’on a de les tenir dans des
terrains frais, débarrassés de pierres et voisins des moyens d’arrosage.
La même chose est observée pour le tabac, dont chaque habitant cultive
précieusement ce qui est nécessaire à sa consommation et à celle de sa
famille.
La vigne, qui paroît se plaire à Goam , n’y est point façonnée. J ’y ai
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 1 1
vu des ceps magnifiques, plus gros que ie bras, languissant faute de I le s Mariannes.
soins , et surchargés de sarment. De vastes tonnelles, établies à Agagna,
ômata et Pago, montrent ce qu’on pourroit obtenir, en ce genre, par
une culture active et bien entendue.
On doit en dire autant du cotonnier, de l’oranger, du citronnier, et
de plusieurs autres arbres fruitiers, qui, entièrement abandonnés à la
nature, ne doivent l’éclat d’une végétation abondante et vigoureuse qu’à
l’excellence du sol et à l’influence d’une atmosphère salutaire.
Clôtures. — A Gfflam , quelques propriétés sont entourées de murs ;
c’est le plus petit nombre : la plupart des clôtures se font avec des tronçons
de cocotiers, coupés à 6 ou 7 pieds de hauteur, fichés en terre
très-près les uns des autres, et consolidés par des lattes transversales ;
ou bien avec des bambous, des roseaux, des tiges de cycas : ces dernières
jouissant de la précieuse propriété de prendre racine en terre,
on les considère comme les meilleures et les pius durables de toutes.
Sans doute on pourroit fort utilement aussi employer des haies de
limoncitos, cet arbuste étant bien fourni par le pied, et portant de nombreuses
épines, qui opposeroient un obsiacle presque insurmontable aux
maraudeurs.
Récoltes. — Le riz de marais rapporte beaucoup plus que celui qui
est confié à un terrain sec, mais il mûrit moins vite ; cinq mois ou
cinq mois et demi sont nécessaires à l’entier développement du premier,
tandis qu’il n’en faut que quatre pour i’autre. Les meilleures terres de
Gfflam, où le riz est cultivé avec soin, peuvent donner 100 pour i ; le
major D. Luis a observé cette fécondité dans la plaine de Faliasga, située
au Sud-Ouest de Pago [voyez pl. 59).
Jad is , quand ies gerbes avoient été piétinées, soit sur des plateformes,
soit sur des nattes, on recueilloit le riz, sans en ôter la glume,
dans des sacs de vacoua qui ensuite, placés sur un plancher élevé,
étoient mis à i’abri dans une case ou un hangar. Il se conserve mieux
ainsi que dépouillé.
Cet ancien usage n’a éprouvé aucun changement : seulement on a
emprunté des Espagnols la méthode de vanner le grain avant de le
mettre en sac. Piacé à un courant d’air un peu vif, le vanneur iaisse
F f'P