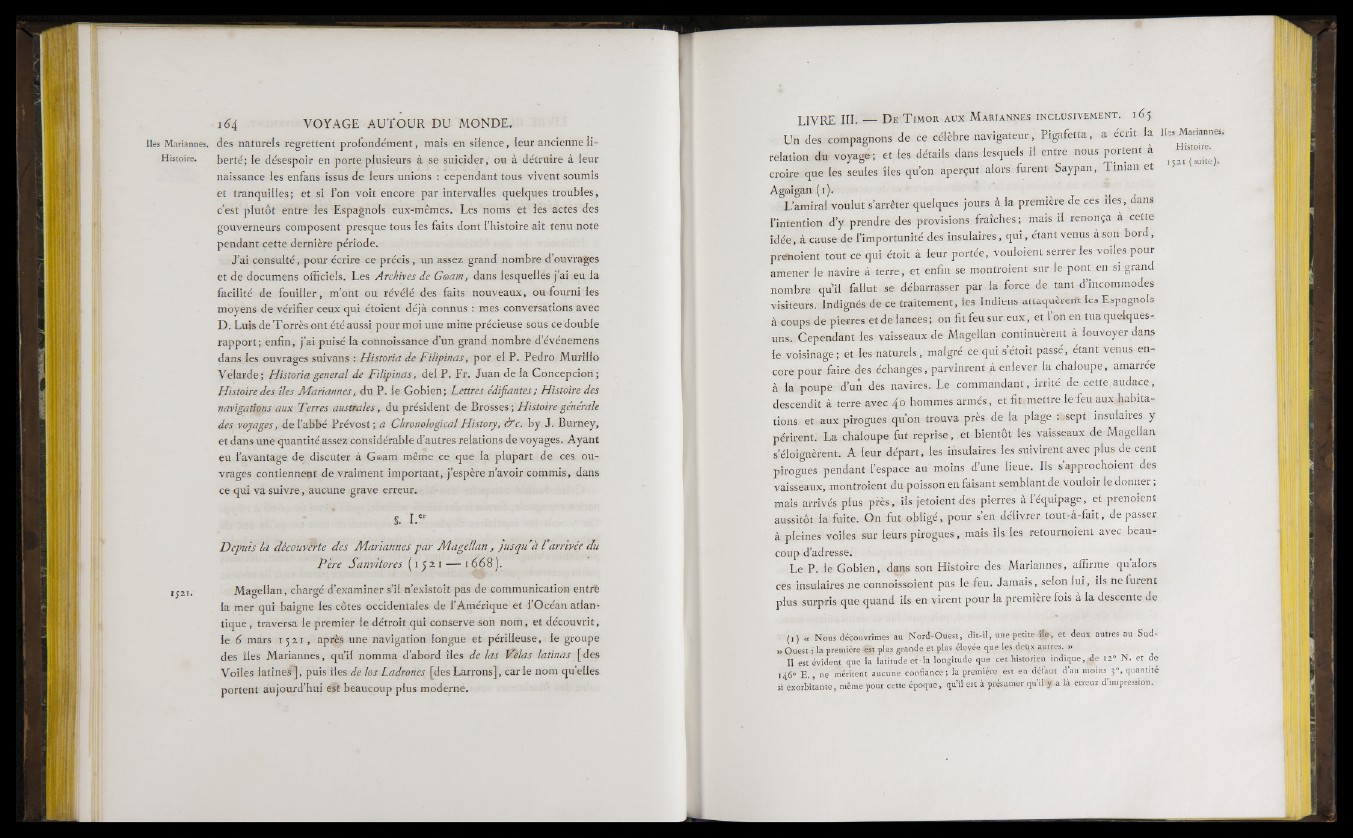
lie s Mariannes, des naturels regrettent profonde'ment, mais en silence, leur ancienne liberté;
Histoire.
le désespoir en porte plusieurs à se suicider, ou à détruire à ieur
naissance les enfans issus de leurs unions : cependant tous vivent soumis
et tranquilles; et si l’on voit encore par intervalles quelques troubles,
c’est plutôt entre les Espagnols eux-mêmes. Les noms et les actes des
gouverneurs composent presque tous les faits dont l’histoire ait tenu note
pendant cette dernière période.
J ’ai consulté, pour écrire ce précis, un assez grand nombre d’ouvrages
et de documens officiels. Les Archives de Gaam, dans lesquelles j’ai eu la
facilité de fouiller, m’ont ou révélé des faits nouveaux, ou fourni les
moyens de vérifier ceux qui étoient déjà connus ; mes conversations avec
D. Luis de Torrès ont été aussi pour moi une mine précieuse sous ce double
rapport; enfin, j’ai puisé la connoissance d’un grand nombre d’événemens
dans les ouvrages suivans : Historia de Filipinas, por el P. Pedro Muriilo
Velarde; Historia general de Filipinas, dei P. Fr. Juan de la Concepcion;
Histoire des îles Mariannes, du P. le Gobien; Lettres édifiantes; Histoire des
navigations aux Terres australes, du président de Brosses; Histoire générale
des voyages, de l’abbé Prévost ; a Chronological History, & c. by J. Burney,
et dans une quantité assez considérable d'autres relations de voyages. Ayant
eu l’avantage de discuter à Gaam même ce que la plupart de ces ouvrages
contiennent de vraiment important, j’espère n’avoir commis, dans
ce qui va suivre, aucune grave erreur.
§. I.'"
Depuis la découverte des Mariannes par Magellan, yusquà l ’arrivée du
Pire Sanvitores ( i J 2 i — i 668).
1521. Magellan, chargé d’examiner s’il n’existoit pas de communication entre
la mer qui baigne les côtes occidentales de l’Amérique et l’Océan atlantique
, traversa le premier le détroit qui conserve son nom, et découvrit,
le 6 mars 1521 , après une navigation longue et périlleuse, le groupe
des îles Mariannes, qu’il nomma d’abord îles de las Vêlas latinas [des
Voiles latines], puis îies de los Ladrones [des Larrons], carie nom qu’elles
portent aujourd’hui est beaucoup plus moderne.
Un des compagnons de ce célèbre navigateur, Pigafetta, a écrit la Ile s Mariannes.
Histoire.
1 5 2 1 ( su ite ).
relation du voyage; et les détails dans iesquels il entre nous portent a Histoire,
croire que les seules îles qu’on aperçut alors furent Saypan, Timan et
Agoigan (i).
L ’amiral voulut s’arrêter quelques jours à la première de ces des, dans
l’intention d’y prendre des provisions fraîches; mais il renonça a cette
idée, à cause de l’importunité des insulaires, qui, étant venus à son bord,
prenoient tout ce qui étoit à leur portée, vouloient serrer les vo il« pour
amener le navire à terre, et enfin se montroient sur le pont en si grand
nombre qu’il fallut se débarrasser par la force de tant d’incommodes
visiteurs. Indignés de ce traitement, les Indiens attaquèrent les Espagnols
à coups de pierres et de lances ; on fit feu sur eux, et l’on eu tua quelques-
uns. Cependant les vaisseaux de Magellan continuèrent à louvoyer dans
le voisinage; et les naturels, malgré ce qui s étoit passé, étant venus encore
pour faire des échanges, parvinrent à enlever la chaloupe, amarrée
à la poupe d’im des navires. Le commandant, irrité de cette audace,
descendit à terre avec 4o hommes armés, et fit mettre le feu aux habitations
et aux pirogues qu’on trouva près de la plage : sept insulaires y
périrent. La chaloupe fut reprise , et bientôt ies vaisseaux de Magellan
s’éloignèrent. A leur départ, les insulaires les suivirent avec plus de cent
pirogues pendant l’espace au moins d’une lieue. Ils s’approchoient des
vaisseaux, montroient du poisson en faisant semblant de vouloir le donner ;
mais arrivés plus près, iis jetoient des pierres à l’équipage, et prenoient
aussitôt la fuite. On fut obligé, pour s’en délivrer tout-à-fait, de pa.sser
à pleines voiles sur leurs pirogues, mais ils les retouruoîeiit avec beaucoup
d’adresse.
Le P. le Gobien, dans son Histoire des Mariannes, affirme qu’alors
ces insulaires ne connoissoient pas le feu. Jamais, selon lui, iis ne fuient
plus surpris que quand iis en virent pour la première fois à la descente de
( , ) « Nous découvrîmes au N o rd -O u e s t, d it - il, une petite î le , et deux autres au Su d -
» Ouest : la première est plus grande et plus élevée que les deux autres. »
I I est évident que la latitude et la longitude que cet historien in d iqu e , de 12» N , et d e
14 6 ° E , ne méritent aucune con fian c e ; la première est en défaut d au moins 3 ° , quantité
si e xo rb itante, même pour cette ép oque , qu’il est à présumer qu’il y a là erreur d’ impression.