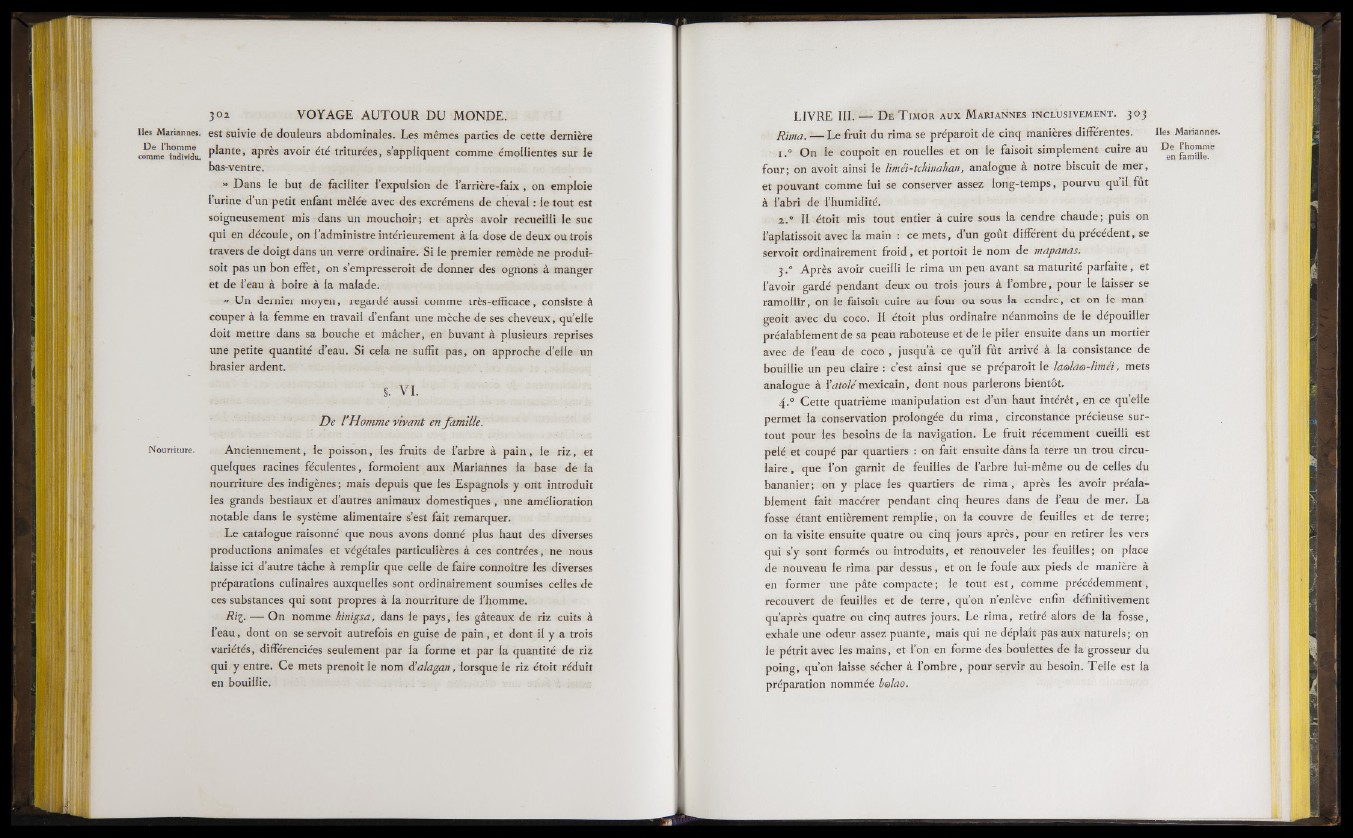
■Ml:
J
302 VO YAGE AUTOUR DU MONDE.
Iles Mariannes. est suivie de douleurs abdominaies. Les mêmes parties de cette dernière
comm! *ïndiridu. > ^pi'ès avoU été triturées, s’appliquent comme émoliientes sur le
bas-ventre.
» Dans ie but de faciliter l’expulsion de i’arrière-faix , on emploie
i’urine d’un petit enfant mêlée avec des excrémens de cheval : le tout est
soigneusement mis dans un mouchoir ; et après avoir recueilli le sue
qui en découle, on l’administre intérieurement à la dose de deux ou trois
travers de doigt dans un verre ordinaire. Si le premier remède ne produi-
soit pas un bon effet, on s’empresseroit de donner des ognons à manger
et de l’eau à boire à la malade.
» Un dernier moyen, regardé aussi comme très-efficace, consiste à
couper à la femme en travail d’enfant une mèche de ses cheveux, qu’eile
doit mettre dans sa bouche et mâcher, en buvant à plusieurs reprises
une petite quantité d’eau. Si cela ne suffit pas, on approche d’elle un
brasier ardent.
§. V I.
De l'Homme vivant en famille.
Nourriture. Anciennement, le poisson, les fruits de l’arbre à pain , le riz , et
quelques racines féculentes, formoient aux Mariannes la hase de ia
nourriture des indigènes ; mais depuis que les Espagnols y ont introduit
les grands bestiaux et d’autres animaux domestiques , une amélioration
notable dans le système alimentaire s’est fait remarquer.
Le catalogue raisonné que nous avons donné plus haut des diverses
productions animales et végétales particulières à ces contrées, ne nous
laisse ici d’autre tâche à remplir que celie de faire connoître les diverses
préparations culinaires auxquelles sont ordinairement soumises celles de
ces substances qui sont propres à la nourriture de i’homme.
R f — On nomme hinigsa, dans le pays, ies gâteaux de riz cuits à
l’eau, dont on se servoit autrefois en guise de pain , et dont il y a trois
variétés, différenciées seulement par la forme et par la quantité de riz
qui y entre. Ce mets prenoit le nom ialagan, lorsque le riz étoit réduit
en bouillie.
J,
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 303
Rima. — Le fruit du rima se préparoit de cinq manières différentes.
1 . “ On ie coupoit en rouelles et on le faisoit simplement cuire au
four; on avoit ainsi le liméi-tchinahan, analogue à notre biscuit de mer,
et pouvant comme lui se conserver assez long-temps, pourvu qu’il fût
à l’abri de l’humidité.
II étoit mis tout entier à cuire sous la 2 .' cendre chaude; puis on
D e l’homme
en famille.
i’aplatissoit avec la main : ce mets, d’un goût différent du précédent, se
servoit ordinairement froid, et portoit ie nom de mapanas.
3.° Après avoir cueilli ie rima un peu avant sa maturité parfaite, et
l’avoir gardé pendant deux ou trois jours à l’ombre, pour le laisser se
ramollir, on le faisoit cuire au four ou sous ia cendre, et on le mangeoit
avec du coco. Ii étoit plus ordinaire néanmoins de le dépouiller
préalablement de sa peau raboteuse et de le piler ensuite dans un mortier
avec de l’eau de coco , jusqu’à ce qu’il fût arrivé à la consistance de
bouillie un peu claire : c’est ainsi que se préparoit le laalaa-liméi, mets
analogue à ïatolé mexicain, dont nous parlerons bientôt.
4.° Cette quatrième manipulation est d’un haut intérêt, en ce qu’elle
permet la conservation prolongée du rima, circonstance précieuse surtout
pour ies besoins de la navigation. Le fruit récemment cueilli est
pelé et coupé par quartiers : on fait ensuite dans la terre un trou circulaire
, que l’on garnit de feuilles de i’arbre lui-même ou de celles du
bananier; on y place les quartiers de rima, après les avoir préalablement
fait macérer pendant cinq heures dans de i’eau de mer. La
fosse étant entièrement remplie, on la couvre de feuiiles et de terre;
on la visite ensuite quatre ou cinq jours après, pour en retirer les vers
qui s’y sont formés ou introduits, et renouveler les feuilles; on place
de nouveau le rima par dessus, et on ie foule aux pieds de manière à
en former une pâte compacte; le tout est, comme précédemment,
recouvert de feuilles et de terre, qu’on n’enlève enfin définitivement
qu’après quatre ou cinq autres jours. Le rima, retiré aiors de la fosse,
exhale une odeur assez puante, mais qui ne déplaît pas aux naturels; on
le pétrit avec les mains, et l’on en forme des boulettes de la grosseur du
poing, qu’on laisse sécher à l’ombre, pour servir au besoin. Telle est la
préparation nommée halao.