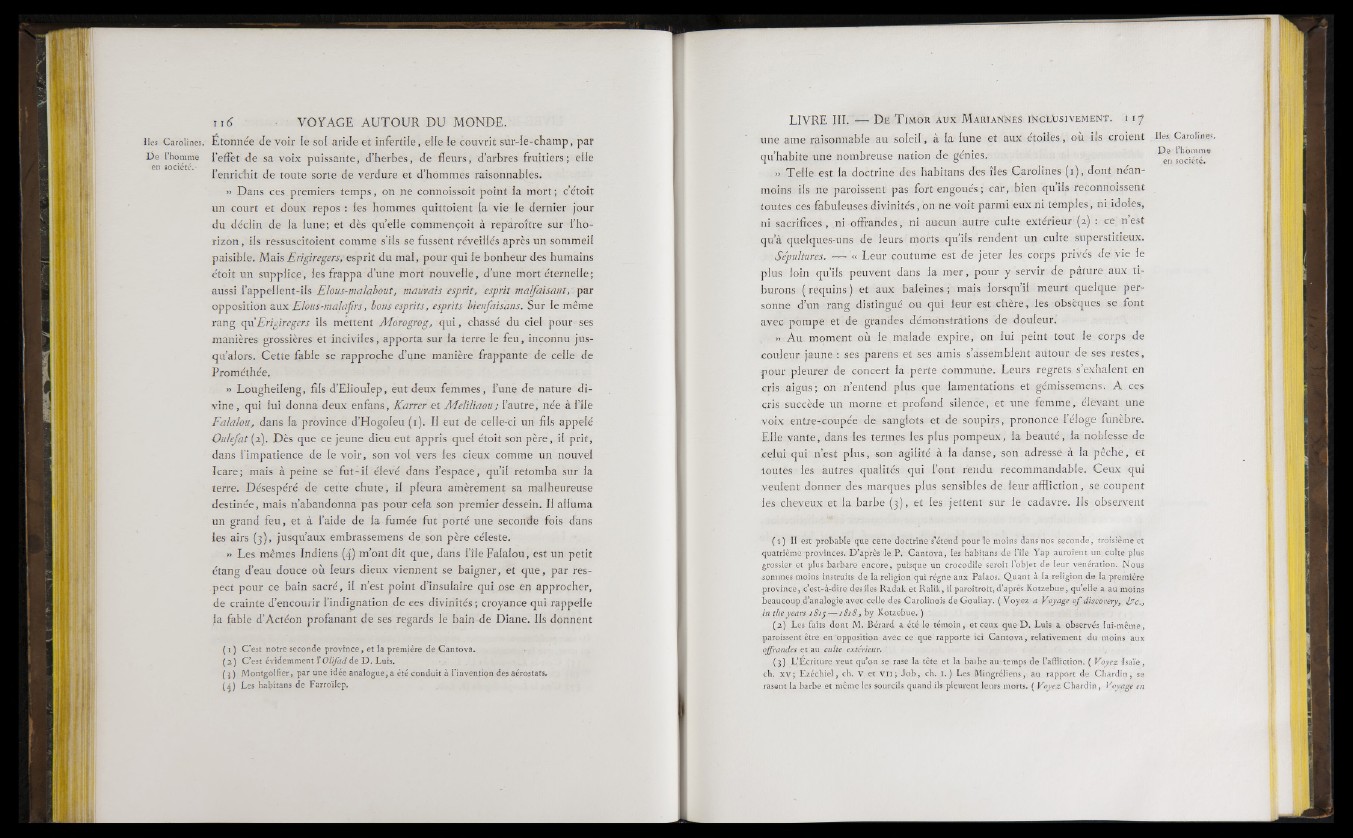
D e i’homme
en société.
li
lie s C a ïo lin e s . Étonnée de voir le sol aride et infertile, elle le couvrit sur-le-champ, par
l'effet de sa voix puissante, d’herbes, de fleurs, d’arbres fruitiers; elle
l’enrichit de toute sorte de verdure et d’hommes raisonnables.
» Dans ces premiers temps, on ne connoissoit point ia mort; c’étoit
un court et doux repos : ies hommes quittoient la vie le dernier jour
du déclin de la lune; et dès qu’elie commençoit à reparoître sur l’horizon,
iis ressuscitoient comme s'ils se fussent réveillés après un sommeil
paisible. Mais Engiregers, esprit du mai, pour qui le bonheiu des humains
étoit un supplice, les frappa d’une mort nouvelle, d’une mort éternelle;
aussi l’appellent-ils Elous-malahout, mauvais esprit, esprit malfaisant, par
opposition aux Elous-malafrs, bons esprits, esprits hienfaisans. Sur le même
rang quEriftregers iis mettent Morogrog, qui, chassé du ciel pour ses
manières grossières et inciviles, apporta sur la terre le feu, inconnu jusqu’alors.
Cette fable se rapproche d’une manière frappante de celle de
Prométhée.
» Lougheileng, fils d’ElîouIep, eut deux femmes, i’une de nature divine
, qui lui donna deux enfans, Karrer et Meliliaou; i’autre, née à l’île
Falalou, dans la province d’Hogoieu (i). II eut de celle-ci un fils appelé
Oiilefat (2). Dès que ce jeune dieu eut appris quel étoit son père, il prit,
dans l'impatience de le voir, son vol vers les cieux comme un nouvel
Icare; mais à peine se fut-il élevé dans l’espace, qu’il retomba sur la
terre. Désespéré de cette chute, il pleura amèrement sa malheureuse
destinée, mais n’abandonna pas pour cela son premier dessein. Il alluma
un grand feu, et à l’aide de la fumée fut porté une seconde fois dans
ies airs (3), jusqu’aux embrassemens de son père céleste.
» Les mêmes Indiens (4 ) m’ont dit que, dans i’île Falalou, est un petit
étang d’eau douce où leurs dieux viennent se baigner, et que, par respect
pour ce bain sacré, il n’est point d’insulaire qui ose en approcher,
de crainte d’encourir i’indignation de ces divinités; croyance qui rappelle
la fable d’Actéon profanant de ses regards ie bain de Diane. Iis donnent
( I ) C ’est notre seconde p ro v in c e , et la première de C an to v a .
( 2 ) C ’est évidemment XOlifad de D . Luis.
( j ) M on tgolfie r, par une idée analogue, a été conduit à l’invention des aérostats.
(4 ) L es habitans de Farroïlep.
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . î i 7
une ame raisonnable au soieil, à la lune et aux étoiles, où iis croient lie s Ca roline s,
qu’habite une nombreuse nation de génies. !o°iété!*^
» Telle est la doctrine des habitans des îles Caroiines (i), dont néanmoins
ils ne paroissent pas fort engoués ; car, bien qu’iis reconnoissent
toutes ces fabuleuses divinités , on ne voit parmi eux ni temples, ni idoles,
ni sacrifices, ni offrandes, ni aucun autre culte extérieur (2) : ce n est
qu’à quelques-uns de leurs morts qu’ils rendent un cuite superstitieux.
Sepultures. — « Leur coutume est de jeter les corps prives de vie le
plus loin qu’ils peuvent dans ia mer, pour y servir de pâture aux ti-
burons ( requins ) et aux baleines ; mais lorsqu’il meurt quelque personne
d’un rang distingué ou qui ieur est chère, les obsècpies se font
avec pompe et de grandes démonstrations de douleur.
» Au moment où le malade expire, on lui peint tout le corps de
couleur jaune : ses parens et ses amis s’assemblent autour de ses restes,
pour pleurer de concert la perte commune. Leurs regrets s’exhalent en
cris aigus; on n’entend pius que lamentations et gémissemens. A ces
cris succède un morne et profond silence, et une femme, élevant une
voix entre-coupée de sanglots et de soupirs, prononce l’éloge funèbre.
Elle vante, dans les termes ies plus pompeux, la beauté, la noblesse de
celui qui n’est plus, son agilité à la danse, son adresse à la pêche, et
toutes ies autres qualités qui l’ont rendu recommandable. Ceux qui
veulent donner des marques plus sensibles de leur affliction, se coupent
les cheveux et la barbe (3), et les jettent sur le cadavre. Ils observent
( 1 ) II est probable que cette doctrine s’ étend pour le moins dans nos seconde, troisième et
cjUcTtrième provinces. D ’après le P . C a n to v a , les habitans de l'île Y a p auroient un culte plus
grossier et plus barbare en co re , puisque un crocodile seroit l’objet de leur vénération. N ous
sommes moins instruits de la religion qui règne aux Palaos. Quant à la religion de la première
province , c’ est-à-dire desîles R ad ak et R a lik , il pa ro îtro it,d ’après K otz eb u e, qu’elle a au moins
beaucoup d’analogie avec celle des Carolinois de G ou lia y. ( V o y e z a Voyage o f discovery, ¿ f e .,
in the years i8 / y — i Sj S , by Kotzebue. )
( 2 ) Les faits dont M. B érard a été le témoin, et ceux que D . Luis a observés lui-même,
paroissent être en opposition avec ce que rapporte ici C a n to v a , relativement du moins aux
offrandes et au culte extérieur.
(3 ) L ’Écriture veut qu’ on se rase la tête et la b a ib e au temps de raffítction. ( Voyez îs a ïe ,
ch. x v ; E z é c h ie l, ch. v et v i l ; J o b , ch. l. ) Les J^Iingréliens, au rapport de C h a rd in , se
rasant la barbe et même les sourcils quand ils pleurent leurs morts. ( Voye.z C h a rd in , ¡''oyage en