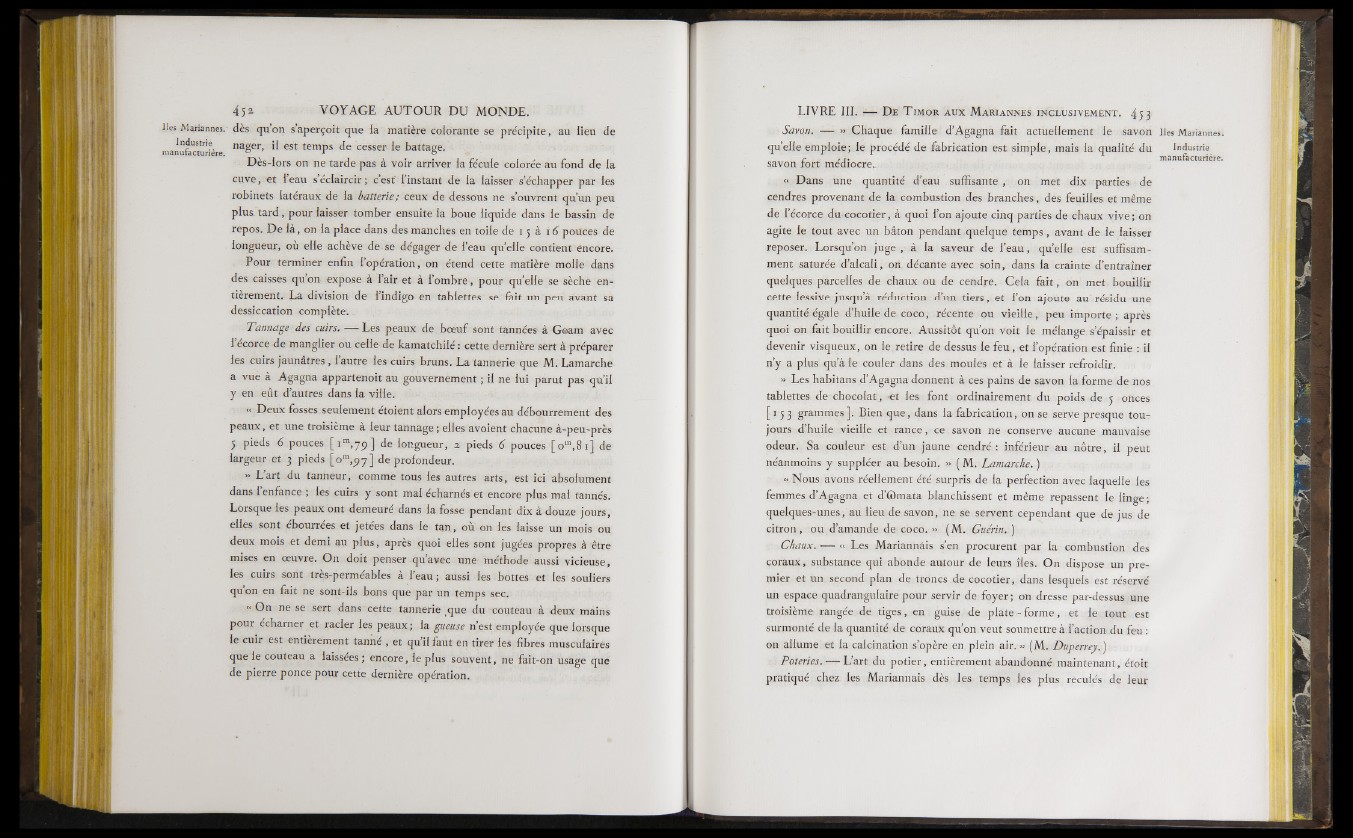
. f1
il ■
i
il I
45 2 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Iles .Mariannes, dès quon s’aperçoit que la matière colorante se précipite, au lieu de
manùlauHére.
Dès-lors on ne tarde pas à voir arriver la fécule colorée au fond de la
cuve, et l’eau s’éclaircir; c’est i’instant de la laisser s’échapper par les
robinets latéraux de la batterie; ceux de dessous ne s’ouvrent qu’un peu
pius tard, pour laisser tomber ensuite la boue liquide dans le bassin de
repos. De là, on la place dans des manches en toile de i 5 à 16 pouces de
longueur, où elle achève de se dégager de l’eau qu’elle contient encore.
Pour terminer enfin l’opération, on étend cette matière molle dans
des caisses qu’on expose à l’air et à l’ombre, pour qu’elle se sèche entièrement.
La division de l’indigo en tablettes se fait un peu avant sa
dessiccation compiète.
Tannage des cuirs. — Les peaux de boeuf sont tannées à Goam avec
l’écorce de manglier ou celle de kamatchiié : cette dernière sert à préparer
les cuirs jaunâtres , l’autre les cuirs bruns. La tannerie que M. Lamarche
a vue à Agagna appartenoit au gouvernement ; il ne lui parut pas qu’il
y en eût d’autres dans la ville.
« Deux fosses seulement étoient alors employées au débourrement des
peaux, et une troisième à leur tannage ; elies avoient chacune à-peu-près
5 pieds 6 pouces [ 1A 7 9 ] de longueur, 2 pieds 6 pouces [o “ ,8 i] de
largeur et 3 pieds [o"',97] de profondeur.
» Lart du tanneur, comme tous les autres arts, est ici absolument
dans l’enfance ; les cuirs y sont mal écharnés et encore plus mal tannés.
Lorsque les peaux ont demeuré dans ia fosse pendant dix à douze jours,
elles sont ébourrées et jetées dans le tan, où on les iaisse un mois ou
deux mois et demi au plus, après quoi elles sont jugées propres à être
mises en oeuvre. On doit penser qu’avec une méthode aussi vicieuse,
les cuirs sont très-perméables à l’eau ; aussi les bottes et les souliers
qu’on en fait ne sont-ils bons que par un temps sec.
“ On ne se sert dans cette tannerie que du couteau à deux mains
pour écharner et racler les peaux ; la gueuse n’est employée que lorsque
le cuir est entièrement tanné , et qu’il faut en tirer les fibres musculaires
que le couteau a laissées ; encore, le plus souvent, ne fait-on usage que
de pierre ponce pour cette dernière opération.
Industrie
manufacturière.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 5 3
Savon. — » Chaque famille d’Agagna fait actuellement le savon ties Mariannes,
qu’elle emploie; le procédé de fabrication est simple, mais la qualité du
savon fort médiocre.
« Dans une quantité d’eau süffisante , on met dix parties de
cendres provenant de ia combustion des branches, des feuilles et même
de l’écorce du cocotier, à quoi l’on ajoute cinq parties de chaux vive; on
agite le tout avec un bâton pendant quelque temps , avant de ie laisser
reposer. Lorsqu’on juge , à la saveur de l’eau, qu’elle est suffisamment
saturée d’alcali, on décante avec soin, dans ia crainte d’entraîner
quelques parcelles de chaux ou de cendre. Cela fa it, on met bouillir
cette lessive jusqu’à réduction d’un tiers, et l’on ajoute au résidu une
quantité égale d’huile de coco, récente ou vieille, peu importe; après
quoi on fait bouillir encore. Aussitôt qu’on voit le mélange s’épaissir et
devenir visqueux, on ie retire de dessus le feu, et l’opération est finie : il
n’y a plus qu’à le couler dans des moules et à le laisser refroidir.
» Les habitans d’Agagna donnent à ces pains de savon la forme de nos
tablettes de chocolat, -et les font ordinairement du poids de 5 onces
[ ' 5 3 grammes]. Bien que, dans la fabrication, on se serve presque toujours
d’huile vieille et rance, ce savon ne conserve aucune mauvaise
odeur. Sa couleur est d’un jaune cendré : inférieur au nôtre, il peut
néanmoins y suppléer au besoin. » ( M. Lamarche. )
« Nous avons réellement été surpris de la perfection avec laquelle les
femmes d’Agagna et d’ômata blanchissent et même repassent le linge;
quelques-unes, au lieu de savon, ne se servent cependant que de jus de
citron, ou d’amande de coco. » (M. Guérin. )
Chaux. —— « Les Mariannais s’en procurent par la combustion des
coraux, substance qui abonde autour de leurs îles. On dispose un premier
et un second plan de troncs de cocotier, dans lesquels est réservé
un espace quadrangulaire pour servir de foyer; on dresse par-dessus une
troisième rangée de tiges, en guise de plate - forme, et ie tout est
surmonté de la quantité de coraux qu’on veut soumettre à l’action du feu ;
on allume et la calcination s’opère en plein air. » (M. Duperrey.)
Poteries. — L’art du potier, entièrement abandonné maintenant, étoit
pratiqué chez les Mariannais dès les temps les plus reculés de leur