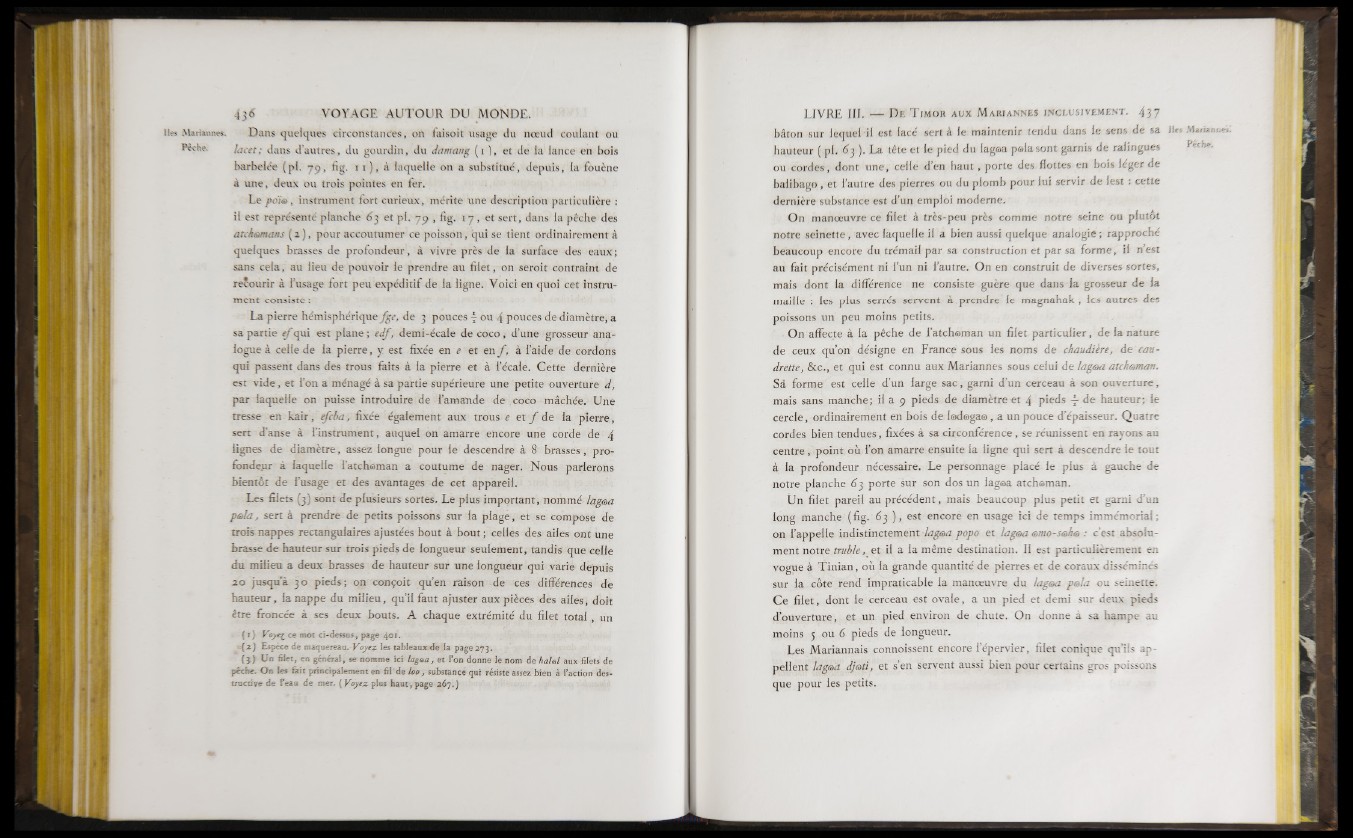
I
436 \ o vA C F . A u r o in i n i i m o n o k .
Dans quelques eireonstanees, on laisoil usage Ju lueuil coulant ou
lacet: dans d'autres, du gourdin, du Janiang (1 ), et île la lance en hois
harhelee (pl. 79, tig. t 1 ) , à laquelle on a substitué, depuis, la iouéne
à une, deux ou trois pointes en fer.
Le jt'Oi®, instrument tort curieux, mérite une descrijition parlieidiére ;
il est représente planche 63 et pl. 79 , lig. t 7 , et sert, dans la pêche des
atchtimans [z], pour accoutumer ee poisson, qui se tient ordinairement à
quelques brasses de protondeur, à vivre près de la surtace îles eaux;
sans cela, au lieu de pouvoir le prendre au filet, on seroit contraint de
recourir à l'usage lort peu expéditif de ia ligne. Voici en quoi cet instrument
consiste :
La pierre hémisphérique fgc, de 3 pouces y ou 4 pouces de diamètre, a
sa partie el qui est plane ; edf, demi-écale de coco , d’une grosseur analogue
à celle de la pierre, y est fixée en e et en f , à l’aide de cordons
qui passent dans des trous faits à la pierre et à fécale. Cette dernière
est vide, et l'on a ménagé à sa partie supérieure une petite ouverture d,
par laquelle on puisse introduire de l’amande de coco mâchée. Une
tresse en kair, efcba, fixée également aux trous e et / de la pierre,
sert d'anse à l'instrument, auquel on amarre encore une corde de 4
lignes de diamètre, assez longue pour le descendre à 8 brasses, profondeur
à laquelle l'atchoman a coutume de nager. Nous parlerons
bientôt de l’usage et des avantages de cet appareil.
Les filets (3) sont de plusieurs sortes. Le pius important, nommé lagaa
p&la, sert à prendre de petits poissons sur la plage, et se compose de
trois nappes rectangulaires ajustées bout à bout; celles des ailes ont une
brasse de hauteur sur trois pieds de longueur seulement, tandis que celie
du milieu a deux brasses de hauteur sur une longueur qui varie depuis
20 jusqu’à 30 pieds; on conçoit qu’en raison de ces différences de
hauteur, la nappe du milieu, qu’il faut ajuster aux pièces des ailes, doit
être froncée à ses deux bouts. A chaque extrémité du filet total , un
( 1 ) ce mot ci-d essu s, page 4o/-
( 2 ) Espece de maquereau. Voyez les tableaux de la page 2 7 3 .
( 3 ) U n fiie t, en général, se nomme ici la g a a , et l’on donne le nom de h a la l aux filels de
pèche. On ies fa it principalement en fil de lo o , substance qui résiste assez bien à l’ action destructive
de Teau de mer. (V o y e z plus h au t, page 2 6 7 .)
LIVRL, III. — l)F. T im o r a u x M a /u a n .m .s 437
hâlon sur Iciiiid il est lacé .sert à le maintenir ietidu dans le sens de sa iles-Ma
hauteur ( pl. 63 ). La tête et le pied du lagoa polasont garnis de ralingues
ou corde.s, dont une, celle d’en haut , porte des flottes en hois léger de
balibago , et l’autre des pierres ou du plomb pour lui .servir de lest : cette
dernière stdistance est d’un emploi moderne.
On manoeuvre ce filet à très-peu près comme notre seine ou plutôt
notre seinette, avec larjuelle il a bien aussi quelque analogie; rapproché
beaucoup encore du trémail par sa construction et par sa forme, il n’est
au fait précisément ni l’un ni i’autre. On en construit de diverses .sortes,
mais dont la différence ne consiste guère que dans la grosseur de la
maille : les plus serrés servent à prendre le magnahak , ies autres des
poissons un peu moins petits.
On affecte à la pêche de l’atchoman un filet particulier, de ia nature
de ceux qu’on désigne en France sous les noms de chaudière, de cau-
drette, &c., et qui est connu aux Mariannes sous celui de lagom atchojman.
Sa forme est celle d’un large sac, garni d’un cerceau à son ouverture,
mais sans manche; il a 9 pieds de diamètre et 4 pieds -j- de hauteur; ie
cercle, ordinairement en bois de lodogaiD , a un pouce d’épaisseur. Quatre
cordes bien tendues, fixées à sa circonférence , se réunissent en rayons au
centre, point où fon amarre ensuite ia ligne qui sert a descendre ie tout
à la profondeur nécessaire. Le personnage piacé le plus a gauche de
notre pianche 63 porte sur son dos un lagaa atchaman.
Un filet pareil au précédent, mais beaucoup plus petit et garni d’un
long manche (fig. 63 ), est encore en usage ici de temps immémorial ;
on l’appelle indistinctement lagaa popo et lagaa amo-saha : c'est absolument
notre truble, et il a la même destinarion. Il est particulièrement en
vogue à Tinian, où la grande quantité de pierres et de coraux dissémines
sur la côte rend impraticable la manoeuvre du lagaa pala ou seineiie.
Ce filet, dont le cerceau est ovale, a un pied et demi sur deux pieds
d’ouverture, et un pied environ de chute. On donne a sa hampe au
moins 5 ou 6 pieds de longueur.
Les Alariannais connoissent encore fépervier, filet conique qu'ils appellent
lagaa djati, et s’en servent aussi bien pour certains gros poisser.»
que pour les petits.