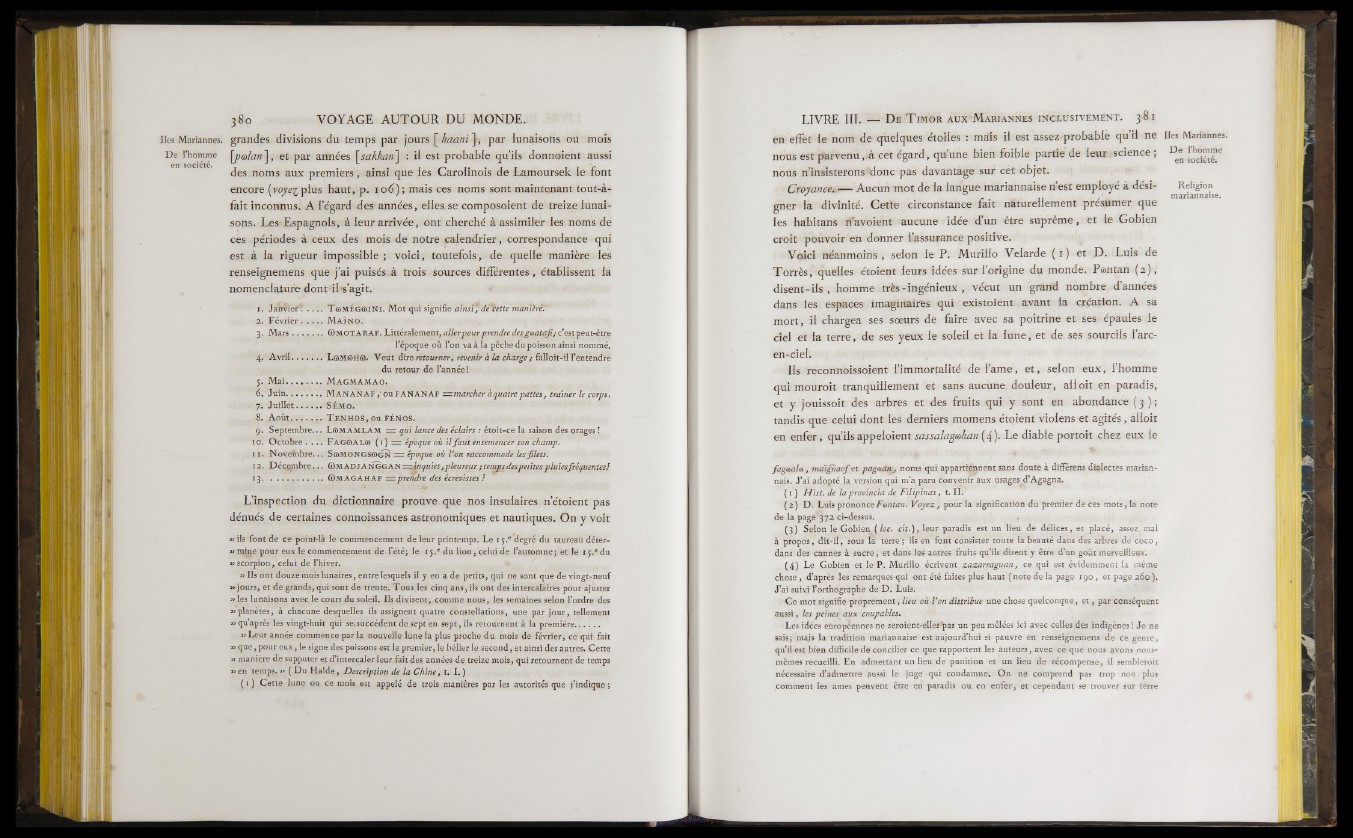
iimni
>»11.
ilä^j .«il'
È-TTJJ llli, >'
I Ü
380 VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Iles Maiiannes. grandes divisions du temps par jours [ h a a n i ] , par lunaisons ou mois
D e l’homme [ p a l a n ] , et par années [ s a k k a n ] : il est probable qu’ils donnoient aussi
des noms aux premiers, ainsi que les Carolinois de Lamoursek le font
encore [voyez^ivis haut, p. 10 6 ) ; mais ces noms sont maintenant tout-à-
fait inconnus. A l’égard des années, elles se composoient de treize lunaisons.
Les Espagnols, à leur arrivée, ont cherché à assimiler les noms de
ces périodes à ceux des mois de notre calendrier, correspondance qui
est à la rigueur impossible; voici, toutefois, de quelle manière les
renseignemens que j’ai puisés à trois sources différentes, établissent la
nomenclature dont ii s’agit.
1 . J a n v i e r T oM É G O lN l. M o t qui signifie a insi', de cette manière.
2 . F é v r ie r M a ï n o .
3 . M a r s (Dm o t a RAF, Littéralement, c’ estpeut-être
Tépoque où Ton v a à la pêche du poisson ainsi nommé.
4. A v r i i ................Lôm ôH Ô . V eu t à.ne retourner, revenir à la charge ; ïdWoïi-ïWQntenàxe
du retour de Tannée î
5. M a i ..................M a g m Am a o .
6. Ju in ....................M a n a n A F ou FAN AN A F z=:marcher à quatre pattes , traîner le corps.
7 . J u i l l e t ...............S ÉM o .
B. A o û t.................T e n h o Sj Ou f é n o s .
9. S e p tem b re ... L û m a m l a m = qui lance des éclairs : étoit-ce la saison des o rage s!
10 . Octobre . . . . F a g o a lO ( 0 — époque où i l fa u t ensemencer son champ.
1 1 . N o v em b r e .. . S ûM O N G S û g n = époque où Von raccommode les filets.
1 2 . D é c em b r e .. . (xi'NiADj Al^GGAl^ — inquiet, pleureur j temps despeiites p luiesfréquentesl
1 3 ..................................Ô M A G A H A F -=.prendre des écrevisses!
L’inspection du dictionnaire prouve que nos insuiaires n’étoient pas
dénués de certaines connoissances astronomiques et nautiques. On y voit
» ils fon t de ce point-là le commencement de leur printemps. L e i 5." degré du taureau déter-
» mine pour eux 1e commencement de l’été; le 1 5 . " du lio n , celui de l’automne; et le I 5 . ' du
» s c o rp io n , celui de l’hiver.
» Ils ont douze mois lu naire s, entre lesquels il y en a de petits, qui ne sont que de v in g t-n eu f
» jours, et de grands, qui sont de trente. T ous les cinq an s , ils ont des intercalaires pour ajuster
» le s lunaisons avec le cours du soleil. Ils d ivisent, comme nous, les semaines selon i’ordre des
» p la n è te s , à chacune desquelles ils assignent quatre constellations, une par jo u r , tellement
» q u ’après les vingt-huit qui se,succèdent de sept en sep t, ils retournent à la première.............
» Leur année commence par la nouvelle lune la plus proche du mois de fé v r ie r , ce qui fait
» q u e , pour eu x , le signe des poissons est le premier, le bélier le se con d , et ainsi des autres. C e tte
» manière de supputer et d’intercaler leur fa it des années de treize mois, qui retournent de temps
» en temps. » ( D u H a ld e , Description de la C h in e , t. L )
( I ) C e tte lune ou ce mois est appelé de trois manières par les autorités que j’ indique ;
D e l’homme
en société.
R elig ion
mariannaise.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 3 1
en effet le nom de quelques étoiles : mais il est assez probable qu’il ne Ile s Mariannes
nous est parvenu, à cet égard, qu’une bien foible partie de leur science ;
nous n’insisterons donc pas davantage sur cet objet.
Croyance. — Aucun mot de ia langue mariannaise n’est employé à désigner
la divinité. Cette circonstance fait naturellement présumer que
les habitans n’avoient aucune idée d’un être suprême , et ie Gobien
croit pouvoir en donner l’assurance positive.
Voici néanmoins, seion ie P. Muriilo Velarde ( i ) et D. Luis de
Torrès, quelles étoient leurs idées sur l’origine du monde. Ptantan (2 ),
disent-ils, homme très-ingénieux , vécut un grand nombre d’années
dans les espaces imaginaires qui existoient avant la création. A sa
mort, il chargea ses soeurs de faire avec sa poitrine et ses épaules le
ciel et la terre, de ses yeux le soleii et la lune, et de ses sourcils l’arc-
en-ciei.
Iis reconnoissoient l’immortaiité de l’ame, et, selon eux, i’homme
qui mouroit tranquillement et sans aucune douleur, aiioit en paradis,
et y jouissoit des arbres et des fruits qui y sont en abondance ( 3 ) ;
tandis que celui dont les derniers momens étoient violens et agités , aiioit
en enfer, qu’i l s a p p e i o i e n t (4)- Le diable portoit chez eux le
fagmaltn , maignaof et p a g o a n , noms qui appartiennent sans doute à différens dialectes mariannais.
J ’ai adopté la version qui m’a paru convenir aux usages d’Agagn a .
( I ) H is t. de la provincia de F ilip in a s , t. I I ,
( 2 ) D . Luis prononceTfflnMn. V o y e z , pour la signification du premier de ces m o ts, la note
de la page 3 7 2 ci-dessus.
( 3 ) Se lon le G o b ien [loc, c it.) , leur paradis est un lieu de d é lic e s , et p la c é , assez mal
à p ro p o s , d i t - i l , sous la terre ; ils en font consister toute la beauté dans des arbres de c o c o ,
dans des cannes à su c re , et dans les autres fruits qu’ ils disent y être d’un goût mereeilleux.
( 4 ) L e Gobien et le P . Muriilo écrivent za za r ra g u a n , ce qui est évidemment la même
cbose , d’après les remarques qui ont été faites plus haut ( note de la page 1 9 0 , et page 26 0 ).
J ’ai suivi l’orthographe de D . Luis,
C e mot signifie proprement, lieu ou l'on distribue une chose quelconqu e, e t , par conséquent
a u s s i, les peines aux coupables.
L es idées européennes ne seroient-elles pas un peu mêlées ici avec celles des indigènes ! J e ne
sais; mais la tradition mariannaise est aujourd’hui si pauvre en renseignemens de ce g enre ,
qu’il est bien difficile de concilier ce que rapportent les auteurs, avec ce que nous avons nous-
mêmes recueilli. E n admettant un lieu de punition et un lieu de récompense, il sembleroit
nécessaire d’admettre aussi le juge qui condamne. On ne comprend pas trop non plus
comment ies ames peuvent être en paradis ou en e n fe r , et cependant se trouver sur terre