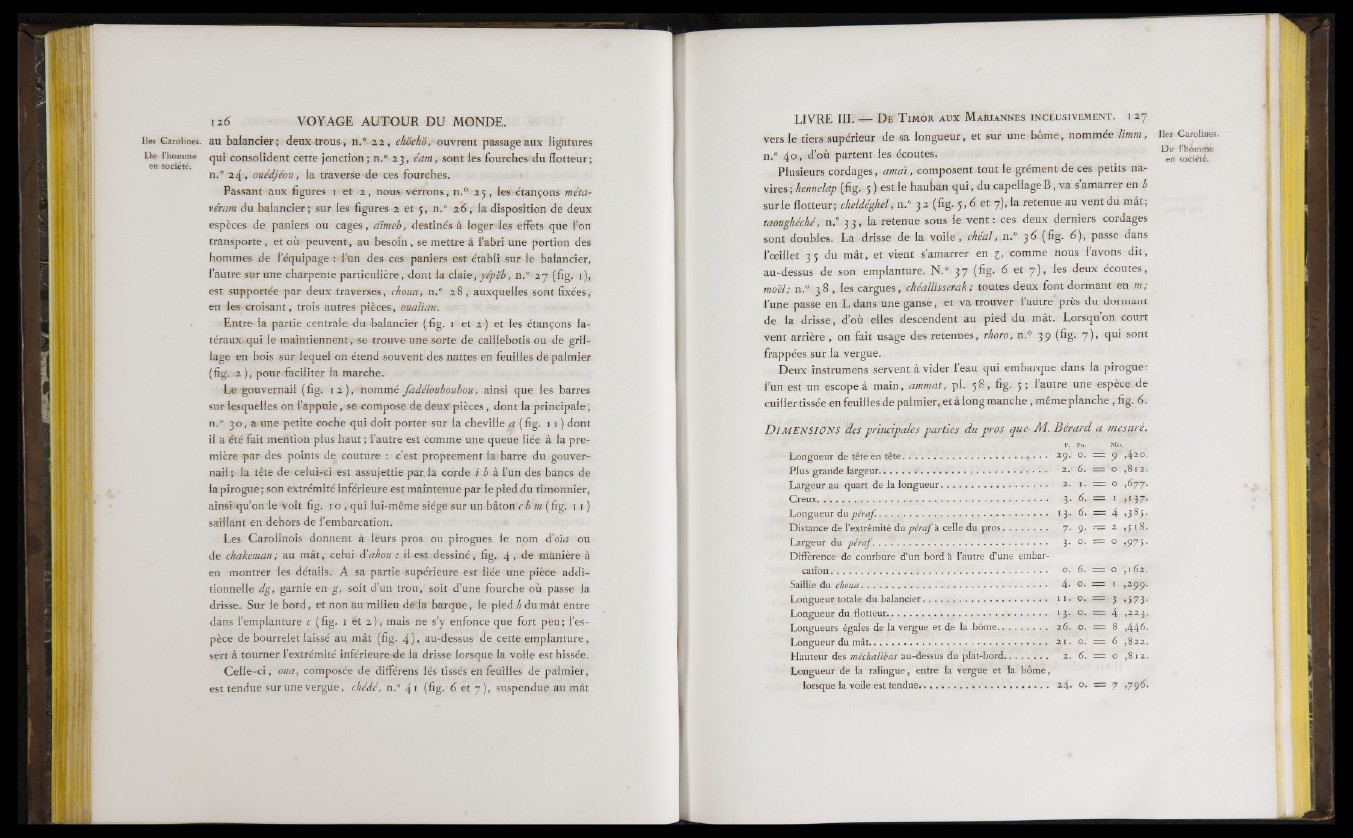
Iles Ca roline s, au balancier; deux trous, n.° 2 2 , chocho, ouvrent passage aux ligatures
D e l’ homme qui consolident cette jonction ; n.° 23, éam, sont les fourches du flotteur;
en société. , , . , , r -, n.° 2 4 , ouedjeou, la traverse de ces fourches.
Passant aux figures i et 2 , nous verrons, n.° 2 5 , les étançons méta-
véram du balancier; sur les figures 2 et 5, n.° 26 , la disposition de deux
espèces de paniers ou cages, dim eh, destinés à loger les effets que i’on
transporte, et où peuvent, au besoin , se mettre à i’abri une portion des
hommes fie l’équipage : l’un des ces paniers est établi sur le balancier,
l’autre sur une charpente particuiière, dont ia c\a\e, yépëh, n.° 27 (fig. i),
est supportée par deux traverses, choua, n.° 28 , auxquelles sont fixées,
en les croisant, trois autres pièces, oualian.
Entre la partie centrale du balancier (fig. i et 2 ) et les étançons latéraux
qui ie maintiennent, se trouve une sorte de cailiebotis ou de grillage
en bois sur lequel on étend souvent des nattes en feuilles de palmier
(fig. 2 ), pour faciliter la marche.
Le gouvernail (fig. 1 2 ) , nommé fadéloubouhou, ainsi que ies barres
sur lesquelles on l’appuie, se compose de deux pièces, dont la principale,
n.° 30, a une petite coche qui doit porter sur ia cheville a (fig. 1 i ) dont
il a été fait mention plus haut; l’autre est comme une queue liée à la première
par des points de couture : c’est proprement la barre du gouvernail;
la tête de celui-ci est assujettie par. la corde i b à l’un des bancs de
la pirogue; son extrémité inférieure est maintenue par le pied du timonnier,
ainsi qu’on ie voit fig. i o , qui iui-même siège sur un bâton c l m(fig. I l )
saillant en dehors de l’embarcation.
Les Carolinois donnent à leurs pros ou pirogues le nom àbdia ou
de chakeman; au mât, celui A’ahou : il est dessiné, fig. 4 . de manière à
en montrer les détails. A sa partie supérieure est liée une pièce additionnelle
dg, garnie en g, soit d’un trou, soit d’une fourche où passe la
drisse. Sur le bord, et non au miiieu de ia barque, le pied A du mât entre
dans l’emplanture c (fig. i et 2 ), mais ne s’y enfonce que fort peu; l’espèce
de bourrelet laissé au mât (fig. 4 ). au-dessus de cette emplanture,
sert à tourner l’extrémité inférieure de la drisse lorsque la voile est hissée.
Celle-ci, oua, composée de différens iés tissés en feuilles de palmier,
est tendue sur une vergue, chédé, n.° 4 i (üg- 6 et 7), suspendue au mât
LIVRE III. — D e T imor au x M ariannes in c lu s iv em en t . 1 27
vers le tiers supérieur de sa longueur, et sur une bôme, nommée limm,
n.“ 4 0, d’où partent ies écoutes.
Plusieurs cordages, amdi, composent tout le grément de ces petits navires
; hennelap (fig. 5 ) est le hauban qui, du capellage B , va s’amarrer en b
surie flotteur; cheldéghel, n.“ 32 (fig. 5, 6 et 7), la retenue au vent du mât;
taoughéché, n.° 3 3, la retenue sous le vent : ces deux derniers cordages
sont doubles. La drisse de la voiie, chéal, n.° 36 (fig. 6), passe dans
l’oeillet 35 du mât, et vient s’amarrer en i , comme nous l’avons dit,
au-dessus de son emplanture. N.° 37 (fig. 6 et 7 ) , ies deux écoutes,
moël; n.“ 3 8 , les cargues, chéallisserak; toutes deux font dormant en m;
l’une passe en L dans une ganse, et va trouver l’autre près du dormant
de ia drisse, d’où elles descendent au pied du mât. Lorsqtfon court
vent arrière , on fait usage des retenues, rhoro, n.° 39 (fig. 7), qui sont
frappées sur ia vergue.
Deux instrumens servent à vider i’eau qui embarque dans la pirogue;
i’un est un escope à main, ammat, pl. 58 , fig. 5 ; 1 autre une espèce de
cuiller tissée en feuiiles de palmier, et à long manche , même planche , fig. 6.
D im e n s i o n s des pniwipales parties du pros que M . B é ra rd a mesuré.
P. Po. Me t .
Longueur de tête en tête ...........................................................
Plus grande iargeur....................................... ..............................
Largeur au quart de la longueur........................................
Creux......................................................................................................... 3-
Longueur du p é ra f.............................................................................
Distance de l’extrémité du p é ra f s celie du p ro s ....................
Largeur du p é r a f . ............................................................................
Différence de courbure d’un bord h l ’autre d’une embarcation
..................................................................................................
2 9 . 0 . = 9 , 4 2 0 .
_
2 . 6 .
2 . I . = 0 . 6 7 7 -
3*
^ 3* 6 . = 4 - 3 8 5 .
7- 9*
— 2 , , 5 1 8 .
3* 0 , — 0 . 975-
0 . 6. — 0 , 1 6 2 .
Saillie du choua 4 - o. =
Longueur totale du balancier........................................................ 1 1 .
Longueur du flotteur...................................................................
Longueurs égales de la vergue et de la bôme...................... 2 6 . o.
Longueur du mât............................................ ...................................
Hauteur des inéchalibas au-dessus du plat-bord...................
Longueur de la ralingue, entre ia vergue et ia bôme,
0 , 8 i 2 .
I . > 37-
4 . 0 . I , 2 9 9 .
1 1 . 0 . = 5 , 573-
1 3 - 0 . = 4 , 2 2 3 .
2 6 . 0 . 1 = 8 ,446.
2 1 . 0 . = 6 , 8 2 2 .
2 . 6 . 0 , 8 1 2 .
lorsque ia voile est tendvie........................................................... 24 2 4 . - o.0 . = 7 ,79 , 7 9 6 6 .
.
Iles Caroiine s.
D e ï’ homnre
en société.